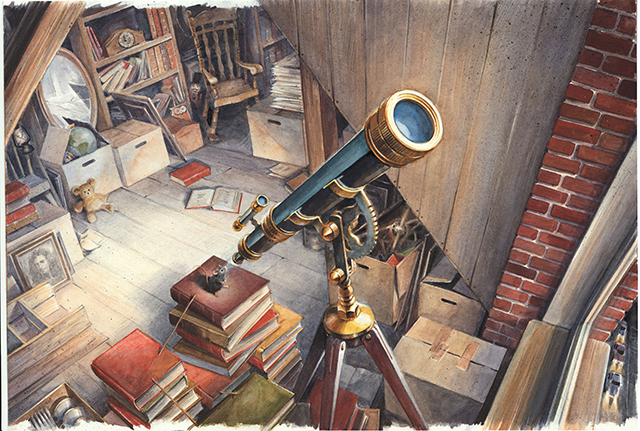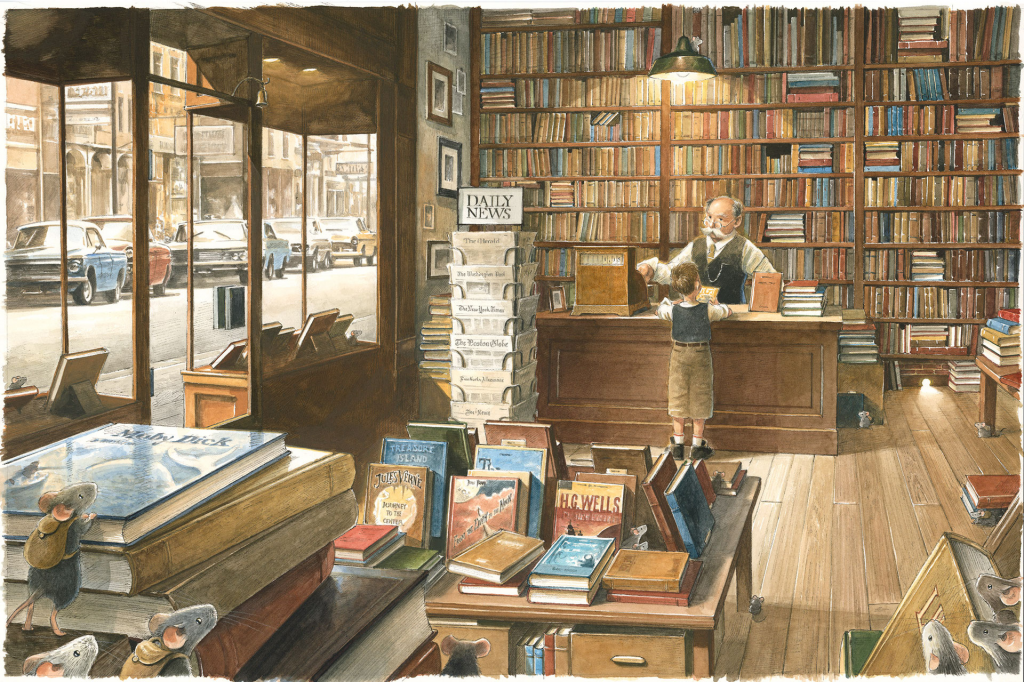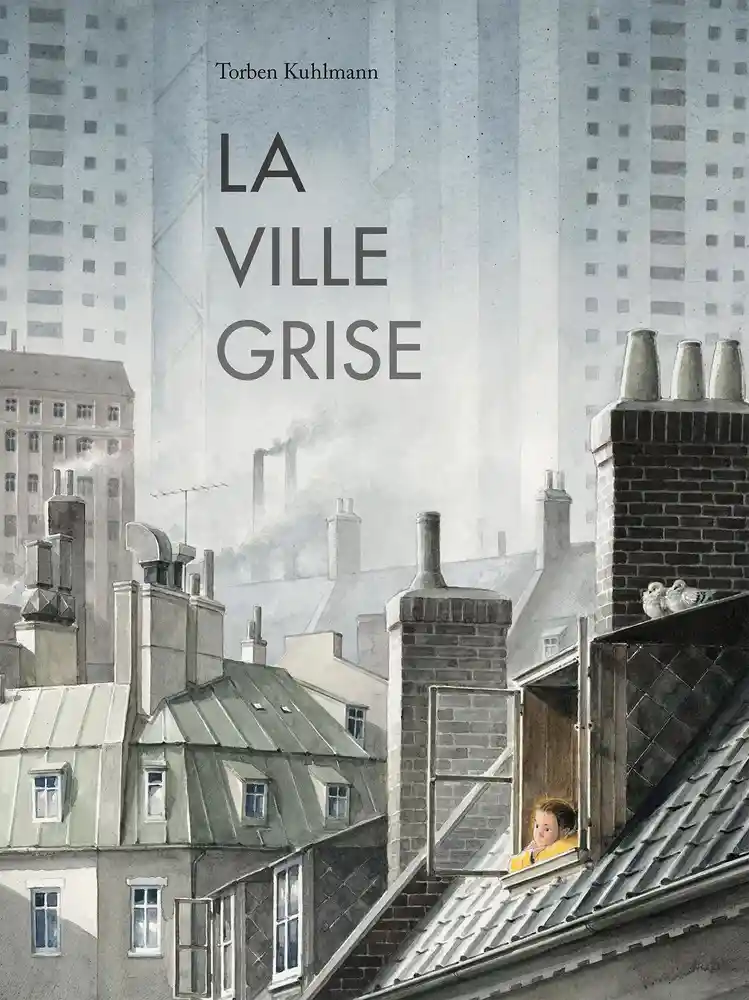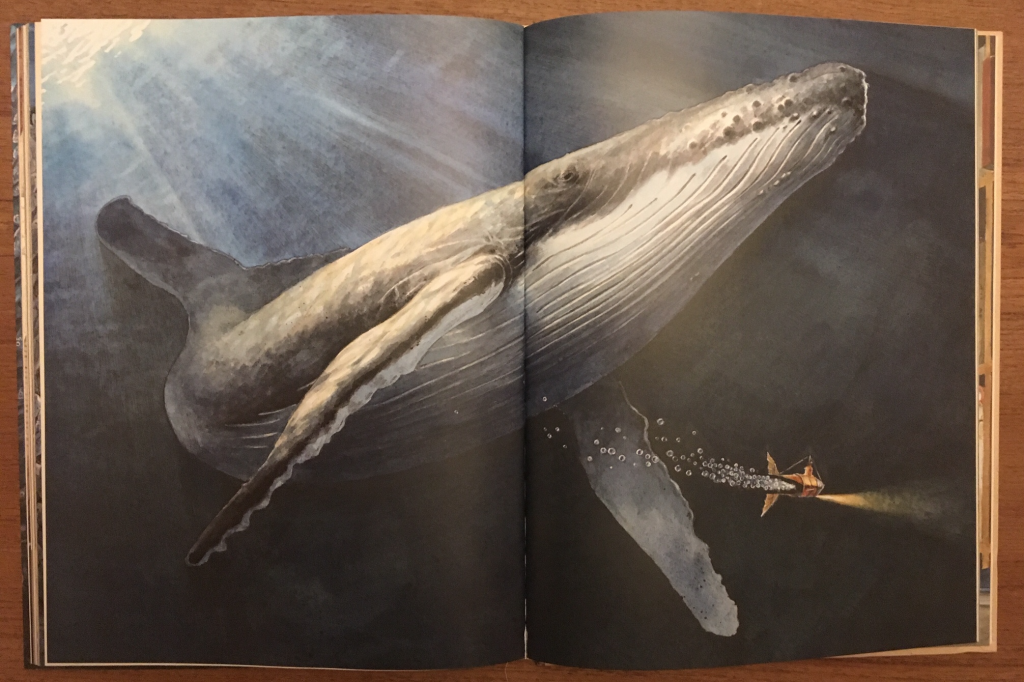Après avoir partagé une lecture commune de A(ni)mal et avoir été bouleversées par Guerrière (lauréat de la sélection Belles branches du prix ALODGA 2024), nous avons eu envie de demander à Cécile Alix comment elle se saisissait de sujets aussi intenses. Et c’est avec beaucoup de gentillesse qu’elle a accepté de répondre à nos questions.
Nous vous proposons donc de découvrir le résultat de cet échange et de vous laisser porter par l’enthousiasme de cette auteure aux mille projets !
Pensez-vous qu’il y a des impératifs particuliers ou des écueils à éviter lorsque l’on écrit pour la jeunesse ?
Pour les 3-10 ans, j’évite d’utiliser un langage et des tournures trop sophistiquées, ainsi que des termes grossiers. Ce qui ne signifie pas que je simplifie au maximum, sans aucun « gros mot ». Je m’adapte à leur niveau de lecture, en glissant, de ci, de là, un mot qu’ils ne connaîtront peut-être pas, une formule un peu plus « alambiquée ». J’essaie de ne pas les ennuyer, plutôt de les amuser, de les faire rêver, de les embarquer. Quant aux jurons, je les tente drôles et imagés !




Pour les pré-ados, ados et jeunes adultes, je m’autorise davantage de liberté. Mais je suis attentive, avec l’aide de mes éditrices, à prendre soin de mes lecteurs et lectrices, à respecter leurs fragilités, leur émotivité, même si mes sujets sont parfois difficiles. Un écueil important aussi, c’est de « s’écouter écrire » et donc de lasser mes lecteurs et lectrices de tous âges : je « nettoie » beaucoup mes textes !
Y-a-t-il des auteurs qui vous inspirent ou dont vous appréciez particulièrement le travail ?
Il faudrait des kilomètres de papier pour en dresser la liste… Je lis, en ce moment, l’œuvre complète de Sorj Chalandon qui n’est pas un écrivain dit « de jeunesse », mais dont je conseille le dernier roman L’Enragé à tous les ados que je rencontre. J’aime son écriture « sans gras », tellement puissante et intense. Il est perméable au monde, il écrit vrai.
Dans ma bibliothèque de littérature jeunesse, il y a, entre des centaines d’autres, les albums de Rémi Courgeon, François Place, Claude Ponti, Muriel Bloch, Frédéric Clément ; les romans de Roald Dahl, Marie-Aude Murail, Jean-François Chabas, Jean-Claude Mourlevat, Timothée de Fombelle, Taï-Marc Le Thanh, Vincent Villeminot… tous et toutes sont fascinants et inspirants.
Vous écrivez aussi bien pour les jeunes enfants que pour les ados et même des scénarios de bandes dessinées. À quel moment définissez-vous l’âge auquel s’adresse votre histoire ? Des contraintes s’imposent-elles selon le type de lecteur visé ?
Avant d’écrire un texte, quel qu’il soit, je le tourne en tête et devine instinctivement à quels lecteurs je vais le destiner. À mon sens, quasiment tous les sujets peuvent être abordés en littérature jeunesse, que l’on s’adresse aux très jeunes lecteurs comme aux plus âgés. Ensuite, bien sûr, je tente « d’écrire vrai » en adaptant mon langage, la longueur du texte, pour respecter le mieux possible les enfants auxquels je m’adresse.
Parlons un peu de vos romans ados et jeunes adultes, qui nous ont tout particulièrement touchées. Un certain nombre de vos personnages principaux traversent des expériences dramatiques (migrant, enfant-soldat, harcèlement, deuil…) parfois inspirés de faits réels. De quelle manière vous choisissiez vos sujets ?
Ils viennent à moi, me happent. Lorsque je suis touchée par des sujets tels que ceux que vous évoquez, ils m’imprègnent puissamment, je me plonge en eux, et un jour, ils deviennent texte.



Nous avons d’ailleurs été impressionnées par la manière dont vous immergez vos lecteurs dans ces situations, comment vous documentez-vous ?
Je m’enrichis d’événements vécus personnellement, de rencontres importantes, de longs échanges, d’une chaîne humaine qui m’offre sa réalité que je transforme en fiction. Je me documente beaucoup aussi avant d’écrire. Je lis énormément, consulte des archives, regarde une importante filmographie, parfois des années durant. Je m’efforce d’être digne de mon sujet.
Dans Guerrière, par exemple, la force de restitution de vos mots nous a glacées. Le mélange de tons entre des mots directs, presque crus, sans confusion possible ; des descriptions poétiques (de la nature notamment) et d’une certaine candeur car la narratrice n’est encore qu’une jeune ado est impressionnante. Ces sujets délicats vous obligent-ils à faire des choix stylistiques ?
Chacun de mes romans possède son langage. Car chaque personnage vit une situation singulière. J’ai beaucoup réfléchi à la langue en écrivant Guerrière. Comment s’exprime-t-on lorsque l’on est confronté à la guerre, au danger, à la terreur, à la mort ? Que deviennent alors la parole, le souffle, la pensée ? Quel est le langage d’un enfant face à de telles atrocités ? La langue de ma narratrice, qui est enfant-soldat, ne pouvait être trop « littéraire », il fallait créer des rythmes syncopés, briser la phrase, la déstructurer, traduire le chaos, asphyxier le vocabulaire, puis peu à peu lui rendre ses mots-rivières, lui permettre la douceur, la respiration, l’harmonie.
Vos romans sur les migrants ou les enfants soldats adoptent la perspective de minorités auxquelles vous n’appartenez pas, ce qui ne vous empêche pas de traduire extrêmement bien leurs émotions. Que pensez-vous des débats autour de l’idée d’appropriation culturelle ?
Pour répondre brièvement à l’introduction de votre question : le destin d’enfants migrants puis celui d’anciens enfants-soldats ont croisé le mien. Depuis nous cheminons ensemble. Je pense qu’il est essentiel, nécessaire, de regarder en face, sans la minimiser, la réalité de ceux qui font partie de minorités dans nos sociétés « occidentales ». Ils ont la sensation désespérée de ne jamais être entendus lorsqu’ils parlent de leur propre histoire. Le discours qui les concerne est majoritairement véhiculé par d’autres, et ils se sentent eux-mêmes censurés. Mais faut-il pour autant interdire aux écrivains de se saisir de personnages qui appartiennent à une autre catégorie sociale ou culturelle que la leur ? Les empêcher de s’emparer de pans de l’histoire qui, déconnectés de leurs propres racines, semblent devoir « appartenir » à d’autres ? Je n’ai pas de « bonnes réponses »… Il me semble que les écrivains, quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, peuvent être des atouts précieux dans la lutte contre les préjugés et les discriminations. Je ne peux pas mieux dire que l’auteur franco-ivoirien Armand Gauz : « Mon rôle d’écrivain c’est de fabriquer l’abîme intellectuel dans lequel les gens vont se sentir à l’aise et penser le monde de l’autre. »
Vous savez aussi vous glisser avec talent dans la tête d’une adolescente. Comment avez-vous trouvé le ton juste pour vos biographies d’artistes Vus par une ado ?
Lorsque nous avons commencé la collection 100% Bio avec l’éditrice, Manon Sautreau, elle m’a demandé de penser une série de biographies « vivantes, accessibles aux ados, et pas barbantes », de faire « drôle » ! J’ai cherché, cherché, produits sept essais : ce n’était jamais assez marrant au goût de Manon. Je me suis alors mise devant un miroir et me suis raillée moi-même : « ma pauvre Cécile, tu es trop naze, même sur YouTube, on ne voudrait pas de toi plus de trente secondes. » L’idée était née : le narrateur est l’ado, raconte la bio d’un personnage célèbre à la 1ère personne (comme s’il tournait dans une vidéo YouTube), donne son avis, répond aux questions que pose le lecteur au moyen de bulles, nous confie des détails de sa propre existence…




Et justement, sur quels critères choisissez-vous les figures auxquelles vous consacrez ces documentaires ?
Le premier personnage, Léonard de Vinci, je l’ai choisi parce qu’il est le plus universel de tous et que je l’admire. Molière, parce que je l’adore (et l’admire également). Cléopâtre pour raconter la réalité d’une femme dont le pouvoir politique et l’intelligence ont souvent été dénigrés, méprisés… Picasso, l’éditrice me l’a « commandé »… Mais c’est moi qui ai proposé le sujet de mon prochain 100% Bio ! Il traitera d’une multitude de personnages qui ont donné leur voix à un formidable mouvement culturel et musical : le rap !
******
Mille mercis à Cécile pour sa gentillesse et ses sourires ! Vous pouvez retrouver son actualité sur son blog.
Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir de nouveaux titres de Cécile Alix, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. D’ailleurs, quel titre de cette auteure préférez-vous ?