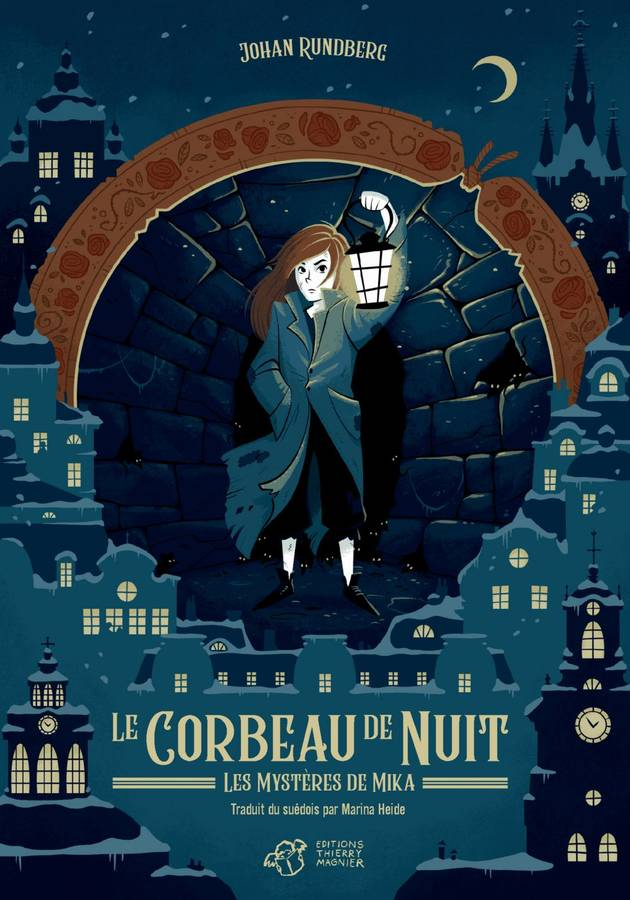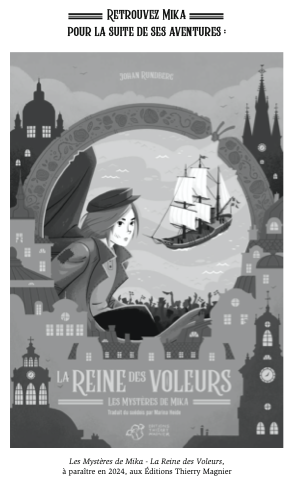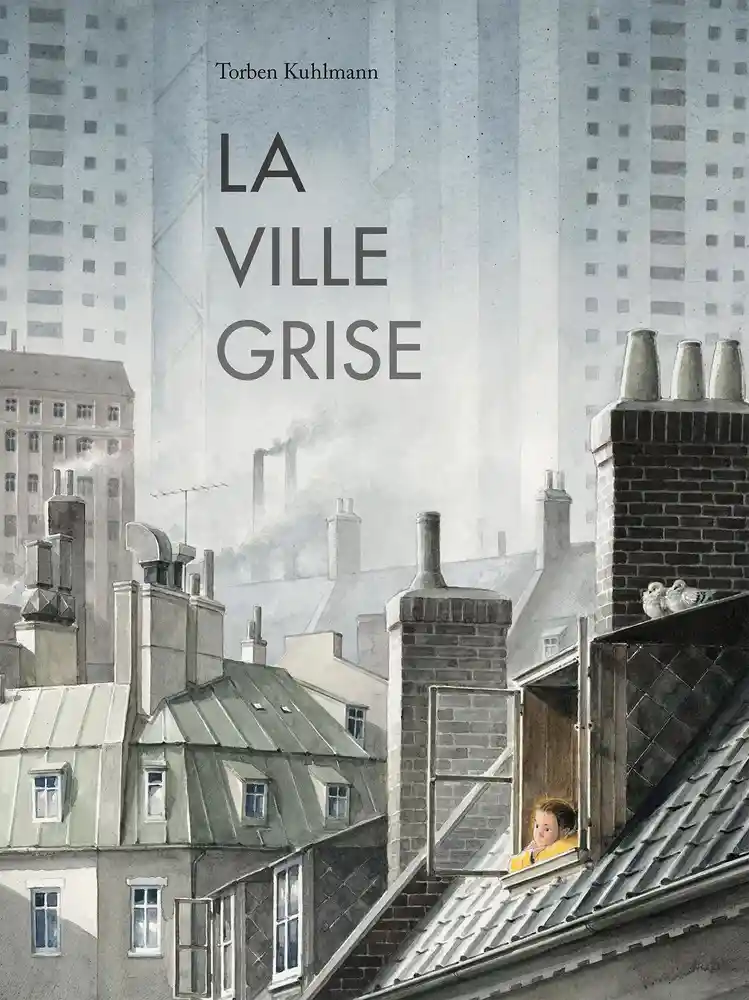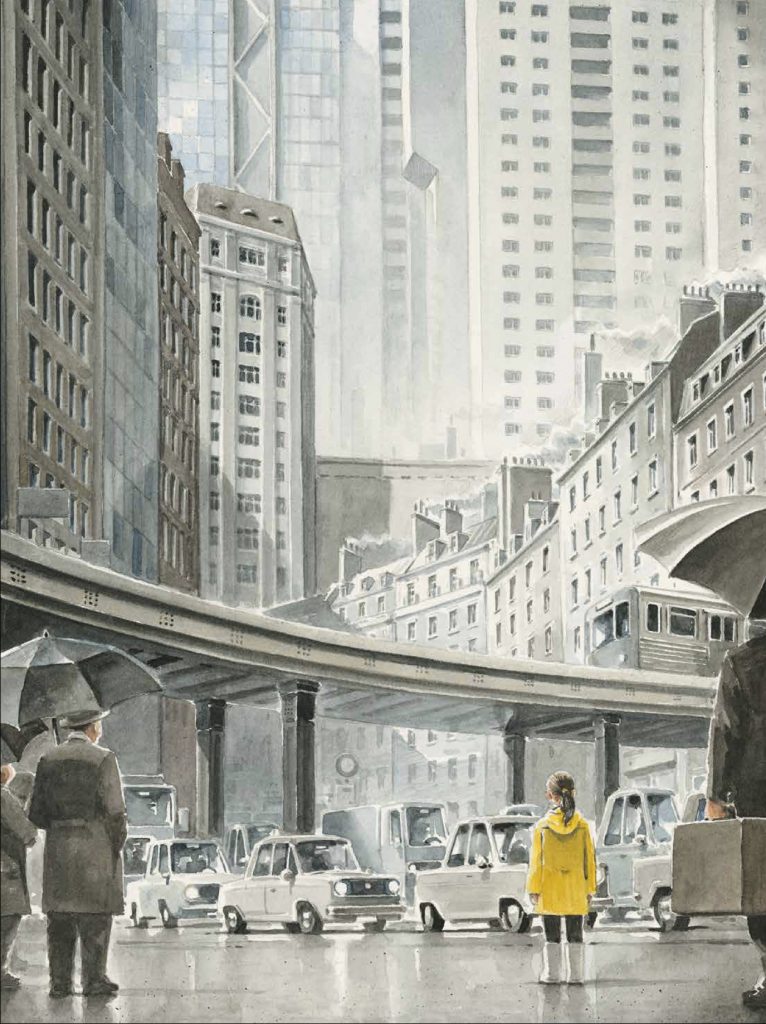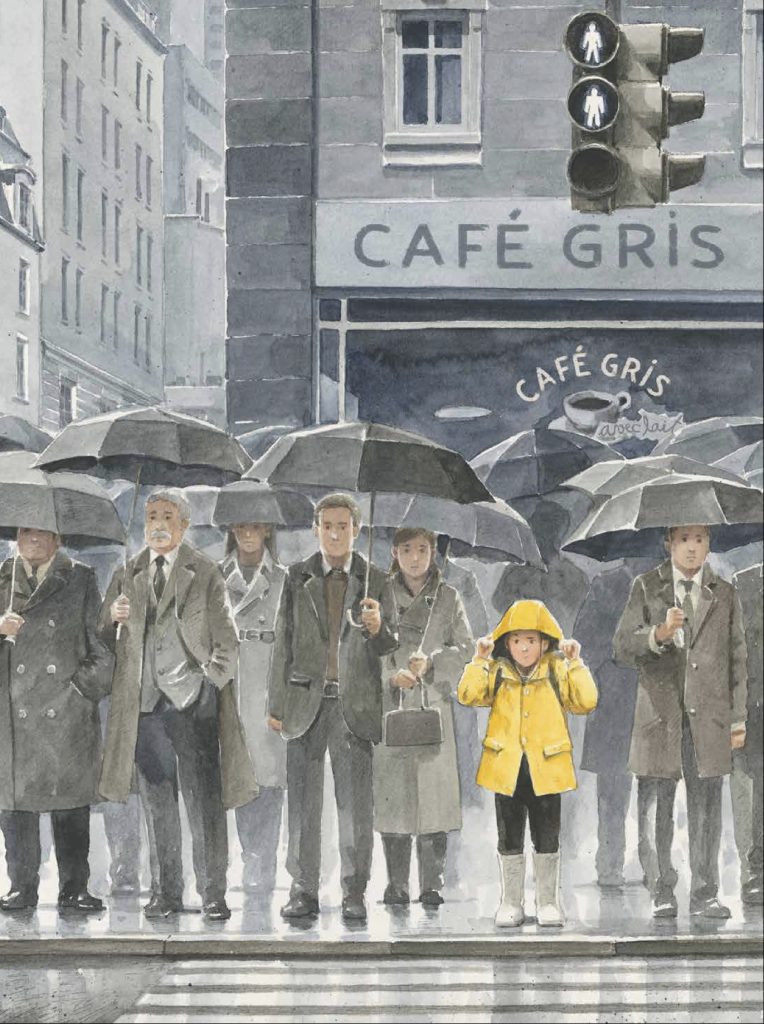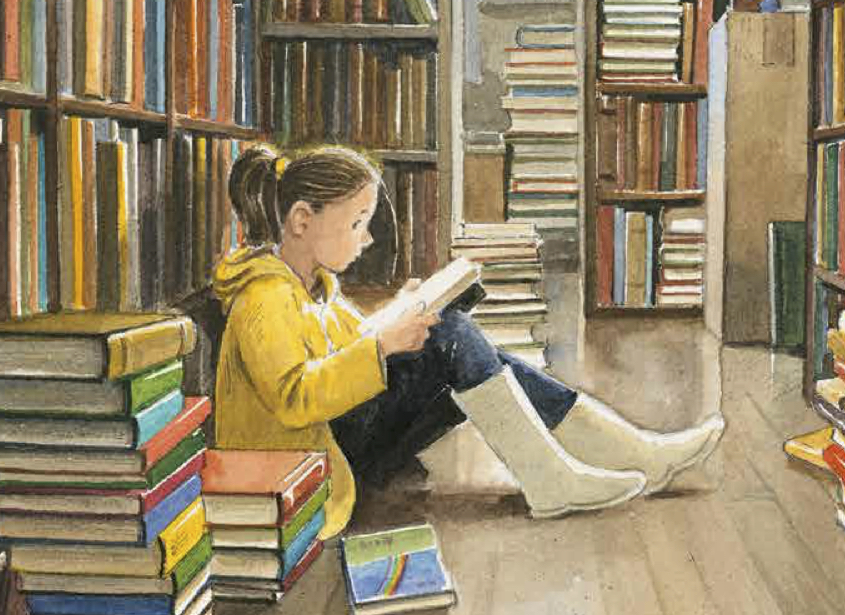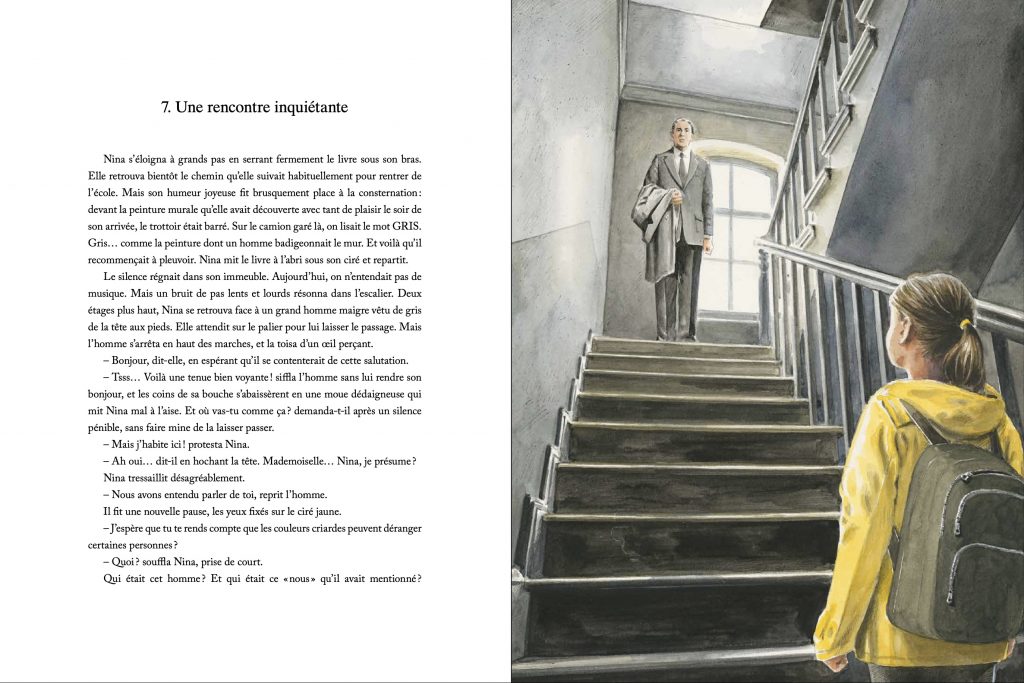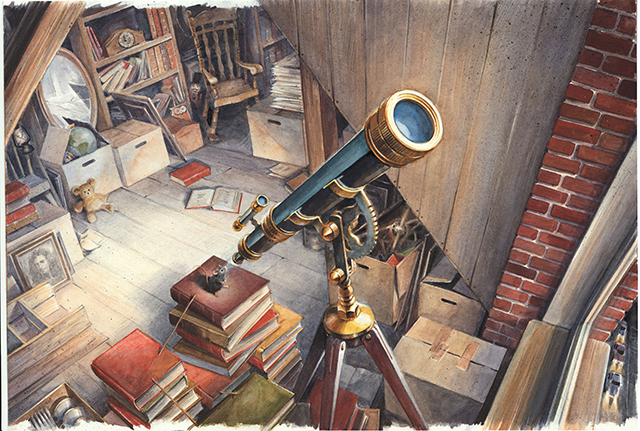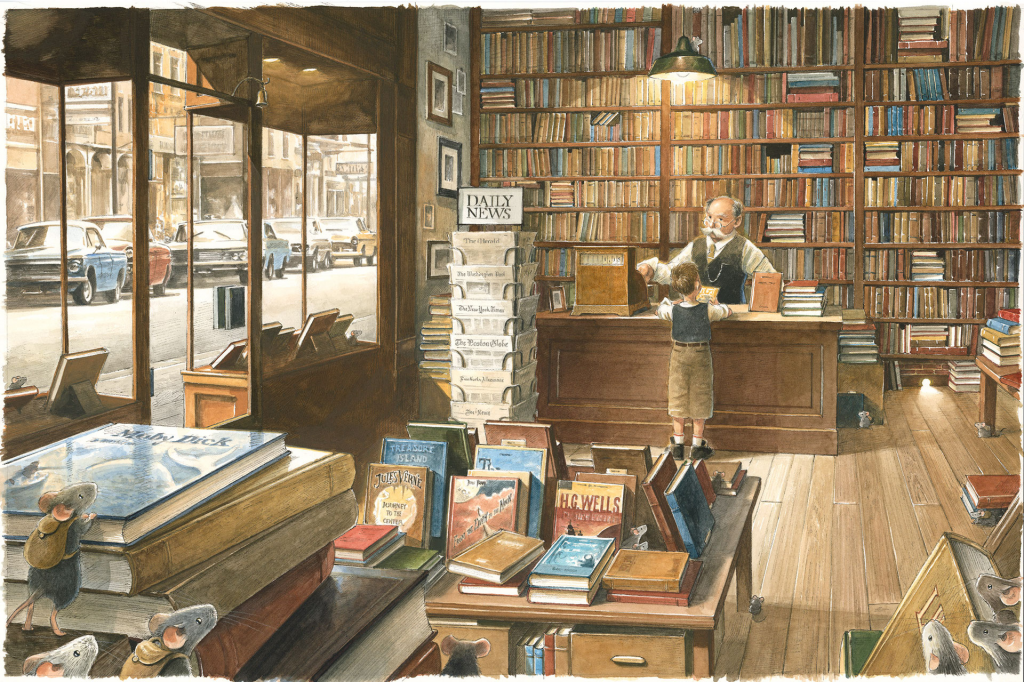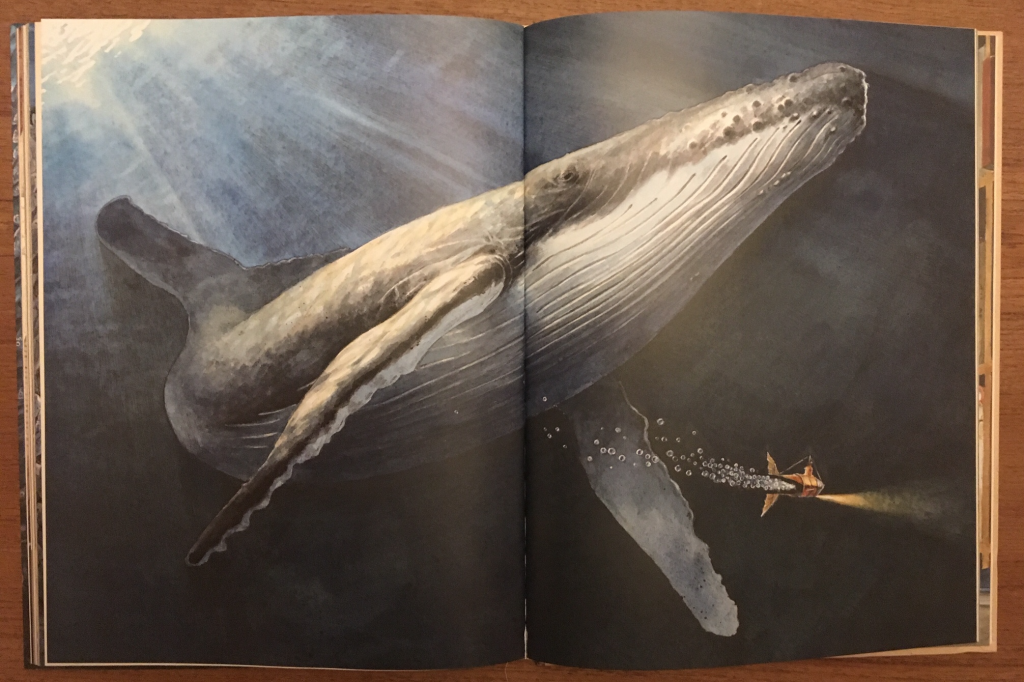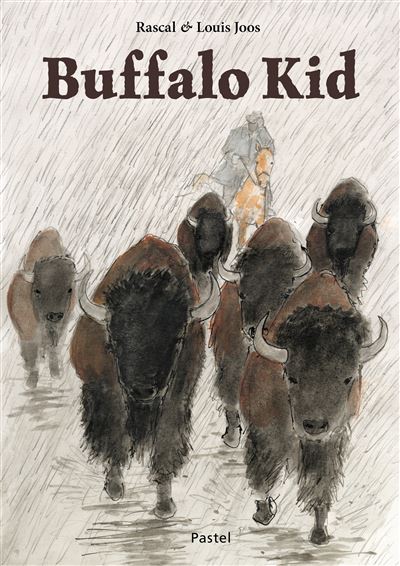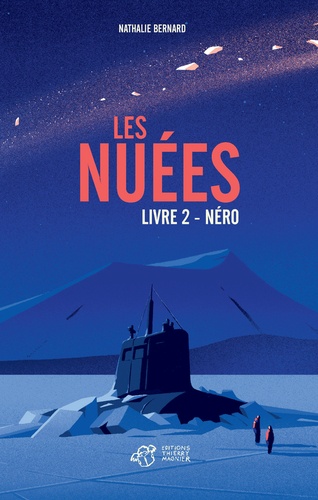Anne-Laure Bondoux est presque déjà une autrice classique en littérature jeunesse et ado. Lorsque son tout nouveau roman, Nous traverserons des orages, a reçu la pépite d’or du salon de Montreuil, nous avons eu envie non seulement de le lire mais de partager nos impressions ! Nous voilà donc dans la ferme des Chaumes, logis de la famille Balaguère qui porte mal son nom. Avec ses générations successives, nous allons traverser plus d’un siècle d’histoire, de 1914 à nos jours. Les pages se tournent, les temps changent avec les générations, mais la ferme des Chaumes est comme immuable et les Balaguère restent hantés par les mêmes démons : les chimères et l’abandon, les non-dits et la violence. Lecture commune !
******
Isabelle : Avant d’entrer dans le vif du sujet : aviez-vous déjà lu Anne-Laure Bondoux ? Sur quel registre la connaissiez-vous ? Le nom de l’autrice a-t-il joué un rôle dans votre envie de lire ce roman ?
Liraloin : Je connais cette autrice depuis un moment, mes collègues m’en parlaient souvent et il y a quelques années (environ 12 ans maintenant) j’ai lu ses romans. J’ai eu un véritable coup de cœur pour Tant que nous sommes vivants. En plus, l’autrice a été invitée dans une librairie de Toulon ! Quelle opportunité de pouvoir l’écouter parler de son livre et d’échanger (un peu) avec elle.
Lucie : Moi aussi, j’ai déjà lu plusieurs des romans d’Anne-Laure Bondoux (Tant que nous sommes vivants m’avait particulièrement plu aussi) et c’est une auteure que je suis avec plaisir.
Héloïse : Oui, j’avais déjà lu plusieurs romans d’Anne-Laure Bondoux, et j’avais particulièrement aimé L’aube sera grandiose, qui m’avait marqué à l’époque.
Linda : Je pensais ne pas l’avoir lu avant de retrouver dans mes archives un petit retour sur L’aube sera grandiose dont je ne garde absolument aucun souvenirs. Au vu de mes notes, cela ne m’avait pas vraiment plu et je ne comprenais pas l’engouement autour de ce roman à côté duquel j’étais passée. C’est la couverture qui m’a en premier lieu attirée ici, elle dégage une certaine sérénité avec son paysage campagnard et l’immensité de ce ciel si bleu.
Isabelle : Moi aussi, c’est l’un de ses textes que j’avais vraiment aimés ! On pourrait faire des parallèles avec celui dont il est question ce soir, on y reviendra peut-être ! Après, pour moi, ce n’est pas que le nom de l’autrice qui a piqué la curiosité mais aussi la pépite décernée à ce roman à Montreuil.
Héloïse: J’avoue que cela m’a donné envie de le lire encore plus rapidement aussi.
Lucie : Oui, ce prix est tout de même gage de qualité !
« Entre ces deux époques, tu verras vivre ici quatre générations d’une famille tourmentée par des secrets et hantée par des morts sans sépulture.
Entre ces deux époques, nous traverserons des « orages. Tu verras se répéter des conflits, des accidents, des abandons et des coups de couteau. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu assisteras plusieurs fois à la fin du monde et au début d’un autre. »
Isabelle : Ce livre s’ouvre sur un prologue qui offre en quelque sorte un écrin au récit qui va suivre. Qu’en avez-vous tiré ? En avez-vous immédiatement saisi toutes les dimensions ou êtes-vous retournées le lire plus tard, voire à la fin du roman ?
Héloïse : Le prologue m’a particulièrement intriguée, mais oui, je n’en ai saisi toute la richesse qu’à la fin…
Lucie : Le tutoiement en début de roman m’a interpellée. Je me suis tout d’abord demandé qui était Saule pour complètement l’oublier jusqu’à la fin du roman. Donc, non, je n’avais pas du tout anticipé toutes les dimensions du roman et oui, je suis retournée lire ce prologue une fois ma lecture achevée.
Isabelle : Moi pareil ! Je l’ai lu sans tout comprendre, puis j’y suis revenue plus tard et j’ai réalisé tout ce qu’il livre sur ce qui va suivre. C’est un roman qui va parler d’histoire avec un petit « h » quand il s’agit de la famille Balaguère et d’un grand « H » puisque l’on va remonter tout le vingtième siècle. Le cadre du récit est posé, la ferme des Chaumes. Mais c’est aussi un récit adressé à quelqu’un qui s’appelle Saule, dans un but bien précis : déjouer ce qui pourrait être perçu comme une malédiction qui se répète depuis déjà trop de générations. Et ce, par le pouvoir des mots.
Liraloin : C’est assez étrange comme sentiment car ce prologue peut être interprété comme un testament et en même temps il y a cette lueur d’espoir qui réside dans la transmission. Le retrouver à la fin, quand la boucle est bouclée, est un soulagement.
Linda : Comme Lucie c’est le tutoiement qui m’a interpellée au début. Je n’ai pas forcément saisie tout ce que ce prologue voulait nous dire, forcément, mais quand on arrive au bout du récit, on comprend combien l’auteure nous avait déjà préparé, tout comme Saule, à ce qui allait suivre, à ce qui nous serait raconté.
« Seul dans la chaleur de juillet, Marty traverse la cour de la ferme. L’après-midi tire à sa fin, et pas un souffle d’air sur les Chaumes. On entend bourdonner les mouches, tinter les cloches des vaches dans le champ d’à côté, le grincement d’une poulie quelque part, et le cœur de Marty qui tape dans sa poitrine. »
Isabelle : Ensuite, énorme bond dans le temps, n’est-ce pas ? Quelqu’un a-t-elle envie de raconter un peu comme elle s’est immergée dans l’histoire des Balaguère ?
Héloïse : J’avoue que je ne savais pas trop à quoi m’attendre en commençant ce roman. Il y a un côté tragédie grecque dans cette fatalité, cette famille maudite et cette violence qui règne… et en même temps, sans réellement s’attacher aux personnages, on a envie de savoir où tout cela va mener ! Le mélange histoire familiale et “grande” Histoire est savamment dosé. C’est un récit puissant, qui met du temps à se construire, et qui est tellement riche !
Lucie : Je me suis laissée emporter dans la famille Balaguère, sans me poser de questions. J’ai d’ailleurs été surprise de lire ce roman aussi vite. Vu le nombre de pages et sa forte teneur en intensité et en tragédies, je pensais que cette lecture me prendrait plus de temps. Mais il faut dire que comme Héloïse j’ai beaucoup apprécié le mélange entre la « petite » et la grande histoire.
Linda : En effet, le roman se lit d’une traite, assez facilement malgré sa densité qui tient certes dans le nombre de pages mais aussi dans son contenu car on y balaie l’Histoire de 1914 à aujourd’hui ce qui représente tellement… Et comme vous le dites, ce mélange entre la petite et la grande histoire font la richesse du récit. C’est en tout cas un aspect que j’ai vraiment apprécié en ce qui me concerne.
Liraloin : Et oui 1914 ! on se dit que l’Histoire va être très présente dans ce roman. Je ne sais pas mais j’ai beaucoup pensé à ma mère car elle adore Pierre Lemaître et je me suis dit « en voilà un roman qui traite de la saga familiale à travers le temps. » C’est venu de suite et ne m’a pas quitté toute le long de ma lecture, spectatrice de drames vécus par une famille un jour en France.
Isabelle : C’est drôle que tu parles de Pierre Lemaître, j’ai aussi pensé à cet auteur. À Ken Follett, aussi, qui tisse comme ça des sagas historiques à partir de la perspectives de plusieurs membres d’une famille.
Liraloin : Pour ma part et on en avait un peu parlé avec Linda, j’ai trouvé que le ton était distant comme si A-L Bondoux relatait des faits et bien évidemment avec cette immersion qu’on lui connaît. Une saga familiale c’est tout de même un autre genre très différent de ses autres romans même si avec l’Aube sera grandiose nous avons été accompagnées par une mère et sa fille.
Isabelle : C’est intéressant que tu parles de L’aube sera grandiose parce que pour ma part, j’ai fait pas mal de parallèles. Dans les deux cas, on a une histoire familiale avec un enjeu d’arriver à dire à la génération suivante ce qui s’est passé pour sortir d’un schéma. Ici, c’est une transmission père-fils (sur plusieurs générations), dans L’aube sera grandiose, c’est une transmission mère-fille. Quoi qu’il en soit, et j’ai l’impression que ça a été pareil pour toi, je ne me suis pas tout de suite sentie à l’aise. J’étais un peu perturbée qu’on soit en 1914 mais que le récit soit rédigé au présent. J’avais du mal à trouver mes repères, les lampions et les musettes, la chanson Viens poupoule chantée par Anzême à Clairette, tout ça ne me parlait pas du tout. Et j’ai eu du mal à m’identifier aux personnages, au départ la perspective de Marty est très importante et ce personnage simple d’esprit est vraiment difficile à cerner.
Lucie : C’est vrai, Marty est un personnage très particulier. Et dans le même temps, ce côté « au bord de l’abîme » met une tension immédiate, on sent un drame arriver sans savoir vraiment ce qui va survenir.
Liraloin : Complétement d’accord avec vous, ce personnage met le/la lectrice/lecteur mal à l’aise (mon fils me disait mais il est vraiment bizarre lui…)
Linda : C’est clairement le personnage qui m’a le plus dérangé dans le récit. Dès le départ il met mal à l’aise et semble n’exister que pour nous préparer aux drames qui vont suivre.
Isabelle : Justement, à propos de Marty, il faut bien qu’on en parle, je pense, il y a cette scène qui pourrait être un viol mais qui ne dit pas son nom. Comment l’avez-vous perçue ?
Liraloin : C’est terrible car on sait et cela dès le début qu’un malheur va arriver. Le départ d’Anzême n’est qu’un prétexte pour que ce personnage se laisse complètement aller. Clairette n’est plus « protégée » donc elle n’est plus « respectable ».
Isabelle : Ça t’a paru clair, le fait que c’est un viol qui se produit ? Moi ça m’a mise très mal à l’aise que les choses soient décrites mais de manière ambiguë, sans dire les choses (ça a fait partie de ma perplexité, voire de mon malaise au début de ce roman).
Liraloin : je pense que l’autrice a voulu justement créer ce malaise car à cette époque on ne dit pas les choses.
Isabelle : Pour aller dans ton sens, je me suis dit ensuite qu’il s’agissait bien d’un viol mais que dans cette narration très ancrée dans le présent de l’époque et la perspective des personnages, Anne-Laure Bondoux avait restitué un viol comme on l’aurait fait à l’époque. Sans le nommer.
Linda : Même s’il n’est pas nommé, l’acte est clairement un viol et il est décrit comme tel puisque Marty dit bien que son frère lui a dit que ce qui est à l’un est à l’autre. Il s’approprie donc sa femme sans se poser de question, laissant juste son désir prendre le dessus, s’imposant à Clairette qui finit par accepter l’inacceptable, impuissante devant ce monstre qui croit avoir trouvé le paradis entre ses bras…
Lucie : Cette scène m’a mise mal à l’aise, parce que Clairette ne semble pas consentante au début. Mais il n’y a pas de violence à proprement parler et j’ai eu l’impression qu’elle se laissait faire, un peu comme si elle était consciente de l’effet qu’elle faisait à Marty et qu’elle lui permettait d’assouvir une pulsion longtemps réfrénée. La promiscuité décrite (Marty entend son frère et sa femme faire l’amour dans la chambre à côté de la sienne) est assez malsaine elle aussi. Toute cette partie m’a semblé être une cocotte-minute prête à exploser, et finalement cette action va modifier un équilibre qui était extrêmement précaire.
Isabelle : Pour moi il y a violence, mais elle est restituée du point de vue de Marty, donc d’une manière biaisée: il est écrit : « Il ne reste que le désir de Marty, cette flamme dévorante qui l’aveugle et qui pousse Clairette, une main sur la bouche, vers le foin de la grange. » Et plus loin « ce corps qui a cessé de résister et qui s’offre désormais à ses caresses, sans un mot, sans un bruit. »
Héloïse : Moi aussi, cette scène m’a mise mal à l’aise. Et justement, cette phrase, « ce corps qui a cessé de résister » … On comprend bien que c’est un viol. On sent le drame arriver, et c’est horrible d’y assister, on ressent de l’impuissance, comme une résignation de la part de Clairette, on voit à quel point les femmes étaient impuissantes à l’époque.
Lucie : C’est effectivement le point de vue d’un homme porté sur l’action d’un homme, ce qui modifie certainement le ressenti du personnage. Mais ensuite, ces rapports deviennent récurrents et je n’ai pas eu l’impression qu’ils pesaient à Clairette. (Peut-être est-ce dû au fait que ma lecture commence à remonter un peu ?) Le côté « nature » de l’affaire : “j’ai des besoins, toi aussi, assouvissions les ensemble” a pris le dessus pour moi.
« Car il n’y a pas de super-héros dans notre histoire. Seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d’exprimer ce qu’ils ont au fond d’eux-mêmes, se taisent et exercent la violence à leur tour, comme enfermés dans une malédiction. »
Isabelle : Ça ne va pas être facile de rendre compte d’un roman aussi riche en quelques mots et sans trop en dire, peut-être pourrions nous aborder cette matière en parlant de la manière dont il est écrit ? Au début, on est plongé dans le vif du sujet, puis on se rend compte que le récit suit une certaine trame. Laquelle ?
Liraloin : La trame est un parti pris pour que l’Histoire, qui a toujours son mot à dire, vienne se mêler aux personnages fictifs. En réalité pas si fictifs que ça car les malheurs vécus par les Balaguère existent. C’est tout cette finesse d’écriture qui est appréciable !
Lucie : La trame est clairement chronologique, et d’ailleurs Anne-Laure Bondoux fait des intermèdes pour résumer ce qui a pu se passer entre certains événements touchant la famille Balaguère. C’est précisément ce qui m’a intéressée : elle ne prend pas clairement le parti de la transmission de la violence, celle-ci peut aussi venir de la société et des drames vécus par les hommes de ces générations.
Héloïse : Oui, chaque personnage est « ancré » dans une époque, vit des événements de la grande Histoire, y participe, contraint et forcé. Et ces évènements vont les marquer, et marquer indirectement les générations suivantes. On perçoit bien l’horreur de la guerre et les séquelles indélébiles qu’elle laisse.
Linda : Oui, comme le dit Lucie, Anne-Laure Bondoux ne prend pas parti de la transmission de la violence. J’y ai plutôt perçu un questionnement sur son origine entre inné ou acquis. Et si on perçoit parfois que la violence est présente en nous, elle interroge son expression au regard de nos actions mais surtout de notre vécu. Les guerres et autres combats sociétaux impactent fortement chacun d’entre eux, d’entre nous.
Isabelle : Je me retrouve dans ce que vous dites : aucun des Balaguère (ce nom !) n’est une personne foncièrement mauvaise ou violente à la base mais chaque génération va se retrouver prise en étau dans un climat de violence structurelle.
Liraloin : Exactement ! Et les dégâts subis à cause des guerres mondiales sont considérables.
Lucie : Je me suis d’ailleurs demandé si vous aviez un personnage préféré parmi tous ceux que nous croisons dans cette fresque ?
Héloïse : Je n’ai pas vraiment de personnage préféré, mais Aloès m’a touchée. Olivier aussi d’ailleurs. C’est étrange, mais plus j’entrais dans ma lecture, et plus les personnages me touchaient.
Liraloin : J’ai été moi aussi beaucoup marquée par le personnage d’Aloès. Cette sensibilité juste après les ravages des deux guerres ! Et pourtant rien n’est facile pour lui car il est impacté également par un autre conflit…
Isabelle : Comme vous, je pense spontanément à Aloès. Mais je pense que c’est son fils Olivier qui m’a finalement le plus touchée. Comme pour Héloïse, les émotions sont allées croissantes au fil des pages, comme si je parvenais mieux à m’identifier à des personnages avec qui je partage des souvenirs – et peut-être aussi dont je pouvais palper l’histoire familiale.
Linda : Aloès bien sûr, mais surtout Olivier. Comme vous, plus on se rapproche de notre époque, plus il m’a été facile de m’identifier et de me sentir proche des personnages. Ce qui me fait penser que j’aurais probablement aimé Saule…
Liraloin : Oui je crois que c’est aussi parce que leurs maux sont plus proches de notre société actuelle, je sais pas …
Héloïse : C’est probable !
Lucie : J’avais oublié le nom de Clairette, les personnages qui vous ont le plus touchées sont des hommes, et ça me semble assez symptomatique : les femmes sont très en retrait de l’histoire. Cela vous a-t-il gênées ?
Liraloin : Oui et non. Je ne suis pas complètement d’accord avec toi. Par la force des choses elles se taisent mais prennent une place importante comme Gaby qui finalement s’écoute et ne peut que se résigner à une vie à la campagne.
Héloïse : Je me suis fait la même réflexion que toi Lucie, et puis j’ai réalisé qu’indirectement, elles jouaient un rôle aussi… Je pense à Christiane notamment.
Isabelle : Elles sont même souvent au centre des pensées des protagonistes masculins ! En fait, le récit est centré sur une lignée masculine mais ça n’empêche pas qu’il y ait de beaux personnages de femmes, celui de la petite sœur d’Ariane et celui de la mère d’Olivier qui cherche à toutes forces à s’émanciper à une époque qui n’est pas encore prête.
Linda : Je rejoins les autres. Les femmes ont clairement un rôle à jouer et sont au cœur de l’histoire. Elles portent en elle la force qui parfois fait défaut aux hommes, supportant leurs violence, portant leurs erreurs, leurs secrets… mais pas comme un fardeau, plutôt comme l’espoir d’un avenir meilleur pour elles toutes.
Lucie : La famille Balaguère a pour tradition de donner à ses garçon des prénoms d’arbres. Que vous a inspiré cette idée ?
Liraloin : Intéressante question ! le choix des noms d’arbres. Chaque homme est racine en cette terre des Chaumes, comme si il devait y revenir !
Isabelle : ça m’a intriguée les noms d’arbre comme prénoms mais je n’ai pas trop su quoi en faire. C’était l’un des nombreux fils conducteurs de cette histoire familiale, l’une des choses qui se répètent.
Héloïse : les noms d’arbres comme symboles de vie ? Ou plutôt un symbole de l’enracinement, nos racines qui nous construisent ?
Lucie : Je pensais à l’enracinement moi aussi. Que ce soit positif dans le sens savoir d’où l’on vient, à la pérennité, mais aussi l’aspect négatif qui donne l’impression de ne pas pouvoir se défaire de ce que l’on nous a transmis.
Linda : Oui c’est clairement signe de l’enracinement !
Isabelle : Mais oui, vous avez raison !
Isabelle : Je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais pour ma part, une fois passée ma perplexité initiale, j’ai dévoré ce livre en quelques heures. Avez-vous aussi trouvé que c’était un livre qui se lisait d’un trait ? Qu’est-ce qui met sous tension cette histoire ?
Liraloin : On ne peut pas lâcher ce roman, j’ai été complètement absorbée par cette histoire, quelle drôle d’impression ! Cette tension vient des personnages masculins essentiellement, on se demande : « Mince !! Il y en a au moins un qui va s’en sortir ? » Attention je ne cherchais pas le happy end mais un apaisement.
Héloïse : Oui, c’est très un roman très addictif ! Une fois passé le malaise initial, difficile de le lâcher. Pour ma part, j’avais hâte de savoir comment cette histoire allait se terminer, et oui, j’espérais une fin pas trop malheureuse !
Linda : C’est un roman très facile à lire, très addictif, une fois passée la situation initiale avec Marty… C’est ce qu’on disait plus haut, la narration est intéressante et bien construite. J’y trouve même une certaine harmonie dans le rythme répétitif des événements que vivent les personnages, à grande échelle ou à un niveau plus personnel.
Lucie : En effet, moi aussi j’ai été vraiment surprise de le lire si vite. Une fois le malaise de la situation triangulaire Anzême-Clairette-Marty passé, je pense que comme on rencontre les personnages enfants et que l’on sait des choses qu’ils ne savent pas mais qui peuvent avoir des conséquences sur leur avenir, on a envie de les accompagner et de découvrir de quelle manière ils vont se dépêtrer (ou pas) de la situation. Comme Liraloin j’avais vraiment envie de tomber sur celui qui parviendrait à mettre un terme à cette violence.
Isabelle : C’est vrai que l’on entre dans l’existence de chacun, ses soucis, ses inquiétudes, sa quête de bonheur, les difficultés qui se posent, c’est très prenant. Mais il y a aussi, au fur et à mesure, que l’on approche du moment où le récit sera bouclé, les questions sur qui raconte cette histoire, à qui et pourquoi.
« En ce milieu des années soixante, alors que le président John F. Kennedy s’est fait assassiner, que les États-Unis commencent à bombarder le Vietnam, que des scientifiques évaluent les effets bénéfiques du LSD sur les troubles mentaux et que la contre-culture hippie se diffuse largement depuis San Francisco en proposant de faire l’amour plutôt que la guerre, les Français sont partagés entre l’envie de tout changer et celle, inverse, de ne rien changer du tout. »
Isabelle : Anne-Laure Bondoux brasse une densité assez incroyable de faits historiques dans son roman : guerres mondiales, guerre d’Algérie, épidémie de SIDA, drame de Tchernobyl – et on pourrait citer encore mille et un faits si on pense aux passages en italique qui ponctuent le récit et parlent de la montée des autoritarismes et de la grande dépression, du front populaire, de la drôle de guerre ou, après-guerre, du mouvement des droits civiques aux États-Unis ou de mai 1968. Est-ce que de votre point de vue cette fresque historique enrichit l’intrigue ? Faut-il à votre avis avoir étudié tout ça en classe pour pouvoir apprécier le roman ?
Héloïse : En grande passionnée d’histoire, cette succession de faits historiques m’a beaucoup parlé. Mais je ne sais pas s’il est nécessaire de tout connaître pour vraiment apprécier l’intrigue, justement parce que nous découvrons tous ces événements par le prisme de personnes, d’individus.
Liraloin : Cette chronologie met du rythme dans l’intrigue car elle est un repère pour le lectorat. Après une collègue m’a fait un retour intéressant sur son écriture qu’elle a jugé trop impactée par les événements historiques. La magie n’opère pas comme dans la relation mère-fille (Aube sera grandiose) et c’est bien normal car le thème ici est vraiment la violence. Je ne pense pas qu’il faille avoir des connaissances historiques, nous sommes sur un roman sociétal.
Isabelle : Moi non plus, je ne pense pas que c’est gênant de ne pas avoir toutes les références, le roman se lit vraiment très facilement. Après je ne suis pas sûre que les passages en italiques qui passent en revue vraiment à toute vitesse des suites d’événements soient très utiles à la narration.
Lucie : Pour moi la raison d’être de ces passages est justement de pouvoir suivre l’histoire de la famille sans être gêné par les informations qui nous manqueraient. Je suis d’accord avec vous, il n’est pas nécessaire de les connaître pour saisir les enjeux qui touchent nos héros. Après, si les jeunes lecteurs ont envie de se renseigner sur certaines d’entre eux, c’est super ! Ils signifient aussi (peut-être) qu’elle a choisi d’intégrer ces faits historiques mais qu’il y en a eu tellement d’autres, qui ont touché de nombreuses autres familles.
Linda : Oui comme Lucie je trouve que ces événements cités en italique permettent de suivre l’histoire, ils montrent aussi que la vie continue pour tout le monde, même quand on est pris par ses problèmes personnels. Mais je vous rejoins complètement, inutile de connaître tous ces événements pour en apprécier la lecture. J’ai même trouvé intéressant certains faits dont je connaissais peu de choses, comme la Guerre d’Algérie dont on ne nous parle pas dans les programmes scolaires alors qu’il y a tant à en dire. Cela est venu aussi attiser ma curiosité et m’a donné envie de lire d’avantage sur le sujet.
Isabelle : Avez-vous envie de faire lire ce roman autour de vous ? À qui ?
Liraloin : Mais oui ! Je l’ai déjà conseillé … Après c’est un roman qui va rencontrer son public, c’est certain, mais pas forcément chez les ados.
Héloïse : Moi aussi, j’ai déjà prévu de le prêter ou de le conseiller à plusieurs personnes ! Effectivement, Liraloin, c’est un roman qui conviendra tout autant à des adultes ! Comme beaucoup de titres d’Anne-Laure Bondoux en fait.
Liraloin : Tout à fait, d’ailleurs ses romans sont empruntés par le public adulte. Comme Timothée de Fombelle ou Clémentine Beauvais, ces autrices-auteurs possèdent une écriture tout public.
Lucie : Comme vous je pense plus spontanément à des adultes, ou en tout cas à des lecteurs très confirmés. Parce que la violence et les drames sont très présents. Ce n’est pas une lecture facile ou agréable. Même si elle est très intéressante et qu’elle m’a poursuivie un bon moment après avoir refermé le livre.
Liraloin : Je suis d’accord avec toi Lucie, on est un peu hantée par les personnages et cette violence, cette peur de pleurer pour un homme ! C’est terrible !
Lucie : Oui, et (j’y reviens) la place des femmes ! Tout n’est pas réglé mais on mesure tout de même les avancées de la société. En à peine un siècle, quels progrès sur ces questions !
Linda : Oui, je l’ai recommandé à une amie qui devrait apprécié ainsi qu’à l’une de mes filles qui aime l’Histoire et les romans qui abordent la place des femmes. Je pense que celui-ci devrait lui permettre de constater l’évolution de nos droits. Elle s’indigne facilement des classiques qui mettent les femmes aux fourneaux, aussi je crois que lire le combat mené jusqu’à aujourd’hui avec les victoires qui l’accompagnent devrait lui plaire. Et je la laisse libre de se faire une opinion mais je sais qu’il plaira à sa meilleure amie.
Isabelle : Pour finir, si on parlait du futur dans le titre ? C’est un autre point commun avec L’aube sera grandiose dont on parlait toute à l’heure. Cela m’a laissé un drôle de sentiment. Est-ce quelque chose à laquelle vous avez réfléchi aussi ?
Liraloin : Non je n’ai pas réfléchi à cette question mais merci ! Est-ce qu’on peut dire que rien n’est figé dans le passé et qu’il fait continuer décennie après décennie ?
Héloïse : Pour L’aube sera grandiose, j’y voyais un certain optimisme, la célébration d’un après, d’un mieux à venir. Là, je ne sais pas du tout… Comme une célébration de la vie peut-être, faite d’orages, mais aussi d’accalmies…
Lucie : Je ne sais pas si on peut vraiment en parler sans divulgâcher, mais la comme ça je me dis que le futur de ce titre a peut-être un rapport avec ce prologue dont nous parlions au début de cette discussion. La promesse du narrateur à son destinataire ? (je n’en dis pas trop ?) Mais je suis aussi tout à fait d’accord avec vos interprétations qui me semblent hyper pertinentes.
Isabelle : C’est intéressant ce que tu dis Héloïse sur l’usage réconfortant du futur dans L’aube sera grandiose. Ce serait presque l’inverse ici. Je me suis aussi demandé si Anne-Laure Bondoux ne nous invite pas à réfléchir à la manière dont nous absorberons les orages à venir ? En même temps, la phrase le dit, nous les traverserons, ces orages, comme d’autres avant nous en ont traversé aussi ?
Héloïse : Oui, dit comme ça, c’est aussi une marque d’optimisme !
Et vous, avez-vous lu Nous traverserons des orages ? Ce texte a-t-il résonné différemment chez vous ? Si vous ne le connaissez pas encore, nous espérons que nos échanges vous auront donné envie de le découvrir !