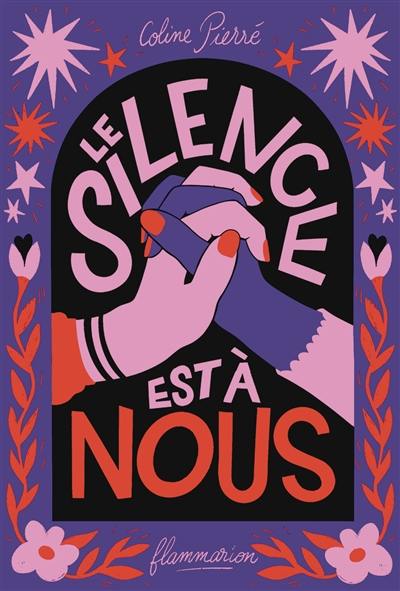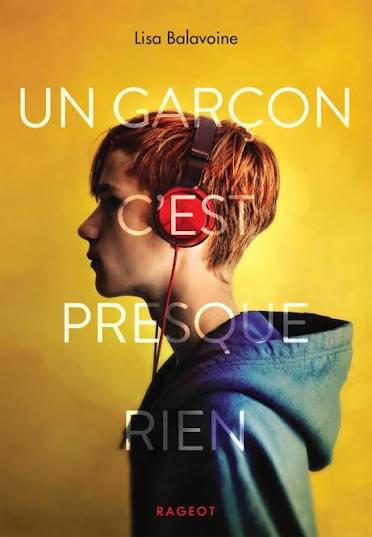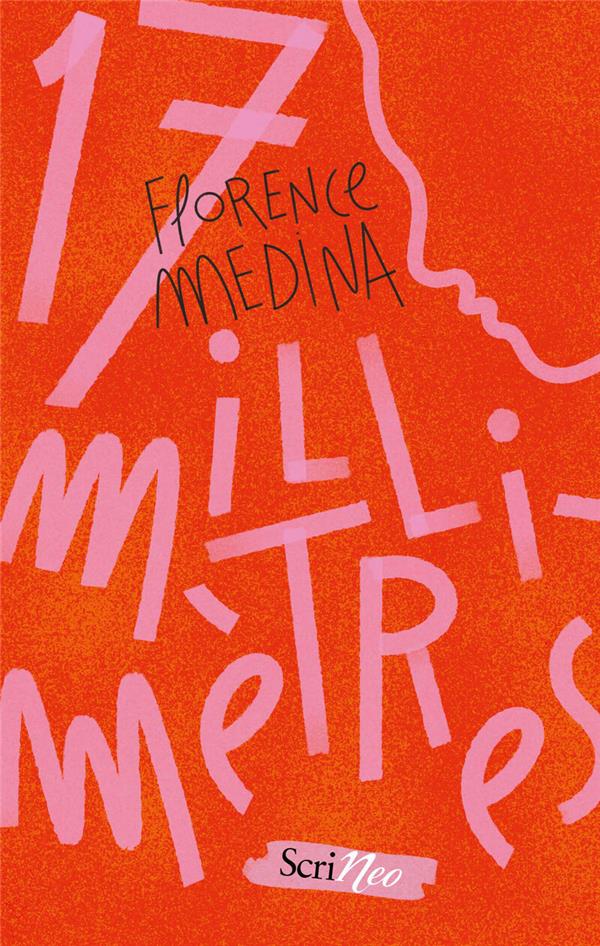Aujourd’hui sur le blog, Lucie, Héloïse et Hélène vous proposent une lecture commune d’un des grands succès de l’année en roman ado, il s’agit du titre « Le silence est à nous » de Coline Pierré. Lauréat du Prix Vendredi des lecteurs du Pass culture, il a déjà rencontré son public et nous étions curieuses de le découvrir et ravies de pouvoir enfin vous en parler.
Paru en mai dernier aux éditions Flammarion, ce titre très actuel nous transporte dans un lycée où Léo est témoin involontaire d’une agression sexuelle.
Suite à cela elle cherche comment se positionner, quoi faire, et grâce à ses amis, ensemble, ils trouvent un moyen de résister, de dénoncer la situation de manière originale et finalement de faire avancer les mentalités.
Plongez avec nous dans ce roman très actuel qui donne la parole (si l’on peut dire cela ainsi…) à la génération post me-too.
*
Lucie : Connaissiez-vous le travail de Coline Pierré avant de lire ce roman ?
Héloïse : Pas beaucoup en fait ! J’ai lu et beaucoup aimé Ma fugue chez moi, mais c’est tout… Mais j’aime beaucoup les textes en vers libres, et le résumé de celui-ci m’intriguait !
Hélène : J’avais lu moi aussi il y a plusieurs années Ma fugue chez moi. Et toi Lucie ?
Lucie : Je n’avais pas fait le lien avant de regarder sa bibliographie mais j’en avais lu deux : La révolte des animaux moches et Nos mains en l’air qui n’ont pas grand chose à voir avec ce titre d’après mes souvenirs.
Lucie : L’illustration de couverture vous a-t-elle inspirées ?
Hélène : Pour ma part j’ai découvert ce livre lors du festival “un chapitre à Rouen” consacré à la littérature young adult. Dans ce cadre j’ai eu la chance de rencontrer Coline Pierré qui nous en a parlé. Le livre était là et la couverture m’a beaucoup plu : ces deux mains de couleurs différentes et qui se tiennent traduit bien une idée qui est développée dans le roman, celle de la solidarité.
Héloïse : Le rose n’est pas ma couleur préférée, mais ces deux mains qui se joignent, ça, j’aime ! Ça matérialise bien la solidarité oui !
Hélène : Oui, et puis la forme dans laquelle elles sont fait penser à une petite porte, l’idée qu’on va voir ce qui est caché. Enfin !
Héloïse : Et toi Lucie ?
Lucie : A vrai dire je ne l’aime pas trop. Et sans la suggestion de Séverine j’aurais bien pu passer à côté de ce roman juste à cause du graphisme et des couleurs. Ça aurait quand même été dommage !
Héloïse : Comme quoi… Il ne faut pas se fier aux apparences 🙂
Lucie : En effet ! Ça m’apprendra ! Poursuivons si vous le voulez bien avec la forme du roman. Les romans en vers libres sont de plus en plus fréquents en littérature ado, en aviez-vous déjà lu et que pensez-vous de ce choix ?
Héloïse : C’est un style que j’aime beaucoup. C’est à la fois poétique, à vif, intense. J’avais découvert le style avec Inséparables, de Sarah Crossan, puis lu l’excellent Un garçon, c’est presque rien, de Lisa Balavoine, qui m’avait énormément marquée. Je trouve que ça “casse un peu les codes”, le rythme, la diction.
Lucie : Je suis d’accord avec toi, je trouve que ce choix va très bien au roman adolescent, quand il est bien réalisé. Le premier que j’ai lu était La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, mais le plus marquant dans ce genre est sans aucun doute 17 millimètres de Florence Medina que j’ai lu comme en apnée.
Héloïse : Oh oui, 17 millimètres, quelle lecture ! il est court, mais intense effectivement, et très émouvant aussi.
Hélène : Pour ma part je n’avais jamais lu un livre écrit sous cette forme. C’était particulier mais je me suis habituée au fur et à mesure de la lecture. Coline Pierré a indiqué qu’elle a choisi cette forme car elle laisse “physiquement” de la place au silence. Les pages sont aussi plus “aérées”, ce qui facilite l’entrée dans ce “gros” livre.
Lucie : C’est intéressant Hélène cette idée de laisser une place au silence. Et ça fait totalement sens vu le sujet ! Ici Coline Pierré utilise les vers libres mais joue aussi sur le rythme, les sonorités et les répétitions… Loin d’être un effet de mode, le parti pris est ici pleinement assumé et investi.
Héloïse : Ce silence justement, on en parle ? A quoi vous attendiez-vous avec ce titre ?
Hélène : Pour ma part, j’ai assisté à la rencontre avant de lire le livre donc je connaissais le sujet. J’étais curieuse de découvrir ce livre qui avait beaucoup plu à de nombreux lecteurs, et de voir la manière dont il était traité, sous l’angle du silence.
Héloïse : Moi non, j’essaie de ne pas lire les résumés en quatrième de couverture pour ne plus risquer de divulgâcher l’histoire. Je savais juste qu’on y parlait féminisme et sororité, et que des amies avaient adoré. Mais je ne savais pas du tout à quoi correspondait ce silence.
Lucie : Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre mais j’avais un a priori positif car les coups de cœur de Séverine sont souvent de bons indices. J’imaginais une histoire de filles avec la couverture, probablement un drame que l’on tairait, mais pas grand chose de plus. C’est sur que choisir le silence comme thématique d’un roman, c’est plutôt gonflé ! On a vu qu’il tenait une place dans les choix stylistiques de l’auteure mais qu’avez-vous pensé de l’histoire ? Est-ce que l’une d’entre vous souhaite la résumer pour commencer ?
Héloïse : Pas facile, mais j’essaie. Une jeune fille, Leo, assiste à une agression dans son lycée. Maryam, une jeune camarade solaire, est plaquée contre un mur par Ethan, et clairement pas consentante. Sous le choc, Leo ne dit ni ne fait rien. Mais ensuite, elle contacte la victime. Sauf que quand celle-ci rapporte l’agression, personne ne l’écoute… Ce que j’ai trouvé horrible. On se rend compte aussi avec cette lecture que la société n’écoute pas forcément les victimes, à plus forte raison si elles sont en couple …
Lucie : Oui, la notion de consentement est vraiment au cœur de ce récit. Et effectivement Coline Pierré interroge la réception de la parole des victimes de manière très intéressante.
Héloïse : C’est l’une des revendications d’ailleurs des “manifestants silencieux” (je ne sais pas comment les appeler) c’est parlant comme ça je trouve.
Hélène : Oui la question de dire et d’entendre est au cœur du livre. D’après ce que l’auteure expliquait, les scènes avec le proviseur ont été parmi les plus difficiles à écrire car il fallait complexifier ce personnage qui n’entend pas, même s’il reçoit la victime et ses amies et les écoute, en apparence du moins…
Héloïse : C’est un personnage clairement détestable…Contrairement à d’autres heureusement. D’ailleurs, j’ai apprécié l’idée que tous les adultes ne soient pas montrés du doigt.
Lucie : OUI ! Comme la génialissime documentaliste, Madame Lindgren !!! J’ai aimé que certains adultes, dont des hommes, soient positifs. Ce n’est pas si fréquent dans ce type de romans.
Héloïse : Oui, le CPE, M. Diaz, est top aussi ! Mais c’est révoltant de voir que la première réponse de la direction, c’est d’interdire des tenues jugées “osées”, pointant du doigt la victime et la transformant en coupable… C’est d’ailleurs la raison de la fameuse grève lancée dans le roman (attention spoilers pour celleux qui ne l’ont pas lu ! )? J’ai trouvé cette idée de grève de la parole géniale et originale, pas vous ?
Lucie : Mais si, totalement ! C’est une idée intéressante car on ne peut pas forcer quelqu’un à parler, que la parole libérée est au cœur de l’élément perturbateur et que l’on pousse les ados à s’exprimer tout en rechignant à les écouter, j’ai trouvé ce passage très juste. Et j’irais jusqu’à dire qu’il m’a questionnée en tant que maman. Malgré toute notre bonne volonté, est-ce qu’on écoute nos enfants aussi attentivement qu’on le devrait ?
Héloïse : C’est une réflexion intéressante, je n’en suis pas sûre malheureusement…
Lucie : Léo est donc l’héroïne de ce roman et elle serait la première surprise de se voir qualifiée ainsi. Qu’avez-vous pensé de ce personnage ?
Héloïse : C’est un personnage extrêmement touchant. Elle est très mal dans sa peau, dans son corps, s’excuse presque de respirer parfois… Elle a peur de mal faire, et pourtant, c’est elle qui instille la révolte, le combat.
Hélène : Oui c’est un personnage attachant, un peu au mauvais endroit au mauvais moment et qui se trouve confrontée à une situation qui la force à se positionner, à être fidèle à ses valeurs à un âge auquel on se construit. Elle fait cela avec beaucoup de pudeur et de délicatesse, et un peu de maladresse parfois, ce qui la rend réaliste aussi.
Lucie : Oui, ce personnage est très en retrait dans sa vie mais elle a de multiples facettes. Ses doutes et son mal être en font un personnage très nuancé et ont fortement résonné. Elle n’a pas du tout une personnalité de leader mais elle parvient à rassembler grâce à sa bonne volonté. J’ai juste regretté une annonce dans la dernière partie qui m’a semblé assez artificielle. Elle n’avait pas besoin de cela pour être intéressante !
Hélène : Je te rejoins !
Héloïse : La question traditionnelle pour terminer : à qui conseilleriez-vous ce roman ?
Héloïse : Aux ados, bien sûr, à partir de 13-14 ans, et aux adultes. La thématique principale est malheureusement toujours d’actualité, et c’est important de montrer que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas à minimiser.
Lucie : Bien sûr, aux ados, je te rejoins sur les âges : pas trop tôt à cause des thématiques. Et à leurs parents aussi, car il est susceptible d’amener des discussions. C’est un roman très riche qui parle de consentement, de santé mentale, d’engagement aussi… mais sans que ces sujets ne soient trop lourds ou appuyés, ils sont très bien intégrés à l’intrigue et invitent à la réflexion de manière assez subtile. Ce n’est clairement pas le cas de tous les titres de la sélection du Prix Vendredi pour ne citer qu’eux.
Hélène : Je le conseillerai effectivement à des lycéens, pour tout public même s’il plaira sans doute plus aux jeunes femmes de par son aspect féministe, mais cela peut être une lecture très instructive pour de jeunes garçons aussi !
*
Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir ce roman qui figurait dans la sélection du Prix Vendredi et a été élu par les lecteurs du Pass Culture !