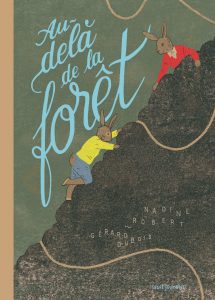Fin janvier, Gaël Aymon répondait à nos questions de curieuses arbronautes. Linda, Lucie et Liraloin se sont empressées de lire son roman l’Apprenti conteur paru dans la collection Neuf aux éditions de l’Ecole des Loisirs en avril 2022 et de partager leurs impressions.
******
Linda : Avant de commencer, j’aurais aimé savoir ce qui vous a poussé à lire ce livre et à le proposer en lecture commune ?
Liraloin : C’est drôle que tu me poses cette question car c’est Colette qui a suggéré de faire une LC du dernier roman de Gaël Aymon, j’ai juste répondu que l’idée était bonne et j’ai lu le roman. C’est aussi simple que cela. Après, j’avais bien aimé son titre Et ta vie m’appartiendra donc c’était l’occasion de lire un autre roman de cet auteur.
Lucie : C’est effectivement Colette qui a proposé cette lecture commune suite à l’interview de Gaël Aymon. J’avoue que j’aime assez qu’un entretien ne soit pas publié comme ça, mais accompagné soit d’une lecture commune comme nous l’avons fait avec Annie au milieu d’Émilie Chazerand ou un article sur les « classiques » comme pour François Place. Cela nous permet d’explorer l’œuvre de l’auteur de manière plus attentive et de profiter à fond de cette opportunité (que je trouve toujours merveilleuse !) de poser nos questions à un auteur.

Et ta vie m’appartiendra de Gaël Aymon, Nathan, 2020. 
Silent Boy de Gaël Aymon, Nathan, 2020.
Liraloin à Linda: J’ai vu que tu en avais fait une chronique pourquoi as-tu été attirée par ce roman ?
Linda : Je ne connaissais que Silent Boy de Gaël Aymon et suite à son interview, j’étais curieuse de le lire autrement. La couverture, particulièrement sombre m’a interrogée et en lisant le synopsis je pensais lire une réécriture de conte, un format que j’apprécie beaucoup. Je n’ai pas hésité un instant.
Connaissiez-vous déjà l’hypothèse qui veut que les contes de la Mère l’Oye aient été écrits par Pierre Darmancour, le fils de Charles Perrault ?
Lucie : Je ne connaissais pas du tout cette théorie, et je ne sais pas vraiment quoi en penser. Mais dramatiquement, dans le roman, je l’ai trouvée intéressante.
Liraloin : Mais pas du tout ! Ca été une surprise pour moi si bien que je suis allée chercher des informations car je pensais que c’était pure fiction et invention de l’auteur. J’avoue n’être pas très experte en histoire et origines des contes. Finalement j’en lis peu alors que j’adore les écouter ! Et toi, as-tu été surprise également ?
Linda : J’ai aussi fait une recherche sur ce sujet à la fin de ma lecture. Je pensais vraiment que l’auteur s’était amusé à inventer tout ça pour placer son récit dans un cadre mystérieux. Donc oui, une vraie surprise et une lecture qu’on repense autrement après coup. J’ai trouvé toute cette histoire assez fascinante au final, d’autant que le mystère autour de cette affaire ne semble pas complètement résolu.
Gaël Aymon a choisi le versant sombre des contes pour raconter son histoire, mêlant le récit au genre fantastique. Qu’avez-vous pensé de ce choix ? Et quelles émotions vous a procuré la lecture ?
Liraloin : Quelle belle idée ! A travers des chapitres courts et bien rythmés le lecteur se prend au jeu. A chaque instant et durant toute ma lecture je me suis demandée si Pierre ne rêvait pas inlassablement, me procurant un étrange sentiment. L’effet fantastique fonctionne très bien car Gaël Aymon prend le parti de dérouler son histoire dans une atmosphère glauque et toujours de nuit.
Là encore je retrouve les effets cinématographiques dont l’auteur nous parle dans son interview. Le moment le plus fort est celui où Pierre et Mariette entrent dans la forêt brumeuse, j’y ai vu des références à Tim Burton dans Sleepy Hollow. L’émotion y est forte !
Lucie : En effet, les choix de Gaël Aymon sont de l’ordre du fantastique, et parfois assez noirs. Je ne m’attendais pas à ça mais après tout les contes traditionnels sont tout de même très sombres entre abandons d’enfant et méchants qui veulent les dévorer (ogres, loups, sorcières…), il y a quand même beaucoup de noirceur !
Linda : L’écriture est très visuelle dans ce récit et cela m’a vraiment permis de m’immerger dans l’histoire de Pierre. J’ai donc souvent été surprise, presque perdue quant aux perceptions de ce monde aux contours assez flous. On est en effet en perpétuel questionnement sur les limites du réel. Comme tu le dis, Liraloin, les événements ont toujours lieu la nuit, ce qui renforce l’incrédulité du moment. Pierre rêve-t-il ? mais dormait-il vraiment au début de la scène ? C’est assez déstabilisant, d’autant que lorsqu’il revient dans la réalité, il semble toujours sortir du sommeil mais en même temps son esprit et son corps semblent avoir vécus et ressentis les événements fantastiques… C’est une vraie réussite !
Liraloin : Qu’est-ce qui vous a attiré dans la couverture ? Que pensez-vous des dessins de Siegfried de Turckheim ? Connaissiez-vous cet illustrateur ?
Lucie : Je ne connaissais pas le travail de Siegfried de Turckheim mais il m’a beaucoup plu et je suis allée chercher ce qu’il avait fait d’autre. Je trouve que son trait correspond parfaitement à l’univers créé par Gaël Aymon, qui a effectivement quelque chose de Tim Burton, en tout cas dans ce roman.
Linda : Je ne connaissais pas non plus Siegfried de Turckheim et, comme Lucie, je suis allée chercher ce qu’il a fait d’autres. Je suis assez curieuse d’écouter sa musique d’ailleurs. Mais pour rester sur le dessin, j’aime beaucoup son style et le choix de se limiter au noir et blanc, ce qui appuie la noirceur du récit et vient aussi renforcer l’effet mystérieux des lieux et personnages dont il ne dévoile à chaque fois que quelques traits. Cela vient, au même titre que le texte, titiller la curiosité et encourager à poursuivre la lecture. J’aime beaucoup l’association de son univers à celui de Gaël Aymon, il y a une forme de cohérence entre les deux qui crée une vraie unité.
Liraloin : Qu’avez-vous pensé du Prologue?
Linda : J’ai adoré le ton accrocheur de l’auteur qui s’adresse à son lecteur « Toi ! Oui, toi qui viens d’ouvrir ce livre ! » avant de nous expliquer où il nous entraîne et comment il compte bien nous perdre entre réalités et mensonges. Ça donne clairement envie de découvrir ce qu’il va nous raconter et si tous ces mystères vont réellement nous faire tourner la tête.
Lucie : Comme Linda, j’ai bien aimé que l’auteur annonce jouer avec la vérité et assume de manipuler son lecteur.
Ces façons d’interpeller le lecteur qui cassent d’une certaine manière le quatrième mur sont risquées, il arrive qu’elles me fassent sortir du roman. Mais quand c’est bien fait, cela peut être un ressort narratif très intéressant.
Liraloin : J’ai trouvé ce prologue intéressant car il plonge le lecteur dans l’histoire, c’est une introduction qui appartient à l’oralité, le conteur prévient le spectateur et l’interpelle sur la dangerosité de l’histoire qui s’ouvre devant lui mais je suis d’accord avec Lucie, il faut savoir le mesurer pour ne pas « gêner » le lecteur.
Revenons sur le caractère fantastique du roman et sur l’enchaînement des évènements :
Je te cite Linda : « L’Apprenti conteur va bien au-delà du conte de fées et flirte avec le fantastique en plongeant son personnage principal dans un monde chimérique qui le fait douter des limites de son imagination, poussant également le lecteur à s’interroger sur la frontière entre le réel et l’imaginaire, et sur l’existence d’une vie après la mort. » Est-ce que vous avez éprouvé ce même sentiment ? Ce sentiment d’osciller entre le rêve et la réalité ? Et où se trouve la réalité justement ?
Linda : Complètement oui. A la lecture j’ai ressenti beaucoup de choses (plus ou moins agréables), mais j’ai vraiment été déstabilisée par cette impression floue qui ne permet jamais de savoir si Pierre est éveillé ou s’il rêve. C’est quelque chose que l’auteur maîtrise parfaitement, nous étions prévenus et il a parfaitement réussi à flouter les limites réalité/rêve. La réalité n’est pas vraiment déterminée, ce qui est certain est que lorsque Pierre est dans la maison de son oncle, lorsqu’il écrit, il est dans la réalité. Pour ce qui est du reste…
Lucie : Heureusement, cela finit par être éclairci au cours du roman. J’avoue qu’au début Gaël Aymon ayant beaucoup situé les passages fantastiques la nuit, j’avais un peu peur que cela tourne au « tout ceci n’était qu’un rêve » qui m’aurait vraiment déçue. Car, comme le dit Linda, les seuls éléments clairement situés dans la réalité sont les interactions de Pierre avec son oncle.
Je vous rejoins sur la frontière floue entre réel et fantastique qui s’avère finalement très maîtrisée !
Liraloin : Gaël Aymon reprend des éléments que l’on retrouve dans les contes de ma Mère l’Oye, d’après-vous, comment font-ils avancer l’histoire ?
Lucie : Chaque conte correspond à une péripétie. Cela m’a d’ailleurs paru un peu systématique à un moment donné. C’est aussi ludique, comme un jeu de piste dans les contes populaires. J’étais chaque fois curieuse de découvrir auquel Gaël Aymon allait-il faire référence.
Mais heureusement, l’intrigue ne se limite pas à cela et prend ensuite de l’ampleur en se concentre plus sur l’histoire personnelle de Pierre et son rapport à Mariette.
Linda : Il me semble que ces objets, à l’inverse de Mariette, viennent appuyer le basculement dans l’irréalité du moment. Ils jouent d’une certaine façon le rôle de « porte », permettant de basculer d’un monde à l’autre. Un rôle que je questionne d’ailleurs beaucoup car, j’ai souvent eu l’impression que la maison servait également de passage.
Liraloin : Vos réponses sont intéressantes et d’ailleurs, j’ai eu les mêmes impressions que vous et j’ai trouvé cet exercice (éléments tirés des contes) bien fait car comme tu le dis Lucie, cela ne dénature pas le récit. N’oublions pas la relation très particulière entre Mariette et Pierre mais nous y reviendrons (sans divulgâcher bien évidemment).

LiraLoin : Que pensez-vous de la rencontre entre Pierre et Mariette ? Comment leur relation fait évoluer l’histoire ?
Lucie : Pour moi, Mariette est le lien entre la réalité et le monde magique. C’est aussi elle qui fait le lien entre Pierre et les histoires orales. C’est donc un personnage à la fois essentiel et très énigmatique. Si j’ai rapidement compris sa différence, la révélation sur son identité a été une surprise !
J’ai beaucoup aimé qu’ils cherchent à se protéger l’un l’autre et la dynamique de leur relation.
Linda : Mariette se présente à Pierre au cœur de la nuit et dans l’intimité de sa chambre. Ce n’est pas anodin et permet de comprendre qu’elle est « différente », comme si elle n’était visible que de Pierre. Comme Lucie, j’ai été surprise par la révélation de son identité même si je commençais à penser, dans un petit coin de ma tête, que son attachement à Pierre et sa façon de le protéger la faisait ressembler à ce qu’elle est.
Pensez-vous que la maison fait le lien entre les deux mondes, ainsi qu’entre les deux enfants ? Ou est-ce cet attachement entre Pierre et Mariette, qui donne ce pouvoir à la maison ?
Lucie : Je n’en ai aucune idée ! Et j’avoue ne pas avoir cherché à comprendre plus que ça. Si l’auteur parvient à m’entraîner dans l’univers qu’il a conçu, j’accepte le fantastique sans me poser de question. Mais comme tu poses la question, j’imagine que la maison a forcément un rôle, sinon Mariette aurait pu rendre visite à Pierre alors qu’il habitait à Paris. Mais Mariette a un rôle central de guide, de passeur malgré tout essentiel. Les deux sont liés, on s’en rend compte rapidement même si on ne sait pas vraiment de quelle manière !
Liraloin : Exactement, les deux mondes sont visibles seulement dans cette maison, vous avez raison. Le lien entre Mariette et Pierre est à la fois amical, amoureux et fraternel. On sent, dès le début, que Mariette est meneuse comme pour faire sortir Pierre de son « exercice d’écriture de poésie ». Je l’ai vu plutôt comme ça pour ma part, elle va le repousser dans ses retranchements et lui apprendre qu’un autre « monde » existe finalement.

Linda : Par ailleurs, lorsque l’on comprend qui est Mariette et d’où elle vient, sa présence fait-elle sens ? N’avez-vous pas vu une mise en danger du garçon ? Peut-on dire que la venue de Mariette ne soit motivée que par son désir de rencontrer Pierre ?
Lucie : C’est une bonne question : Y-a-t-il réellement mise en danger ? Il me semble que c’est explicité à un moment dans l’histoire mais je ne me souviens plus de ce qui est dit. S’il arrive quelque chose à Pierre dans le monde fantastique, y aura-t-il des conséquences dans la réalité ? Mariette joue alors un rôle de passeur mais aussi de protecteur. Elle explique les règles qui régissent ce monde, qui sont étrangères à Pierre et le conseille dans certaines situations.
La présence de Mariette s’explique quand on comprend qui elle est, mais le lien avec le monde fantastique ne m’a pas forcément semblé plus clair. Et ce n’est pas grave, je n’ai pas besoin que l’on m’explique tout pour être emportée !
Liraloin : Je pense aussi que Mariette emporte Pierre là où il ne serait jamais allé tout seul. Elle est à la fois aventurière et un guide rassurant.
Lucie : C’est finalement en découvrant le lieu où sa mère a grandi qu’e Pierre va en apprendre un peu plus sur elle. Qu’avez-vous pensé de cette idée ?
Linda : Il paraît logique que revenir sur les lieux qui ont vu grandir sa mère permette à Pierre d’en apprendre plus sur elle. Mais c’est la façon dont cela se fait qui est original puisqu’à aucun moment il ne va entrer en contact direct avec le souvenir de ce qu’elle fut lorsqu’elle vivait là. Il ne découvre pas qui elle était au travers de sa famille mais par le biais du fantastique.
Liraloin : Je dirais que la boucle est bouclée et que finalement Gaël Aymon sait entretenir le suspense jusqu’au bout de son histoire en ne perdant jamais l’essence même du fantastique.
*
Les avis de LiraLoin, Isabelle, Linda et Lucie.
*****
Nous espérons que cette lecture commune vous aura donné envie de vous procurer ce titre. Si vous appréciez le fantastique et les contes il vous plaira certainement. N’oubliez pas de nous dire en commentaire si vous l’avez aimé !