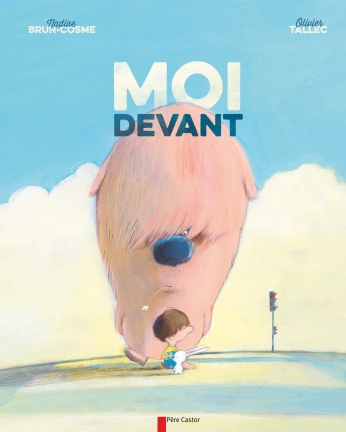Il y a des lectures qui font bruisser d’émotion toutes les branches de notre grand arbre ! Alma, le nouveau roman de Timothée de Fombelle, fait indéniablement partie de celles-là. Avant même sa sortie, nous brûlions de découvrir ce livre et après l’avoir dévoré et refermé, l’envie était là de prolonger la lecture en échangeant nos impressions…

Lucie : Cette couverture foisonnante, on en parle ? Que vous a-t-elle inspiré ?
Isabelle : Les illustrations plantent bien le décor. Elles ont quelque chose des gravures des livres anciens, non ? Et pourtant, les lettres orange du titre claquent, Alma trône sur cette couverture avec son arc tendu, le sous-titre annonce que le vent va se lever, les détails nous font pressentir l’ampleur des péripéties à venir !
Pépita : Tout à fait, un style désuet avec des dessins comme des vignettes-moments clés et Alma et sa détermination ! Les petits oiseaux dorés aussi, très symboliques ! Un vent d’aventures en une seule couverture.
Frédérique : Je n’ai pas trop fait attention à la couverture, je n’ai pas trop regardé de peur que les détails m’en dévoilent trop sur l’histoire… Comme pour un film, je ne lis jamais rien avant d’aller en voir. Ayant terminé la lecture, je m’y suis penchée et comme un bon album jeunesse : l’histoire commence avec la 1ere de couv ! Je m’en rend compte lorsque je ferme le livre et cela m’aide dans mon analyse pour faire la p’tite chronique qui suivra.
Lucie : J’aime bien l’idée de Frédérique de revenir à la couverture après la lecture pour y retrouver des indices. Mais je suis définitivement trop curieuse pour ça. La taille du roman, mes précédentes lectures de Timothée de Fombelle et ce foisonnement en couverture m’avaient placée dans l’attente d’une grande fresque d’aventures. Je partage ton avis Isabelle, le contraste entre ces « presque gravures » vertes et ce titre orange claque. On attend une certaine énergie, un tourbillon de péripéties. Je dois dire que j’ai été agréablement surprise de retrouver François Place pour les illustrations, et de constater dès la couverture que le tandem (et l’éditeur) prenaient le contre pied de la couverture (à juste titre) minimaliste de Tobie Lolness.
Lucie : Une fois n’est pas coutume chez Timothée de Fombelle, le roman s’ouvre dans un lieu paradisiaque, une sorte d’Éden protégé du reste du monde. On sent rapidement qu’une menace plane mais au début, tout est calme, idyllique. Vous souvenez-vous de ce que vous avez imaginé de cette famille et de son mode de vie, quand vous l’avez découverte ?
Frédérique : Je n’ai pas senti la menace comme toi, peut-être pour me protéger et savourer ce moment de pure quiétude familiale… Trop de naïveté sans doute, je voulais égoïstement me délecter de tous ces moments de bonheur. Un mode de vie proche de la nature, en osmose et surtout respectueuse de ce qu’elle offre. Des enfants aimants et aimés, joueurs et en même temps sérieux (surtout Alma très protectrice avec son frère). Une grande paix intérieure !
Pépita : J’ai adoré ce début, ce regard d’enfance sur le merveilleux, cette attention si particulière de Timothée de Fombelle aux moindres détails : la grande sœur qui guette les réactions de son frère, cette ombre de « zèbre » bienveillante, les dialogues si purs entre les deux enfants, la description de cet Éden. Du coup, j’ai éloigné la menace qui semble poindre en effet. Je n’ai voulu que le meilleur de ce moment magique. Et puis ce n’est que le début, je voyais bien que l’épaisseur du livre allait me faire vivre moult péripéties !
Isabelle : C’est drôle que tu poses la question, Lucie, c’est une réflexion que je me suis faite aussi en lisant ces pages : Timothée de Fombelle m’avait habituée à un démarrage sur les chapeaux des roues, au cœur de l’action et souvent au milieu de l’intrigue – les premières pages de Vango et de Tobie Lolness sont assez incroyables de ce point de vue ! Là, on voit tout de suite que c’est différent, une atmosphère de calme avant la tempête. Comme vous, j’ai été gagnée par la tendresse qui unit cette famille et par la beauté de l’écrin de nature où elle vit. Et soufflée par la poésie avec laquelle Timothée de Fombelle nous y entraîne : ses mots évoquent le grésillement des gouttes de pluie au contact de la terre brûlante, un figuier sycomore, le chant des cigales, et le décor semble prendre vie.
Lucie : Je suis tout à fait d’accord avec toi, Isabelle. J’ai une passion pour les descriptions de Timothée de Fombelle. En quelques mots choisis et souvent avec des images très poétiques il nous emporte dans un pays, un univers… C’est un talent dont je suis très admirative. Bizarrement, alors qu’ils sont en pleine nature, en lisant ce début de roman cela m’a renvoyée au confinement. Cette vallée coupée du monde, ce cocon familial central et toujours cette espèce de menace venue de l’extérieur… Les points communs m’ont sauté aux yeux.
Pépita : C’est un peintre des mots TDF ! Au contraire de toi, ce roman m’a procuré paradoxalement un immense vent de liberté dans ses premières pages. Je ne me lasse pas de la beauté de ce premier chapitre. Il renferme tout en fait. Déjà. C’est d’une beauté !
Frédérique : Je suis du même avis : un réel envoûtement, j’ai savouré ces premiers chapitres, tellement transportée par ce vent de liberté !
Lucie : Justement, cette liberté ouvre sur la suite, puisqu’elle permet au petit frère d’Alma de partir sans prévenir personne. J’ai trouvé très jolie cette idée d’une sœur qui invente un ailleurs pour faire rêver son petit frère, et lui qui y croit tellement fort qu’il veut le découvrir. Les parents ont une confiance absolue en leurs enfants. C’est très beau la manière dont la mère d’Alma, bien que consciente de ce qu’elle va trouver, la laisse partir à la recherche de son frère. Qu’en avez-vous pensé ?
Frédérique : Cette liberté est à son apogée dès le départ et se renforce avec l’intrépide Alma partant chercher son frère. Malgré eux, les parents d’Alma sont rattrapés par leur passé et ne veulent pas enfermer leur fille. Ils la laissent partir comme eux sont partis pour retrouver la liberté.
Isabelle : Il me semble clair qu’avec ce sujet de la liberté, vous mettez précisément le doigt sur le cœur de ce roman – c’était déjà le cas dans les livres précédents de l’auteur, mais ici plus encore. Le prénom Alma signifie « libre », dans le langage Oko inventé par Timothée de Fombelle qui précise : « ce genre de liberté n’existe dans aucune autre langue. C’est un mot rare, une liberté imprenable, une liberté qui remplit l’être pour toujours. Le père d’Alma raconte que chez lui, ce nom pourrait se dire ‘marquée au fer rouge de la liberté’. » Une liberté brandie par les protagonistes du roman face à l’horreur de l’esclavage. Pour revenir à ta question, je me dis que c’est peut-être parce qu’Alma a grandi ainsi qu’elle ne plie pas face à cette entreprise d’asservissement et en révèle tout l’arbitraire et toute l’absurdité.
Pépita : LIBERTÉ, oui, un thème fort à Timothée de Fombelle, qui traverse chacun de ses romans. Malgré l’esclavage et ses horreurs, cette liberté traverse tout ce premier tome. Malgré l’asservissement, il y a toujours un interstice pour la retrouver : les souvenirs, le chant, le cheval, des rencontres aidantes.
Isabelle : À ce propos, j’ai été très impressionnée par le travail historique et littéraire de Timothée de Fombelle qui évoque cet âge sombre de l’esclavage avec une rare justesse. On sent à la fois qu’il a réalisé un immense travail de documentation et qu’il « vit » cette histoire douloureuse avec les captifs entassés dans les navires, non ? Je trouve qu’Alma témoigne de façon remarquable de la capacité de la littérature et du romanesque à parler d’un sujet comme le commerce triangulaire. Qu’en pensez-vous ?
Pépita : Je te rejoins, Isabelle, sur la documentation de l’auteur. Il a dit que ce sujet le hantait depuis ses 13 ans quand en Guinée, il a ressenti cet appel de l’Histoire. Et il s’est fait cette promesse de la raconter. On le sent en effet très engagé et pour ma part, j’ai appris beaucoup, notamment que des noirs ont participé aussi à la servitude de leurs frères. Comme dans tout drame historique, la soif de pouvoir et la lâcheté qui va avec ressurgit toujours.
Lucie : C’est aussi à ce récit de la visite de l’auteur d’un de ces forts à l’adolescence que j’ai pensé en lisant la question d’Isabelle. Timothée de Fombelle dit clairement qu’il porte ce récit depuis lors, ce qui n’enlève rien à son travail de documentation. Et je te rejoins complètement sur cette thématique de la liberté qui traverse son œuvre. Moi aussi j’ai apprécié cette volonté de montrer que tout n’est pas noir ou blanc (dans la peau comme dans l’âme) et qu’il y a eu des noirs victimes et des bourreaux, comme des blancs inhumains et d’autres terriblement affectés par ce commerce triangulaire. Ne pas tomber dans le manichéisme était probablement l’écueil principal d’un roman sur l’esclavage. Même s’il y a de vrais méchants (encore qu’il nous reste deux tomes pour en savoir plus sur eux aussi), les personnages sont nuancés, ils sont tiraillés entre leurs objectifs et leur conscience et je trouve cela très riche. Je trouve aussi que de (bons !) romans sur ces sujets douloureux ne peuvent qu’aider au travail de mémoire. Se divertir tout en s’informant c’est vraiment le pouvoir de la littérature. Après, à chaque lecteur d’en faire ce qu’il veut…
Isabelle : Je trouve que vous mettez le doigt sur deux apports singuliers de la littérature pour parler du monde, de l’histoire et surtout de ses pages les plus sombres : la construction d’une intrigue placée sous tension vient chercher le lecteur qui tournera les pages de façon plus avide qu’en lisant un documentaire. Et le fait d’incarner cette histoire à travers des destins individuels nous touche, forcément, différemment.
C’est, je trouve, quelque chose qui marche très bien, ici, tant les personnages sont vivants et bien campés. Et il y en a une multitude qui évoluent dans une sorte de chassé-croisé : lesquels vous ont le plus marquées ? Les femmes sont sur le devant de la scène, non ?
Lucie : Mais oui, c’est vrai ! Les femmes ont souvent un vrai rôle chez Timothée de Fombelle et c’est encore le cas ici. Sur trois personnages « principaux », deux sont des filles. Et des forts caractères qui plus est. Entre Alma qui est la détermination incarnée et Amélie qui est si attachée à son éducation et à son indépendance, les femmes sont bien servies. J’aime aussi beaucoup le personnage de Mme de Lô, le « gouvernail » d’Amélie. J’espère qu’elle prendra encore de l’importance dans la suite. Je trouve Timothée de Fombelle toujours très efficace dans la caractérisation de ses personnages. En quelques phrases il esquisse une personnalité, des enjeux… Et je suis accrochée. Heureusement d’ailleurs, parce que comme il multiplie les personnages sans cela on serait rapidement perdus. Le père d’Alma est aussi très intéressant. Je ne veux rien divulgâcher mais Mosi / Moïse est d’une ambiguïté remarquable. Et sur la Douce Amélie, mes chouchous sont évidemment le trio Joseph Mars, Abel Bonhomme et Poussin qui oscillent sans cesse entre méfiance et complémentarité. Et vous ?
Pépita : J’ai aimé tous ces personnages ! Les femmes ont du caractère, et ça me plait. J’ai été immensément bouleversée par le chant de la maman d’Alma, j’ai même dû refermer le livre… Il y a toujours un côté merveilleux que TDF sait distiller et puis cette façon de ne jamais donner la totalité des facettes d’un personnage. Le lecteur attend donc, et là d’autant qu’il sait qu’il y a deux autres tomes qui arrivent. Ils sont incroyablement vivants, ces personnages : j’ai aimé aussi les différentes générations qui se croisent, se décroisent, vont-elles se retrouver ? C’est une aventure au sens large du terme et TDF a vraiment l’envergure pour mener sa barque… et son lecteur là où il veut. Le plus fort aussi, c’est qu’il arrive à « cacher » ce travail immense de documentation par une écriture si fluide avec des personnages très incarnés. Je vous rejoins donc totalement.
Isabelle : Oui, ces personnages incarnent l’histoire et nous la font vivre « de l’intérieur », mais ils nourrissent aussi l’intrigue. Lucie, tu parle du père d’Alma, je trouve qu’il n’est pas le seul qui semble avoir ses secrets, sa part d’ombre. Il y a plusieurs protagonistes dont je ne suis pas sûre de savoir quoi attendre – le charpentier Poussin par exemple, qui en sait manifestement long, Nao, la mère d’Alma qui semble cacher une telle force sous sa tranquillité. Ou même Amélie, fille d’esclavagiste, dont on ne sait pas si elle est menaçante ou menacée…
Pépita, tu évoque un côté merveilleux. Il y a de la poésie dans Alma, et même un peu de magie. Qu’en avez-vous pensé ?
Frédérique : Pour moi la poésie se retrouve dans la relation qu’Alma entretient avec ses parents. Elle est belle et à son apogée lorsque Nao partage ce chant évoquant la magie de son peuple. La magie de ce peuple éteint ou chaque personne possède un pouvoir. Je me demande comment TDF va exploiter ce détail ?
Lucie : La magie est essentielle dans les romans de Timothée de Fombelle, je le soupçonne d’ailleurs d’être passé à la littérature jeunesse justement pour avoir cette liberté là – les éléments merveilleux sont plus facilement acceptés dans les romans dits « jeunesse ». Il y a du merveilleux à plusieurs niveaux dans Alma : cette vallée de départ qui est idyllique, la rencontre des parents d’Alma, ces oiseaux, dont on ne connaît pas vraiment le rôle mais qui sont omniprésents autour des Okos et, évidemment, ces « traces ».
J’adore quand des indices sont semés avant qu’on ait des réponses : les chansons Nao, qu’Alma se mette à avoir un talent inné pour la chasse dès qu’elle quitte sa vallée, cette mousse qui pousse sous Soum ; et ensuite vient le récit de ces traces. La magie opère parce que ses effets font déjà partie de l’intrigue. Et puis la manifestation de ces talents est tellement poétique… J’adhère sans savoir où cela va nous mener ni comment cela va être utilisé, parce qu’un peu de magie enchante le quotidien et que celui d’Alma n’est pas rose !
Isabelle : Tout à fait. Cette part de magie, c’est peut-être ce qui permet par ailleurs de dire à de jeunes toute l’horreur qu’a été l’esclavage sans que cela ne devienne insupportable ? J’ai trouvé que c’était très bien dosé, Alma n’est pas un roman de fantasy ; pour moi, cette magie est plutôt celle des contes. Je l’ai perçue comme une façon de dire la force du courage, de l’entraide, de la dignité affirmée face aux oppresseurs. J’ai d’ailleurs lu quelque part que l’auteur s’était inspiré de faits documentés : on aurait laissé une captive chanter sur un navire négrier parce que on chant apaisait les velléités de révolte. Comme vous le dites, ces dons des Okos, qui restent à l’arrière-plan pour l’instant, contribuent aussi à nourrir notre curiosité.
Lucie : J’aime bien ton parallèle entre la magie des contes et celle d’Alma, c’est très bien vu ! Et cette hypothèse qu’elle permet de « faire passer » les atrocités de l’esclavage… Ça correspond tout à fait à la vision de l’imagination de J. K. Rowling dont je viens de terminer La meilleure des vies. Pour elle, c’est notre imagination qui nous permet de nous mettre à la place des autres bien que l’on n’ait pas traversé les mêmes épreuves, et donc qui nous permet de faire preuve d’empathie.
Pépita : J’ajouterais juste que l’échappée dans le merveilleux nous permet de mieux supporter l’horreur au sens où cela la met à distance. « Une des fonctions essentielles du conte est d’imposer une trêve au combat des hommes » (Daniel Pennac). TDF a une façon bien à lui de faire cohabiter le bien et le mal sans qu’ils s’opposent forcément. On le voit particulièrement avec les zones d’ombre de ses personnages. On est alors à la fois dans un roman historique et un parcours initiatique. Car ces personnages vont se révéler au lecteur mais aussi en même temps à eux-mêmes.
Isabelle : « Le vent se lève » n’est que la première pierre d’une trilogie. Une forme qui fait écho aux trois pôles du commerce triangulaire, mais qui exige de renouveler l’intrigue pour garder le lecteur sur plusieurs centaine de page. Qu’en avez-vous pensé ?
Pépita : Je ne suis pas allée au-delà du premier tome ! J’attends la suite car je sais qu’elle va nous surprendre bien au-delà de ce qu’on pourrait imaginer.
Lucie : Trois tomes pour trois continents, trois personnages (Alma bien sûr, mais aussi Joseph et Amélie) et probablement trois étapes : capture, esclavage et abolition. C’est comme ça que je l’imagine, mais je n’ai pas d’attente particulière pour l’intrigue. D’abord parce qu’il va falloir attendre encore un moment avant le deuxième et le troisième (!) tome. Et puis parce que j’aime tellement me laisser porter par les trouvailles et les détours de Timothée de Fombelle, qui va de toute façon toujours bien au delà de ce que je pourrais imaginer. Je ne trouve pas que ce premier tome ait un « ventre mou ». Il y a un moment un peu long sur le bateau, mais cela correspond bien à la durée et à la dureté du trajet, donc cela ne m’a pas gênée. Et toi, qu’en as-tu pensé ?
Isabelle : J’ai apprécié l’ampleur de cette fresque, il fallait probablement une trilogie pour y parvenir. L’histoire commence en 1786, trois ans avant la Révolution, je m’attends comme toi à de grands bouleversements que je brûle de découvrir.
Pépita : J’avais une petite question sur la forme : vous avez dû remarquer le petit « jeu » de l’auteur avec ses fins de chapitres et les noms des chapitres ? Vous en avez pensé quoi ?
Isabelle : C’est drôle que tu parles de ça, Pépita, j’y pensais aussi quand nous parlions de poésie. Quand nous avons lu Alma à voix haute, mon fils n’a pas mis deux chapitres à se rendre compte qu’effectivement, le titre de chaque chapitre correspond à ces derniers mots (j’aurais mis plus de temps à le remarquer sans lui, je pense !). Cela a nourri notre curiosité car on se demande souvent comment le chapitre en arrivera à ces mots-là !
Lucie : J’ai récemment lu Victoria rêve, et je me suis aperçue que Timothée de Fombelle y jouait déjà avec les derniers mots des chapitres utilisés en titre. Je trouve étonnant de voir comme ça fonctionne bien, à chaque fois. Comme toujours, je serai curieuse de savoir comment ça se passe « en cuisine » : ça semble simple et évident quand on le lit, mais ça demande certainement un travail complexe.
Isabelle : Pour conclure, j’avais envie de vous demander quelle émotion a prédominé chez vous à la lecture de ce roman…
Lucie : L’émotion qui a prédominé chez nous a été l’excitation. De retrouver Timothée de Fombelle pour un roman en plusieurs tomes tout d’abord (la lecture de Tobie Lolness était encore fraîche), et de découvrir sans cesse ce qu’il nous avait réservé dans le chapitre suivant. C’est vrai que ce jeu sur les titres crée une attente, mais elle est aussi alimentée par les changements de personnages qui nous laissent en suspens. En conséquence, les vacances aidant, on l’a lu en très peu de temps malgré le nombre de pages.
Pépita : L’émotion ? Mais il y en a tant ! Ce qui prédomine chez moi, et cela va vous paraitre paradoxal, c’est le sentiment de liberté. Liberté de suivre un cheval, de suivre son instinct, de chanter, de mener sa barque, de désobéir, de garder ses secrets… Je crois vraiment que c’est un fil rouge du roman et qu’il n’a pas fini de nous surprendre.
******
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les billets d’Isabelle, de Lucie, de Pépita et Frédérique, ainsi que le billet consacré à Timothée de Fombelle dans notre série « classiques de la littérature jeunesse », qui vous donnera certainement envie de lire ses autres livres. N’hésitez pas non plus à nous donner votre ressenti sur Alma : ce roman vous fait-il envie ? Peut-être l’avez-vous déjà lu, qu’en avez-vous pensé ?