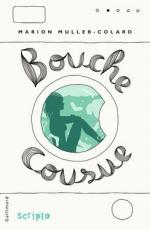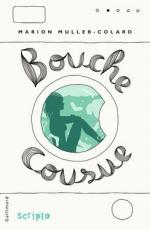
Bouche cousue.-Marion Muller-Collard Gallimard, collection Scripto
En janvier dernier, la lecture de Bouche-Cousue de Marion Muller-Colard m’avait laissé bouche bée. Une claque, une secousse. Et un émerveillement esthétique à la fois. Nous en avons discuté, A l’ombre du Grand Arbre, longuement, passionnément. Il en est ressorti parfois des choses très personnelles, des digressions émouvantes que je ne pouvais pas toujours retranscrire ici. Voici donc, en version « abrégée », le contenu de nos échanges.
C. du Tiroir : Quelques mots sur Bouche Cousue ? Comment présenteriez-vous l’intrigue en une phrase ?
Pépita : Une lecture gifle au sens propre comme au figuré, une plongée dans le désir ou les désirs, avoués ou inavoués, mais dans ce cas présent bafoués car muselés par un souci de propreté extérieure et un cri de solidarité aussi entre générations comme pour conjurer le sort.
Alice : Je dirais tout simplement que l’acceptation de certains baisers serait une idée bien plus brillante que celle de coudre des bouches.
Colette : Bouche cousue c’est l’histoire bouleversante d’Amandana, de Tom et de tant et tant d’adolescents en quête de sincérité, de vérité, d’honnêteté et qui ne trouvent face à eux que le silence de l’incompréhension.
Solectrice : Une femme meurtrie confie à son neveu l’histoire douloureuse de son adolescence et ses pensées torturées, brassées comme dans le tambour d’une machine à laver.
Pour ce qui est du format, on est dans le condensé, le direct. Une centaine de pages très (trop ?) vite avalées, on referme le livre un peu sur notre faim. Et pourtant, ce format est nécessaire. Qu’en pensez-vous ?
Pépita : Je ne suis pas à proprement restée sur ma faim, non, je ne peux pas dire ça. C’est une lettre qui est adressée à un jeune de 15 ans, d’une tante à son neveu, comme pour lui dire, non pas de ne pas faire la même erreur, mais de vivre sa vie pleinement. Un format court cinglant comme la gifle. De cette lecture, j’en suis sortie triste, en colère mais en même temps pleine d’un élan d’amour. Et aussi en me posant cette question : que ferais-je en tant que parent ? Quelle serait ma réaction ? Un temps d’introspection donc.
Alice : Je ne me suis pas du tout posé la question du format. Ni trop court, ni trop long. Ce livre m’a d’ailleurs fait penser à 50 minutes avec toi de Cathy Ytak dans la collection D’une seule voix, sûrement pour le côté monologue introspectif et la concision du texte.
Colette : Comme Alice je ne me suis pas posée la question du format trop heureuse de me laisser prendre au filet de voix d’Amandana et de pouvoir la lire jusqu’au bout, d’un trait, comme Tom a pu sans doute lire cette lettre de sa tante sans s’interrompre, y puisant immédiatement une forme d’énergie triste.
Solectrice : J’ai aimé le rythme de ce court roman. Pour moi, son format s’apparente justement à celui d’une longue lettre, confidence, s’attardant sur cette période intensément vécue par la narratrice. Plus long, je pense qu’il aurait perdu de son caractère percutant, qu’il se serait attardé sur des questions ou des explications, vaines pour accéder à l’émotion de la narratrice.
Bouche cousue aborde les tabous et les non-dits dans une famille, et le mal qu’il peuvent faire. Dans la lignée de son sujet, l’auteur adopte une narration très en retenue, avec beaucoup d’implicite. Trouvez-vous comme moi que cette pudeur, ces « creux », rendent son texte d’autant plus puissant et évocateur ?
Pépita : Oui je te rejoins totalement, c’est ce qui fait la force de ce récit de ne pas nommer l’homosexualité, y compris pour le couple d’hommes où Amande trouve refuge. On pourrait reprocher à l’auteure de cacher aussi les choses, comme pour les tabous de la famille. Justement non : cela donne de la place au lecteur pour respirer dans cet étouffoir et pour laisser venir à lui tous ces questionnements de l’adolescence. Chacun peut s’y retrouver du coup : l’adulte devenu adulte qui va faire ressurgir sa propre adolescence et l’adolescent qui va pouvoir se dire que ce qu’il ressent est universel. Je pense aussi que le fait d’avoir utilisé la lettre comme communication est très forte aussi, surtout à l’adolescence. Elle est comme une bouteille à la mer. Beaucoup de métaphores dans ce texte très chargées symboliquement et qui remuent beaucoup de l’intérieur : le lavomatique, l’âge pas anodin des personnages principaux (15 ans et 30 ans), les vêtements, comme tu dis Colette, j’ai trouvé cette scène sublime dans ce qu’elle révèle car un enfant qui se déguise, c’est perçu comme normal, mais chez l’adolescent c’est transgressif. Pourquoi ? (Je pense au magnifique film Billy Elliot). Ce roman aborde surtout, bien plus que l’homosexualité, le regard de la société sur les convenances sociales, le fait qu’à partir d’un certain âge, il faut rentrer dans les cases. Amande y est entrée dans la case mais à quel prix ! Cette lettre à son Tom, c’est lui dire de vivre SA vie. Cet aspect m’a bouleversée car on a tous dans nos familles une figure extérieure à nos parents qui nous a marqué à un moment de notre vie.
Colette : En effet l’implicite participe de la force de ce texte et aussi de son universalité. Ce n’est pas un livre « sur » l’homosexualité mais sur la quête de soi au cœur de l’adolescence. Je pense que n’importe qui peut se reconnaître dans les questionnements d’Amande, quelque soit son orientation sexuelle. La scène où Amande essaie les vêtements abandonnés dans le Lavomatic, par exemple, évoque pour moi un moment clé de l’adolescence, ce fameux moment où l’adolescent-homard change de carapace et se retrouve à nu – pour reprendre une métaphore de Dolto que je trouve assez juste. Il me semble que cette scène est d’ailleurs un symbole très fort qui relie l’univers familial d’Amande à ses tourments d’adolescente. J’aime beaucoup cette scène…
J’aime beaucoup Pépita ton analyse du déguisement qui devient travestissement selon l’âge, je n’y avais pas pensé, au final le poids du regard des autres c’est surtout de ça dont parle ce roman au final…
Alice : Je suis complètement d’accord avec tout ce que vous dites et j’aurais peu de choses à rajouter sur cette question…. Ou peut être que j’établirai un parallèle entre l’implicite très présent dans ce livre qui est comme un écho à tous les secrets et non-dits de cette famille conservatrice, qui ne veut surtout pas de vague. L’auteur n’en dévoile pas trop, comme les parents taisent ce qui n’est pas conforme. Deux formes de silence qui se complètent.
J’ai souri à la lecture de vos références littéraires et cinématographiques, pour ma part, j’avais en tête la chanson d’Alain Souchon » L’amour à la machine »… Décidément, Le lavomatic est un symbole fort !
Solectrice : Comme il est bon de découvrir que ce sentiment de l’amour naissant n’est pas aussitôt étiqueté, mais ressenti de l’intérieur, à l’égal de tout autre amour. On ressent ainsi la candeur de la jeune fille et son émoi prend plus de force, devient universel. On partage sa pudeur, puis on est choqués par la violence des réactions de sa famille.
Il y a cette scène du repas de famille dont vous avez très bien parlé. Et puis il y a autre chose qui m’a été particulièrement douloureux, à la lecture, c’est la relation entre Amandana et sa soeur. Sa soeur, digne héritière de ses parents, empressée de perpétuer la tradition familiale du rien qui dépasse, comme pour mieux expier son propre péché, dont le récit ne nous dit pas comment il a été accueilli dans l’histoire familiale (on s’en doute). Cette Mado, qui participe a l’oppression mais dont on sent tellement aussi la propre blessure. Ces deux sœurs qui devraient être alliées, et qui se sont « ratées », comme l’explique Amandana notamment sur un épisode symbolique de leur vie de femmes. Partagez-vous mon sentiment sur ce personnages ? D’autres vous ont plus marqué ?
Pépita : Ah oui complètement d’accord avec toi. En fait, on pourrait penser qu’elle est plus forte qu’Amandana qui elle semble empêtrée dans son manque de confiance comme si elle n’était finalement pas née dans cette famille. Elle est comme un Ovni. Mais non, Amandana est plus forte mais elle ne le sait pas encore. Sa sœur est encore plus malheureuse car elle sent bien qu’elle s’est enfermée toute seule. C’est terrible. Il y a une immense solitude, un gouffre béant dans cette vie-là, une immense fatigue. Elle le sait. Mais elle n’a pas appris à faire autrement. Pire : elle le transmet à sa propre petite fille, qui m’a l’air aussi être une petite Mado en devenir. Soit elle reste toute sa vie ainsi en mettant un mouchoir sur ses aspirations profondes, soit un jour ça casse et là ça fait mal. La scène dont tu parles est très révélatrice dans cette indifférence. Mais je pense que Mado a tellement à porter pour elle-même et c’est déjà tellement lourd qu’elle n’a pas la force de porter plus. En contrepoint, j’ai trouvé que le couple d’hommes (que je les trouve épatants ces deux-là !) a bien su faire pour accompagner Amandana sur sa vie de femme. J’ai trouvé ce passage tellement lumineux, presque risible dans la maladresse mais si touchante. Que du coup cela a occulté un peu la froideur de la famille. J’ai préféré garder la lumière plutôt que la noirceur.
Une autre scène aussi juste ébauchée : celle de la bague…très révélatrice de la confusion des sentiments et de la perception que chacun peut en avoir…Cette Marie-Line, je la sens pas…Manipulatrice ? Indiférente ? Un jeu pour elle ?
Alice : Elles se sont ratées les sœurs ? Je ne sais pas … Elles peuvent se retrouver aussi un jour … Tout n’est pas irréversible…Ce serait pour moi une possible porte ouverte s’il y a avait une suite à ce livre.
Je ne dirais pas que Mado participe à l’oppression mais plutôt qu’elle fait figure de « soumise ». Comme le dit Pépita, elle s’est enfermée toute seule. Par choix ? Par crainte ? Par obligation ? On ne le sait pas.
Et tout porte à croire qu’elle subit sa vie plutôt que de la vivre.
Pépita : oui mais quand même…Amandana perçoit ce dimanche-là chez Mado sa sœur une lassitude qu’elle a du mal à dissimuler. Elle l’exprime très clairement comme si elle espérait que sa sœur, pour une fois, aurait pu se ranger de son côté. Du coup ça peut exploser à tout moment cette oppression et prendre un tour incontrôlable. Sauf que là tout est maitrisé, répété, comme une boucle que rien ne pourra jamais arrêter. Tout est dans une violence plus ou moins retenue (parce que le beau-frère, ce qu’il est cinglant dans son genre !) sauf la gifle qui elle claque et signifie fin de la discussion. C’est une cocotte-minute cette famille.
Colette : Mado, je ne la comprends pas en effet, je vois plutôt sa manière de perpétuer le silence traditionnel familial comme une manière de masquer sa « faute » à elle, de se rattraper, de se faire pardonner les règles qu’elle aussi à transgresser en ayant Tom alors qu’elle est encore lycéenne. Mais je ne lui pardonne pas d’avoir « balancé » sa sœur alors qu’elle partageait un secret qui aurait pu les rapprocher. Et comment se faire confiance après ça ???
Quant à mes personnages préférés, comme Pépita, il s’agit de Jérôme et Marc, leur bienveillance, leur écoute de chaque instant, leur amour pour Amandana sont vraiment touchants. Ils incarnent à la fois amitié et éducation bienveillante et j’ai vraiment été « déçue » que notre héroïne les rejette…
Solectrice : J’ai aussi été très touchée par ce passage que tu évoques et par cette relation manquée avec celle qui aurait dû la guider, l’aimer. Je comprends qu’elle se veut aussi distante que les parents, ses modèles. Je comprends aussi qu’elle porte sa blessure et qu’il en sort du venin, du mépris pour sa sœur. Et je trouve douloureux que cette relation les poursuive dans leur vie d’adultes, que rien ne vienne l’apaiser, que le non-dit l’emporte à nouveau.
Concernant les autres personnages, j’ai aimé, bien sûr, le duo de Marco et D’Jé, et le cocon qu’ils tissent autour d’Amande. J’ai apprécié la chance qu’elle avait de les rencontrer, l’amitié qu’ils lui témoignent et l’implicite aussi sur la profondeur de leur relation. Mais je me suis questionnée sur le choix que fait l’adolescente de les rejeter, malgré les remords qu’elle exprime.
Pépita : Contrairement à vous, je n’ai pas été « déçue » du rejet dAmandana envers le couple de ses amis. Je me suis dit c’est la vie ! Combien de personnes perdons-nous sur notre chemin ? Mais le souvenir de leur présence bienveillante peut toujours nous accompagner. Ils ont été là pour elle à un moment de sa vie, et avouons que leur rencontre était plus qu’improbable ! J’ai eu un pincement au cœur oui sur le moment. Mais le monde est petit…
J’aime beaucoup l’idée du giron maternel que tu développes Solectrice, car ce roman c’est aussi un roman d’émancipation, bridée certes, mais de tentative d’émancipation des jupes de maman. Et combien c’est fort en symboles dans ce récit !
Un roman qui a remué bien des choses chez chacune de nous, c’est sûr. On ne saurait que trop vous conseiller de le lire:
Bouche Cousue, Marion Muller-Colard. Gallimard Scripto, 2016.
**************************
Morceaux choisis de nos chroniques (par ordre de parution) :
« Quelques chapitres nerveux, si forts et si douloureux, qui disent tant de choses, tout en subtilité. » le Tiroir à histoires
« Un roman sincère et intime, d’une grande qualité d’écriture et d’une réflexion nécessaire. » A lire au pays des merveilles
« Ce roman est un boomerang. Comme ceux que savent si bien fabriquer les familles où la parole n’a pas sa place, où les tabous, eux, doivent surtout rester à leur place. » Méli-mélo de livres
***************************
Et on se retrouve mercredi à l’ombre du grand arbre pour une lecture d’ado de Bouche Cousue avec Lucie de Lectures Lutines et un entretien avec Marion Muller-Colard !
A mercredi !