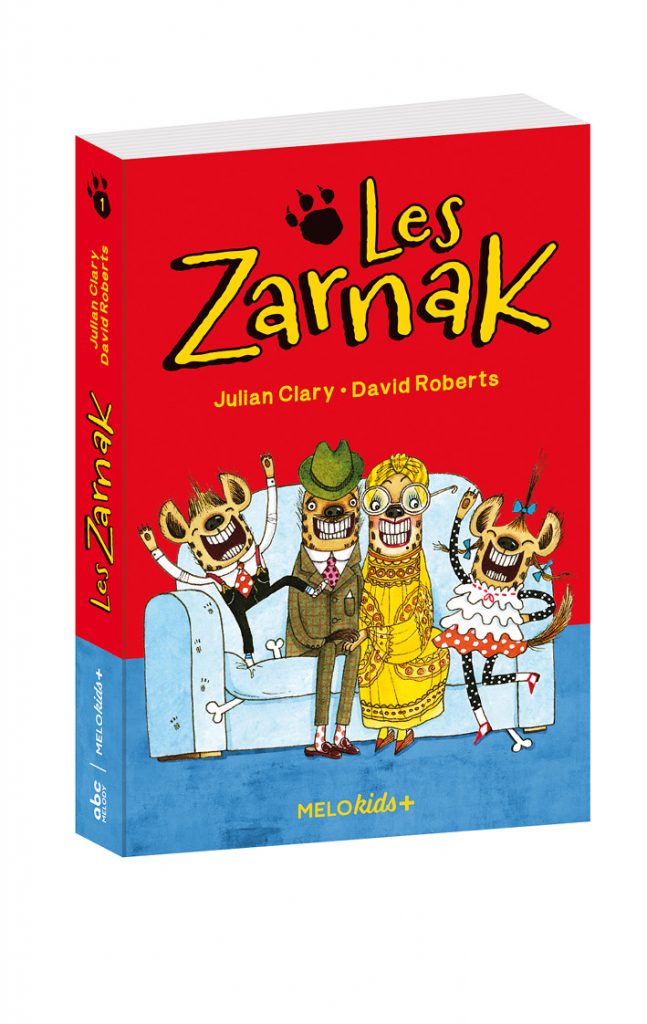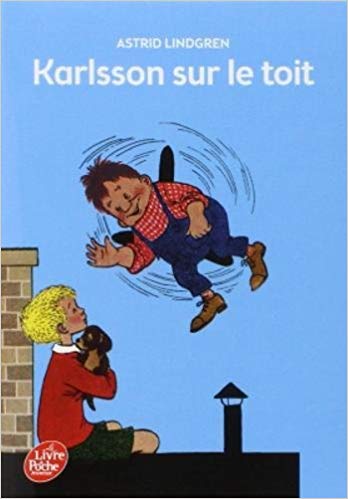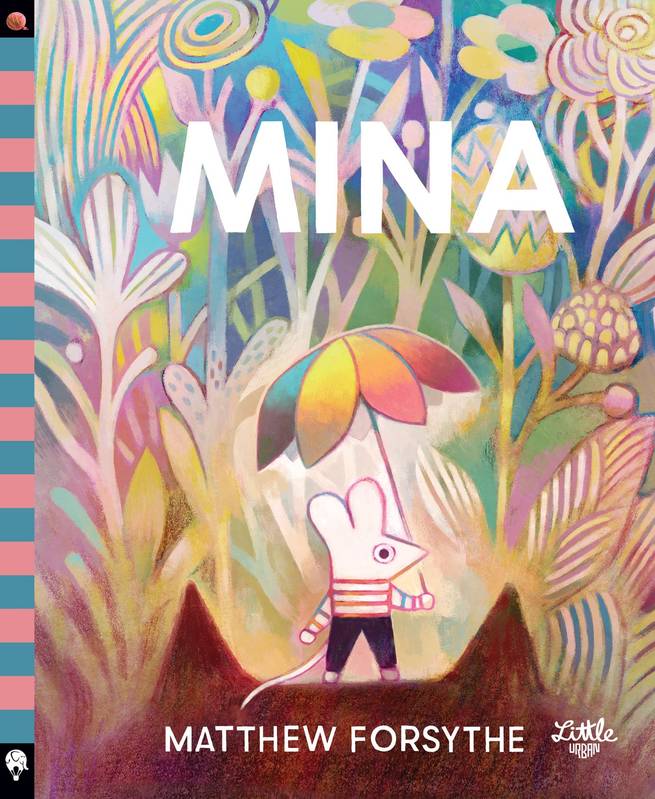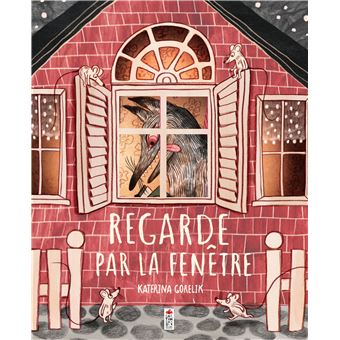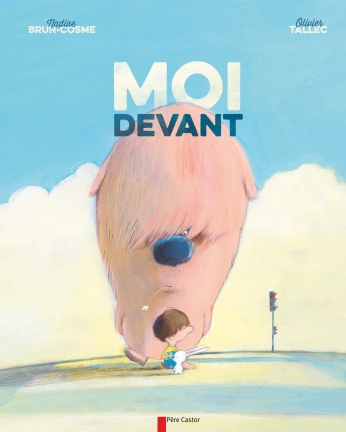Vous avez découvert Emilie Chazerand lors de notre lecture commune consacré à son dernier roman ado Annie au milieu et bien voici son IMMENSE interview rien que pour vous !
– Comment passe-t-on d’infirmière à auteur jeunesse ? Exercez-vous encore votre premier métier ? Si oui, est-ce que ces deux activités se nourrissent l’une l’autre ?
On passe du métier d’infirmière à celui d’autrice parce qu’on finit toujours par trouver sa place, je pense.
Je ne peux pas dire que je suis devenue infirmière par accident parce que, tout de même, il s’agit de trois années et demi d’études nourris de plusieurs stages où on est humilié et exploité, de connaissances théoriques monstrueuses à ingurgiter, d’épreuves pratiques ultra stressantes et exigeantes, d’un mémoire à rédiger et tout le tintouin.
Donc j’ai vraiment serré les dents pour obtenir ce diplôme d’état et avoir le droit d’exercer un des métiers les plus méprisés et douloureux, avec des taux de suicide professionnel, de burn out, de harcèlement moral et sexuel, effrayants. Parenthèse fermée.
Je n’exerce plus ce métier depuis presque dix ans.
Parfois, je suis vraiment tentée de repasser d’autrice à infirmière, parce que les patient.e.s, les gestes du soin, me manquent, le sentiment d’utilité immédiate, l’adrénaline, aussi. (Et poser des voies veineuses. Bon sang, ce que j’aimais poser des voies veineuses…)
Mes souvenirs les plus intenses, mes plus grandes douleurs, mes pires traumas, les rencontres les plus déterminantes de mon parcours ont eu lieu à l’hôpital. Tout, en dehors de cette essoreuse à humains, est rose, doux, frivole. De la flûte.
J’ai peu de véritables ami.e.s chez les auteurs et autrices. Iels se comptent sur les doigts d’une main. J’en ai plus du côté des soignant.e.s.
Ça disserte moins, ça n’a pas de prétention mal placée, « ça ne farcit pas les petits pois », comme disait ma grand-mère, mais ça rit et ça vibre incroyablement fort.
C’est dans le concret, dans le réel. Pas de népotisme ni de réel piston : tout le monde en chie, pardonnez-moi l’expression. J’aime, j’admire et j’ai besoin de ça.
Et puis, comme mon conjoint est médecin, j’ai la sensation d’avoir un pied dans le monde soignant, à vie.
Et évidemment, c’est un univers qui regorge d’histoires de vie et de sujets potentiels de romans. J’adorerais parvenir à écrire sur mes années d’études, le groupe d’ami.e.s que j’avais alors, si hétérogène et en constante évolution, nos aventures et mésaventures, nos pertes et nos fracas… On était des toutes jeunes personnes qui jouaient aux grandes personnes qui doivent secourir d’autres personnes. C’était fou.
Un jour, peut-être.
– La famille se trouve toujours au cœur de vos écrits. Est-ce que la vôtre vous inspire ?
Pas tant que ça, non. Parfois, mes enfants disent ou font un petit truc qui allume une étincelle d’idée mais je ne raconte pas mes proches, globalement. Et puis, j’ai une vision de la famille un peu foutraque, un peu éclatée. La mienne ne se résume pas par la biologie.
– Dans vos romans, les héroïnes ou les héros évoluent dans des familles dysfonctionnelles. Pourquoi est-ce si important pour vous ?
Parce que la plupart des familles sont dysfonctionnelles et que les lecteurs et lectrices ont le droit de retrouver des histoires qui leur ressemblent. Et puis, c’est beau, c’est intense et même sain, de dysfonctionner dans un monde totalement dysfonctionnel, lui aussi, pour le coup.
La dysfonction, c’est le grain de sable dans un rouage bien huilé qui va permettre de faire apparaitre les failles mécaniques. La panne. L’accident. Et là, il se passe quelque chose. On peut commencer à raconter des trucs et à réparer. J’aime bien réparer.
Les familles parfaites, ça n’existe pas. Et si ça existait, je pense qu’elles seraient vraiment très chiantes. En tout cas, moi, ça ne m’intéresse pas.
Et puis, tout est une question de point de vue, je suppose : ce qui est dysfonctionnel pour moi vous paraitra peut-être équilibré et cohérent, et vice et versa.
Et surtout, au fond, est-ce qu’une famille a vocation à être fonctionnelle ? C’est un groupe d’individus qu’on place ensemble et qui doivent apprendre à exister et coexister. C’est tout.
– Vos romans ainsi que vos albums se caractérisent par des punchs line en cascade ainsi que des situations loufoques parfois invraisemblables. Comment vous viennent toutes ces idées, que ce soit dans les jeux de mots ou autres ?
Là, je vais faire très court : je n’en sais rien. Je n’ai aucun conseil à filer, aucun tuyau, astuce, méthode, recette. Mais mes meilleures punchlines ne pourraient jamais être publiées, ça, c’est une certitude…
– Outre les phrases qui font mouche et la répartie de vos personnages, l’humour est très présent dans vos romans. Il permet notamment d’alléger certaines situations qui, sans cela, pourraient être dramatiques. Vos personnages sont très lucides et se moquent d’eux même avec beaucoup d’humour. Avec vous, nous avons presque l’impression que l’on peut rire de tout (le nanisme, les odeurs corporelles, le handicap et même de djihad), est-ce une « recette » que vous utilisez consciemment ou cet humour vient-il naturellement ?
Je ne fais pas grand-chose consciemment, j’ai l’impression. J’écris comme je suis. Si vous trouvez mes livres relous, vulgaires et insupportables, ne venez pas manger à la maison : vous n’allez pas passer un bon moment…
Rire de soi est un pont qu’on jette vers l’autre. C’est un reliquat de l’enfance. La version adulte du « tu veux jouer avec moi ? ». On doit pouvoir continuer à jouer les uns avec les autres, peu importe nos âges.
Je ne vais pas me lancer dans le débat « peut-on rire de tout ? » parce que ça ne m’amuse pas, justement.
Mais je peux tout trouver drôle, c’est un fait.
Par exemple, perdre mon père a été un des moments les atroces de ma vie, très sincèrement. Mais quand ma mère lui caressait le visage sur son lit de mort et que ça devenait un peu embarrassant, ma nièce lui a dit « hep, c’est comme dans les magasins : on touche avec les yeux ! ». Forcément, j’ai ri. Pareil quand ma sœur a grognonné, très sérieusement « putain, quelle semaine, je te jure : hier j’ai pété mon Iphone et maintenant, papa est mort… ».
C’était à la fois nul, indigne et marrant. J’ai eu envie de la goumer et de la serrer fort, en même temps. J’adore être habitée de ces deux pulsions contradictoires. Et j’adore l’idée de susciter ce mélange-ci chez les gens.
Toute petite, j’ai compris que l’humour est un pouvoir immense.
Parce qu’il est la combinaison de l’intelligence, de l’empathie, de la culture et de la bienveillance.
C’est très difficile de faire rire. Bien plus que de faire pleurer. Pour ça, il suffit de la photo d’un enfant triste, d’un chien borgne ou d’un chat à trois pattes, avec une musique de fond remplie de violons tremblotants et d’un piano mélancolique. Et hop, ça chiale à n’en plus pouvoir.
Pour faire rire, il faut comprendre ce qui amuse l’autre. S’être intéressé.e à lui/elle. Le connaitre un petit peu. Trouver un terreau commun, des références universelles, comme un radeau auquel se raccrocher ensemble. Ça demande de l’investissement et la volonté de faire du bien.
C’est la meilleure façon d’aimer.
– Nous avons remarqué que vous prenez un malin plaisir à mettre des personnages dans des environnements qui les poussent à se sentir différents. Nous pensons notamment au personnage de Richard dans Falalalala ou encore celui d’Annie dans Annie au milieu. Cette question de la différence semble être centrale dans vos romans, est-ce parce que vous considérez que la différence ou être différent est une force ?
En réalité, on se sent toujours différent des autres, non ? Déjà parce que nous sommes les personnages principaux de nos existences tandis que les autres… ne sont que les autres, ma foi.
Asseyez deux chauves l’un à côté de l’autre et dites-leurs qu’ils sont pareils, vous verrez qu’ils feront la gueule.
Richard n’est pas malheureux parce qu’il est différent de sa famille. Il est frustré et mal dans sa peau parce qu’il ne parvient pas à être lui-même, à se faire accepter, aimer et respecter tel qu’il est. Tant que Richard refuse l’idée qu’être Richard c’est super, c’est merveilleux, c’est suffisant, il va mal. Richard a un problème avec Richard.
Annie, elle, adore être Annie. Et elle adore que les autres ne soient pas Annie. Quand elle souffre, ce n’est pas parce qu’elle est différente et qu’elle déteste ça, mais parce qu’on la rejette pour ce qu’elle est alors qu’elle, elle s’aime. Ce sont les autres le problème. Pas Annie.
Annie n’a aucun problème avec Annie.
Etre différent n’est pas une force.
Ce qui en est une, et une énorme, c’est être soi. D’être en paix, en accord et même en amour avec soi.
Et ça, c’est rudement complexe.
– Nous avons découvert avec beaucoup d’intérêt votre documentaire Chiens. Pourquoi les chiens particulièrement ? Comment s’est passé cette expérience et votre collaboration avec l’illustratrice ?
C’est Charlotte Duverne, l’éditrice de Marcel & Joachim, qui a proposé ce projet. Je n’ai jamais eu, de moi-même, l’envie spontanée d’écrire un atlas des animaux…
Il me semble qu’elle avait repéré un post où je parlais avec humour d’un de mes chiens, photo à l’appui, et elle a dû se dire que j’étais la personne adéquate pour une telle entreprise…
Mais j’ai été si surprise que j’ai eu un petit rire nerveux, la première fois qu’elle en a parlé. J’ai dû répondre un « Euh… d’accooord… pourquoi pas… » assez titubant.
Honnêtement, je n’ai envisagé ce projet que parce que c’était avec Charlotte et Marcel & Joachim : tous leurs bouquins sont modernes, malins, pétillants.
Ailleurs, j’aurais eu trop peur que ça donne un catalogue pour mémés à caniche abricot, un peu old school et kitsch/bof, avec des photos bizarroïdes de toutous caracolant dans les prés, museaux au vent et queues en l’air.
Charlotte a tout de suite parlé de Naomi Wilkinson aux illustrations. Je suis allée jeter un œil à son travail et ça a suffi à me convaincre que ce serait bien.
Je n’ai pas eu d’échange particulier avec elle, si ce n’est un petit mail poli et chaleureux pour dire, en gros, « ravie de bosser sur ce livre avec toi ! ».
Cet atlas a exigé un énorme boulot de recherche et d’écriture. Si j’avais su ce que cela allait représenter en quantité de travail, je ne suis pas sûre que j’aurais accepté…
Cela dit, je ne regrette pas un millième de seconde : j’ai appris une tonne de trucs qui ont fait bouger des lignes, dans ma tête, et je suis très fière de ce bouquin !
De plus, j’ai trois chien.ne.s et il était grand temps que je fasse un livre pour iels. Iels le méritent : ce sont mes gars sûrs et ma belle gosse.
*
Questions sur Annie au milieu
– Vous semblez avoir joué de plusieurs codes littéraires – l’écriture en vers, les listes, des niveaux de langues différents sur les personnages, etc – d’où est née cette envie ? Est-ce un jeu ou est-ce une réflexion sur le rapport étroit entre « signifié » et « signifiant » ? Quelles sont vos sources d’inspiration pour le travail du style ?
Chaque fois que je pensais au projet Annie au milieu, je me torturais sur la forme, le style à employer, etc. Je changeais d’avis, d’orientation, tous les jours.
Je ne savais pas comment attaquer le dossier, ni m’y coller sérieusement. Je piétinais un peu et puis, un soir, j’ai rédigé le premier chapitre de Velma en vers, presque par accident, en essayant de réfléchir le moins possible.
Je l’ai illico envoyé à Tibo Bérard, mon éditeur d’alors chez Sarbacane, dans un mail très court, genre « T’en penses quoi ? Baisers ».
J’étais inquiète et fébrile. Pas sûre de moi, du tout du tout. J’avais besoin de sa validation pour avancer.
Il m’a répondu avec son enthousiasme légendaire et je me suis sentie autorisée à continuer. Ça peut sembler bête mais j’ai besoin d’un éditeur/d’une éditrice pour ça. C’est le hochement de tête approbateur, la petite tape sur l’épaule, qui me rassure et me fortifie. Chez Sarbacane, iels sont tou.te.s hyper fortiches pour rassurer. (Je pose ça là, faites-en ce que vous voulez.)
J’ai donc expliqué à Tibo que j’allais essayer de donner une voix à chaque personnage, en fonction de la manière dont je les entendais, « dans ma tête », et ça a donné ça. Je voulais qu’on distingue les styles d’écriture comme on distingue des timbres de voix, justement. Il m’a dit que ça allait être bien, donc on l’a fait de cette façon.
Je pense que ce n’était pas un jeu et que je ne me suis inspirée de rien de particulier.
En réalité, je ne sais pas comment ça se passe pour mes collègues auteurices mais, personnellement, quand je vivote avec un projet depuis un moment, les personnages existent, comme des fantômes ou des amis imaginaires. Je peux les entendre, les voir. Ils sont « là ».
En l’occurrence, je voulais qu’ils parlent tous les trois. Qu’ils se passent la parole, gentiment, respectueusement. Qu’ils aient des places et des importances égales, même si Annie a remporté le titre du livre. J’ai beaucoup aimé le temps passé avec les Desrochelles : iels ont déboulé à un moment compliqué de ma vie et j’ai repris mon souffle, grâce à elleux. Je penserai toujours à ce livre avec la tendresse qu’on accorde aux ami.e.s présent.e.s dans les coups durs.
– Quelle a été la place de la musique dans l’écriture d’Annie au milieu ?
J’ai beaucoup écouté de musique pendant mes pauses entre les chapitres.
Pour Velma, j’écoutais des choses douces, tristes, profondes, pour me mettre dans son énergie si particulière, un peu opaque, pesante mais belle. Je mettais Pomme, Bon Iver, the Irrepressibles, Stina Nordenstam, Tove Lo, Alice Boman, Radiohead, Aimee Mann. Globalement, tout ce qui peut filer un seum monumental était bienvenu et profitable.
Pour Annie, c’était exactement l’énergie inverse. Il fallait que ce soit solaire, joyeux, pêchu, agité, rigolo. Comme Blink 182, Lio, Liquido, Philippe Katerine, les Rita Mitsouko, Oldelaf, certains titres de Björk et de Dalida et, bien sûûûr, Taylor Swift.
Pour Harold, c’était la musique que j’aime et écoute ordinairement. Ni des trucs tire-larmes, ni des machins de fête à Dédé. Entre ces deux ambiances-là. Pas trop lourde, pas trop pimpante.
Mais, globalement, dès que j’ai une idée de roman en tête, je bricole une playlist. C’est comme choisir un vêtement : on ne s’habille pas de la même façon pour aller à un enterrement, à un anniversaire, en randonnée, au boulot…
La musique distribue les bonnes émotions et les place aux bons endroits. En tout cas, pour moi.
– Est-ce qu’on pourrait avoir un petit scoop sur votre lien à Dalida qui est un personnage clé de ce roman ?
Je n’ai aucun lien particulier avec Dalida, si ce n’est qu’une de mes tantes l’adore et qu’elle m’a appris la chanson du petit bikini quand j’étais encore minuscule.
Je ne suis pas fascinée par la personne ni subjuguée par l’artiste mais elle m’intrigue et me touche. Dalida, c’est une femme qu’on a envie de consoler et de sauver d’elle-même, même maintenant qu’il est bien trop tard.
Et puis, elle a en elle ce mélange curieux de douceur et de gravité, de frivolité et de tristesse évidente, de beauté et de plaies apparentes, qui fait d’elle un personnage de confidente absolument parfait pour Annie. Non ?
******
Merci Emilie d’avoir pris le temps de répondre à nos questions, et nous régaler toujours plus avec vos histoires !