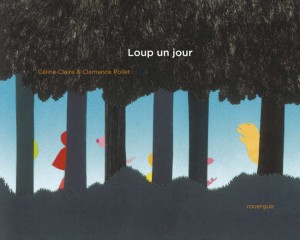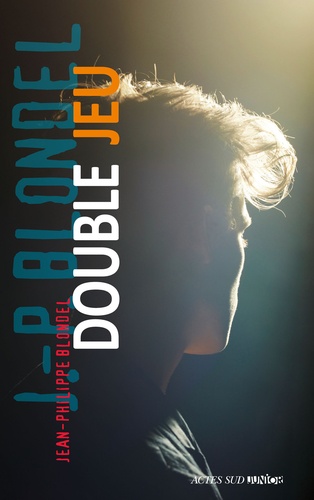« Si j’avais eu un père, il serait venu rectifier la tronche de ces quatre salopards. Il les aurait chopés un par un ou ensemble pour leur faire payer l’affront fait à sa fille. Ensuite, en quelques mots justes, pour me rassurer, il aurait aussi su me faire croire que je valais mille fois mieux qu’eux et que je restais la plus exceptionnelle du monde. Et j’aurais tout gobé, de la première à la dernière syllabe.
Si j’avais eu un père, je n’aurais pas fait cela. Ou pas ainsi. Seule, je devais me débrouiller seule. »
Extrait de : « La fille seule dans le vestiaire des garçons » d’Hubert Ben Kemoun, Editions Flammarion
J’ai lu ce livre comme un choc émotionnel. Une fois la denière page tournée, je n’avais qu’un besoin : en parler. Mes complices, Pépita, Sophie et Céline ont alors bien voulu se prêter à une lecture commune.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
*Alice : Tout commence par un baiser ….. tout finit dans des paillettes….. et pourtant ce n’est pas une bleuette que ce roman.
Un petit résumé pour commencer ?
Pépita : Marion et Enzo : ils se cherchent, se tournent autour, se trouvent et s’évitent. Jeu de séduction ou jeu de persécution ? On sent d’emblée qu’entre ces deux-là, rien n’est simple. Un baiser volé oui, une riposte mal placée et c’est l’escalade. Des comportements de harcèlement, des comportements de voyeurisme et tout dérape. On tremble dans ce roman, on a peur pour ces jeunes qui sont en fait incapables de réfléchir aux conséquences de leurs actes.
Alice : Je reprends tes mots Pepita « …Marion et Enzo : ils se cherchent, se tournent autour, se trouvent et s’évitent. »
En effet dés le premier chapitres, on entre dans le vif. On assiste à un jeu de chien et chat entre deux ados. Ils se vannent, se provoquent, s’insultent, jusqu’à aller au geste violent déplacé. Et franchement c’est pas de l’amour entre eux. C’est mordant, c’est piquant, c’est sec, …. de quoi se demander comment le baiser évoqué dans ma première question peut arriver, tellement il parait improbable, à la lecture de ces premières lignes, que ces deux ados se rapprochent.
*Quel est alors l’élément qui fait tout basculer ?
Pépita : L’élément qui fait tout basculer, c’est le fait qu’Enzo, en volant ce baiser, fait aussi renverser le contenu du sac de Marion. Elle lui décoche un coup bien placé, il promet de se venger. En rentrant chez elle, Marion s’aperçoit que son carnet intime, là où elle note ses chansons, ses pensées, n’est plus dans son sac. Elle pense tout de suite que c’est Enzo qui le lui a pris. Elle aussi promet de se venger. Une rage sourde gronde en elle. C’en est bien plus qu’elle ne peut supporter. C’est son intimité qui lui a été volée. En plus par ce garçon justement ! Double peine !
Sophie : Et pourtant Enzo saura trouver les mots pour apaiser sa colère…
Alice : Dure dure et complexe en effet la relation entre ces deux ados. Un baiser volé, un baiser filmé, une jeune fille humiliée et trahie.
*Quelle est alors la réaction de Marion ? La trouvez-vous réellement justifiée ?
Sophie : On pourrait penser que le changement d’attitude de Marion est exagéré. En effet, elle le déteste, et dès qu’il commence à lui dire des mots doux, elle fond comme neige au soleil. Pourtant ça ne m’a pas choquée. Finalement c’est une adolescente solitaire, qui a envie d’être aimée alors si les sentiments viennent de son pire ennemi, tant pis, peut-être avait-elle fait erreur sur la personne. Il y a en fait beaucoup de naïveté dans cette histoire mais on ne peut pas lui en vouloir.
Céline : Justement, j’ai trouvé ce début de roman trop abrupt et je n’ai pas du tout adhéré. La scène du baiser, ce coup monté, n’est pas très bien amené… Le brusque changement d’attitude de Marion à l’égard de cet Enzo qui la persécute ne fonctionne pas du tout je trouve, on a du mal à y croire. Du coup, j’ai l’impression d’avoir suivi tout le reste de l’histoire avec incrédulité et un regard très détaché.
Pépita : Marion est une jeune fille à laquelle je me suis de suite attachée. Et je rejoins Sophie pour sa naïveté : son père parti pour une autre, une mère qui collectionne des amours malheureux, quel modèle pour elle ? Elle a un immense besoin d’être aimée pour ce qu’elle est, une jeune fille artiste, la tête pleine de mots et de musique. Alors, oui, elle tombe dans le piège d’Enzo et sa colère lorsqu’elle s’en aperçoit est finalement aussi dirigée contre elle-même. Elle s’en veut terriblement. Mais elle le fera payer. J’avais envie de lui dire d’arrêter cette escalade, que ça ne servait à rien. En même temps, cette trahison est terrible pour elle. Je le conçois aussi. Elle n’a pas véritablement d’adulte à qui se confier, à part son petit frère, cela a ses limites.
Alice : En effet, une jeune fille pleine de mots et de maux : ce père absent et cette relation difficile avec les hommes. Pour elle les garçons sont une espèce dangereuse avec qui la communication est fermée et inenvisageable. Son seul refuge, une de ses raisons de vivre : la musique ! Ce n’est pas la première fois qu’en littérature jeunesse, on voit un(e) ado se sortir d’un mal-être grâce à une pratique artistique.
*Comment cela sert-il l’histoire ici ?
Sophie : Sa passion, elle l’exerce à la guitare mais aussi en écrivant des chansons. Chansons qu’elle consigne dans un carnet. Et c’est justement la perte de ce carnet qui va être l’élément déclencheur pour la suite de l’histoire. Sans en dire trop, la musique va aussi jouer un rôle dans le dénouement du roman…
Pépita : La musique est son refuge, son jardin secret. Mais curieusement, elle ne s’en sert pas pour aller vraiment mieux. Elle s’en cache. Par timidité ? Par manque de confiance ? Ou par manque d’un regard bienveillant ? Je pencherais pour la troisième réponse. Il lui suffit d’une rencontre, qui met du temps à émerger, à s’accepter, pour que Marion se dévoile artistiquement. La musique est comme un fil dans ce roman, ténu au départ, mais qui prend de l’ampleur pour se révéler dans le beau dénouement de l’histoire. C’est un aspect que j’ai beaucoup aimé,-la musique adoucit vraiment les mœurs !- et tu as raison de souligner que la musique est souvent présente dans les romans pour ados.
Alice : Je repense à ce passage du livre où Marion découvre la vidéo sur You tube et ou elle déverse toute sa rage sur sa guitare, alors je me dis que la musique lui sert sacrément à s’exprimer. Sa musique est tellement puissante et tellement hargneuse, qu’à ce moment là elle ne voit pas/ elle n’entend pas son petit frère, Barnabé qui vient la chercher pour le repas. D’ailleurs, un attachant personnage ce petit frère : toujours le mot juste, toujours le mot pour rire et une sacrée sensibilité. *Adorable, non ?
Pépita : Son petit frère Barnabé ? C’est sûrement celui qui la comprend mieux que quiconque ! Marion est souvent surprise de sa perspicacité même si elle le trouve souvent prévisible (son côté ado qui ressort !). De part sa maturité, ce jeune garçon apporte une note d’humour mais aussi de recul sur ce que vit sa grande sœur. Il est toujours là, a toujours les mots qu’il faut quand elle en a besoin sans le solliciter. Il a comme un sixième sens ! Et le fait qu’il soit un garçon la réconcilie en quelque sorte avec la gent masculine en général avec laquelle elle a tant de soucis relationnels, du moins quelques-uns. Pour autant, je n’ai absolument pas perçu que Barnabé prenait la place du père absent dans la vie de Marion.
Céline : Le personnage de Barnabé est à mon sens le personnage le mieux écrit du roman. Il est drôle, il est attachant, et très vivant ! La relation frère-soeur qui les unit me semble pleine de justesse et apporte beaucoup d’humanité à ce roman.
Sophie : Son frère est un petit garçon très intelligent probablement mûri par la situation familiale. J’ai beaucoup aimé leur relation : il est tantôt le confident, tantôt le petit frère qui agace. On sent qu’il est un peu le centre de sa vie, celui qui compte pour lui donner la force d’exister.
Alice : Oh oui moi aussi j’ai adoré Barnabé : ce petit grain de fraîcheur qui permettait au fil de la lecture d’alléger certaines situations ! Une place primordiale, pas celle du père comme le note Pépita, mais un personnage indispensable qui donne une autre dimension au livre.
Tiens, j’y pense ! On n’a pas du tout parlé du titre ! Et je sais sûrement pourquoi. J’ai un avis radical dessus, je trouve qu’il ne reflète pas du tout le contenu du livre. On peut s’imaginer tellement autre chose et la scène de « La fille seule dans le vestiaire des garçons » est tellement brève, que je ne le trouve pas forcément approprié. Et vous ?
Pépita : Oui, complètement d’accord ! Ce titre induit tellement de choses…et du coup, quand la scène arrive, on la minimise. Alors que ce n’est quand même pas très glorieux l’acte de Marion dans ce vestiaire…parce que c’est bien d’elle qu’il s’agit, alors que le titre laisserait à penser que c’est à elle qu’on fait du mal dans ce lieu.
Sophie : Comme vous deux, j’étais partie sur l’inverse de ce qui va se passer dans ce fameux vestiaire. Le titre induit en erreur mais il reflète aussi une étape importante du roman, même si je ne pense pas que ce soit la principale.
Pépita : En effet, la scène du vestiaire n’est pas la plus importante. Elle n’est qu’une conséquence d’une autre scène à la violence cynique et qui va à son tour déboucher sur une autre scène de violence, limite torture (qui m’a fait dresser les cheveux sur la tête !). Ce qui me donne l’occasion de parler de la violence dans ce roman : elle est omni-présente, diffuse, claque à la figure, donne la chair de poule, donne l’impression d’une escalade sans fin. Et aucun adulte auquel ces jeunes pourraient se raccrocher. Ce manque de gardes-fous, c’est un aspect du roman que j’ai trouvé interrogateur.
Sophie : En effet, la violence est omni-présente et sous de nombreuses formes en plus : la psychologique avec la trahison d’Enzo, la physique avec la scène dont tu parles, et puis la violence qui transparaît dans la vengeance de Marion aussi et qui est plus de l’humiliation.
C’est un roman très sombre en fait et l’issue est incertaine et angoissante.
*Alice : Vous ne mettriez pas cette violence en parallèle avec le mot « rage » qui borde toute la couverture du livre ?
Pépita : Oui, en effet ! Et aussi, si on en revient au titre, je trouve que le mot le plus important est « seule ». Il en est beaucoup question pour Marion.
Sophie : C’est vrai que « rage » est un mot qui convient parfaitement.
Alice : Personnellement, j’ai aussi vécu cette violence par le ton employé, l’auteur n’hésite pas à utiliser un vocabulaire familier et un ton incisif, comme un cri. *L’avez- vous aussi ressenti comme tel ?
Pépita : Le style colle parfaitement bien à ce qui se joue dans ces pages j’ai trouvé. Incisif oui mais pas familier. Je ne dirais pas ça. Un style contemporain disons.
Céline : Peut-être justement trop incisif et familier tout de suite. Et en ce qui me concerne, dés le début j’ai trouvé que ça sonnait un peu faux, comme un ton au dessus de l’histoire. Mais c’est un ressenti très personnel.
Sophie : Ce style ne me gène pas tant que ça ne tombe pas dans l’extrême, ici ça me semble plutôt cohérent avec l’adolescence et la cruauté de l’histoire.
*Alice : Un autre aspect du livre qui a à peine été évoqué et qui pourtant a son importance : l’usage dangereux des réseaux sociaux par les ados. Un sujet actuel, n’est ce pas ?
Sophie : De plus en plus de romans avertissent sur l’usage des réseaux sociaux, on a déjà eu l’occasion d’en parler dans d’autres lectures communes. Cela fait en effet partie du monde des ados, donc c’est difficile de l’éviter et c’est encore un usage nouveau pour la société et les adultes ont un rôle de prévention. Une prévention qui peut aussi passer par la fiction.
Pépita : Vaste débat à lui tout seul ! Les ados s’en servent tous les jours, en font une marque d’intégration alors qu’ils ne savent pas toujours bien s’en servir ou plutôt ne mesurent pas assez les conséquences de ce qu’ils y postent. Mais ce n’est pas vraiment de leur faute : leur a-t-on seulement expliqué comment ça marche ? Je trouve que cette formation devrait faire partie intégrante du programme au collège et au lycée, au même titre que l’éducation au genre, à la sexualité. On plonge tous dans le numérique, on en fait tous sans le savoir, même en s’en défendant mais on n’a pas les clés pour bien appréhender car la technologie va trop vite. Il y a un grand vide là-dedans et il serait temps de le combler.
Céline : Oui, c’est une nouvelle composante du monde des ados, (enfin nouvelle… disons par rapport à l’ado que j’étais moi !) et beaucoup d’auteurs les incluent dans leurs histoires à juste titre : ce sont des miroirs grossissant qui multiplient et diffusent des images et des propos à l’infini. A l’âge où l’image de soi se construit et se questionne par rapport au regard de l’autre, c’est à la fois un outil inévitable et un piège auquel on peut facilement être pris… et pas sans conséquences !
*Alice : Un roman très sombre en somme, sans trop en dire, peut-être pouvons-nous évoquer la fin afin de ne pas « effrayer » nos lecteurs…
Pépita : Une partie de la fin est suffocante de violence mais l’arrivée d’un autre garçon va tout apaiser. Je dirais cela finalement : l’apaisement pour Marion et la réconciliation avec elle-même, et finalement les autres. Mais j’ai eu très peur pour elle, je l’avoue.
Céline : Oui, suffocante, je l’ai lu vite mais péniblement, avec hâte d’en finir. Et j’ai moi aussi été soulagée…
Sophie : Suffocant, ça me semble très juste pour décrire la « pré » fin. J’ai d’ailleurs longtemps douté sur l’issue de cette histoire qui s’annonçait sordide. Le dénouement final était en effet un soulagement et une bonne bouffée d’espoir.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Retrouver nos chroniques individuelles sur chacun de nos blogs :
– Celui de Pepita – Meli-Melo de livres
– Celui de Sophie – La littérature jeunesse de Judith et Sophie
– Celui d’Alice – A lire aux pays des merveilles