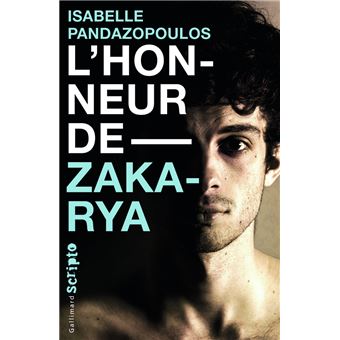Comme les années précédentes, nous avons lu les titres de la sélection du Prix Vendredi – 7ème édition. Alors que le Lauréat sera annoncé dans la journée, nous vous proposons de découvrir nos avis sur ces romans destinés aux adolescents.
******
La vie n’est pas tendre avec Adrien. Alors quand le soir tombe, il se débat avec des idées noires, cherche en vain le sommeil et finit par sortir marcher seul dans l’obscurité. Une nuit surgit une voix des ténèbres. Cette voix qui fait irruption sans guillemets ni description pour nous donner un peu à voir à qui elle appartient glace d’emblée. Un peu comme dans ces films d’horreur qui ne nous laissent qu’imaginer ce qui se tapit derrière la porte. C’est intrigant et magnétique : impossible de reposer ce thriller. On parcourt ces pages le souffle coupé, redoutant le drame à chaque instant. Les chapitres donnent, à petites touches, une consistance au mal-être d’Adrien, évoquent les affres du harcèlement, l’installation d’une emprise dont sa mère, aimante mais maladroitement anxieuse, peine à le protéger. Il s’agit aussi de la quête de soi qui caractérise l’adolescence et qui ressemble parfois à un exercice de funambulisme.
Les saisons passent au rythme de la voix de Chris, tour à tour galvanisante et berçante, charmante et autoritaire. Les contours de l’homme, eux, ne se précisent guère : qui est-il ? Existe-t-il vraiment ? Quel âge a-t-il ? Est-il dangereux ? La narration à la première personne nous place au plus près des expériences d’Adrien, un peu comme si on lisait ses pensées ou des vers libres jetées dans son journal : des phrases sans ponctuation surgissent parfois à un rythme rapide dans la narration, rendant la détresse du garçon presque palpable. Un livre sombre, mais hypnotique et initiatique.
******
Le narrateur garde sa cagoule mais sa voix s’impose d’emblée, franche et directe : celle d’un jeune homme au seuil de l’âge adulte embarqué (provisoirement) dans un commerce lucratif mais risqué. Dès que le charbon et les clients qui défilent lui en laissent le temps, il nous explique sans façon la marchandise et les stratégies commerciales, le recrutement des petits pour fouiller les étages et organiser le ravitaillement et les grands qui embauchent « sans discrimination » mais avec lesquels on ne plaisante pas. Sans jugement, ce roman met en lumière la brutalité du monde des tours et de la drogue, les dilemmes des jeunes qui y vivent et les illusions dans lesquelles il est si risqué pour eux de se bercer. Les mots de ce court roman percutent et bousculent. Quentin Leseigneur compose une voix lucide et sincère, tour à tour gagnée par l’espoir, les doutes et la peur. Mais cette langue scandée qui rend hommage à l’argot, au verlan et aux langues des cités sonne juste comme les dialogues des séries The Wire et Validé. Sa puissance, combinée à la densité de l’intrigue, concentrée en un midi-minuit, laissent le lecteur estomaqué. Un roman coup de poing !
******
Ce roman, truffé de citations, clins d’œil et autres références au cinéma, est un bonheur de cinéphile. Il donne envie de voir ou de revoir quantité de films. La culture transmise par Nino à sa petite fille est un véritable plaisir à lire. Tout comme sa vision d’un art dont la raison d’être et l’économie sont fortement remises en question en ce moment.
Mais Mickaël Ollivier propose aussi de beaux portraits de femmes. Portrait d’une adolescente qui s’essaye à l’écriture (puisque ce texte est présenté comme sa première tentative d’écriture), de sa grand-mère qui l’a élevée malgré son besoin d’indépendance, et de sa mère qui a préféré vivre loin de toute entrave familiale. Trois femmes aux visions de la vie très différentes, qui en viennent à cohabiter pendant le premier confinement. Car la covid tient une place prépondérante dans la dramaturgie de l’histoire dont la résolution pousse le lecteur dans ses retranchements et l’oblige à bousculer ses convictions.
******
Laurine Roux s’inspire d’une histoire vraie pour construire le récit des Enfants du Llullaillaco, deux enfants découverts morts en 1999 au sommet d’un volcan argentin, momifiés et parfaitement conservés par le froid. L’histoire s’inscrit dans deux époques, la notre auprès de scientifiques qui tentent de faire parler les corps, et cinq cents ans plus tôt, dans les pas des enfants. Les deux époques tressent une histoire emprunte de magie et de spiritisme cherchant une interprétation dans l’étude scientifique et avançant vers le destin inéluctable et tragique de ces deux enfants morts pour des croyances fortes. Le souffle du Puma est un récit fort et hyper intéressant parce qu’il prend corps dans notre réalité et met en avant un rite spirituel dont les victimes étaient des enfants. Porté par une héroïne au caractère fort, il livre un magnifique message sur le besoin, le désir de liberté.
******
1872, une goélette, baptisée la Mary Celeste a été retrouvée chavirant sans plus personne à son bord mais avec son chargement intact. Tout avait été laissé tel quel comme si ses navigants étaient partis sur l’instant, mais avec l’idée de revenir… La Mary Celeste a été retrouvée mais jamais aucun de ses naufragés. Un mystère.
Douze ans plus tard, ce célèbre et énigmatique naufrage refait parler de lui lorsqu’un vieux loup de mer arrive à Londres dans la compagnie d’assurances de la Mary Celeste avec une vieille bouteille contenant un manuscrit qui permettrait de connaître la vérité. « Spotty » Finch, 17 ans, qui seconde Basil Huntley, un passionné des naufrages, va comprendre peu à peu pourquoi son supérieur est particulièrement intéressé par cette histoire à laquelle il semble lié, et pourquoi en dépit de sa sécurité, il va tout faire pour découvrri ce qu’il s’est passé.
C’est ainsi qu’en se lançant dans les bas-fonds de l’East End, dont est originaire Spotty, Basil va remonter le fil de ses souvenirs jusqu’à son adolescence à Liverpool et sa rencontre avec une jeune fille d’un autre rang social, dont la fortune du beau-père est issue du commerce du « bois d’ébène ».
Ce roman entremêle trois fils narratifs avec une grande fluidité nous faisant ressentir les beautés et dangers de chacune des situations, faits de decisions délicates et malheureux coups du sort. A bord de la Mary Céleste sur laquelle la jeune Elsie consigne ses journées et observations dans son journal, tant sur la navigation que sur les attitudes des membres de l’équipage, entre eux, vis-à-vis d’elle, ou encore du Capitaine.
Ces passages sont immersifs et nous donnent à ressentir la houle, les embruns, les manoeuvres, les différentes tensions.
Dans Londres avec la terrible condition des enfants des rues et ce qu’il leur faut faire pour survivre, et contre qui Basil et Spotty se retrouvent.
A Liverpool où le jeune Basil vit un amour réciproque mais clandestin avec une jeune fille indépendante et vive, mais sur qui le beau-père tente d exercer une emprise terrible, l’isolant de sa famille.
Bien que l’insertion d’un personnage ne soit pas utile et que Spotty soit d’une grande maturité et culture au vu de ses origines et âge, ce roman d’aventures inspiré d’une histoire vraie est happant. Par son écriture immersive et visuelle, Stéphane Michalak nous emporte par des thématiques fortes, (émancipation féminine, emprise psychologique, amour, amitié et respect) et des personnages bien campés, confrontés à des situations intenses et périlleuses
******
Un été – peut-être plus – sur la côte basque. Loue, son frère, sa mère, sa grand-mère. Et dans le jardin de la maison familiale une tiny house occupée par une romancière, Graziella, et son fils, Inigo. Loue est passionnée de surf, et elle est vraiment douée. Mais cette année, elle surfe en solitaire, à l’heure où le soleil se lève. Cette année pas question de retrouver la bande de copains, Ben, Cannelle, Moussa, Bixente. Cette année, Loue traîne dans son sillon un parfum d’amertume, de nostalgie, de chagrin. Et tout le roman sera l’occasion de démêler ce qui a creusé ce profond sillon derrière elle, avec l’aide d’Inigo, lumineux personnage, qui au fil des cours de surf qu’il prendra auprès de Loue, lui permettra d’accepter sa vérité et de renouer avec la vie qui palpite malgré tout, là, sous la combi !
******
Après Romance et les Nouvelles Vagues, c’est avec grande fébrilité que nous retrouvons les mêmes personnages reflet d’une époque, d’une société parisienne très actuelle. Octave et Vicente (Vince) ont été amants et ce dernier supporte mal la brutale séparation orchestrée par Octave qui a préféré sans doute fuir un amour trop fort. Alors Vince qui souhaite (réellement ?) tourner la page se réfugie dans un fantasme : celui d’aimer un de ses profs. Tandis que son amie Marylin se « répare » elle aussi de sa rupture avec Octave en continuant de dessiner et espérer un jour rencontrer son héroïne-peintre Elizabeth Peyton, Titus et Lilian survivent à leur manière, l’un en aimant secrètement… l’autre en avalant des pilules pour oublier sa condition.
Tous vont se croiser, s’évoquer, se confier l’un à l’autre portant d’une seule voix cette génération d’étudiants durant le confinement. Une vie qui continue même si la situation n’invite pas à rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que finalement cet enfermement n’est pas le moment de prêter encore plus attention à l’autre et à son état psychique ? Dans ce roman choral qui s’organise en différentes phases allant du confinement au déconfinement les lectrices et lecteurs vont être les témoins des sentiments les plus profonds se jouant dans un groupe de jeunes adultes. Sans exagérer sur la place proéminente des réseaux sociaux, Arnaud Cathrine utilise les codes d’une jeunesse afin d’illustrer le rythme de l’histoire d’une douceur magnétique.
******
Dans une oasis imaginaire, Pascale Quiviger dresse une société où les femmes sont investies d’un grand pouvoir religieux. Et pour cause : le panthérisme, leur religion monothéiste, a pour objet une déesse. Ce « matriarcat » (en réalité simple contre-pouvoir face au Sultan) ne rend pas la société plus égalitaire, loin s’en faut : il est dirigé par une Infinie qui parle en prenant exemple sur Maître Yoda, la sagesse en moins.
L’ambiance « Mille et une nuit », les coutumes et croyances millénaires créées par l’auteure sont très prenantes. Et, pour les lecteurs du Royaume de Pierre d’Angle, quel plaisir de retrouver Esmée et Mercenaire ! C’est d’ailleurs l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de ce personnage mystérieux. Le lecteur s’attache vite et durablement aux personnages, qui ont tous une histoire singulière. C’est l’un des grands talents de cette auteure : créer des figures romanesques et nuancées dont on a plaisir à suivre les aventures.
******
Nous voici à l’aune de l’an 2000 dans une banlieue pavillonnaire ordinaire, à Val-de-Seine, en Normandie. C’est l’été, il fait chaud, et le temps s’écoule lentement. Romane, flamboyante rousse, est du genre réservée mais extravertie lorsque sa meilleure amie Lola, jolie blonde « parfaite » est à ses côtés. Ensemble, en rollers, petit short et rires, elles font tourner les têtes et les cœurs. Cyrus d’ailleurs, aimerait bien que Romane lui accorde davantage d’attentions, pour le plus grand dam de Chloé, son amie de toujours, dont il découvre un jour de fête, et donc trop tard, qu’elle est « une fille ». Lola, elle, rêve de paillettes et célébrité, enfin, elle veut surtout échapper à l’aura de sa mère, ancienne « Miss Normandie » qui lui serine sa perfection. Alors elle participe à un casting pour devenir chanteuse, mais derrière ses airs bravaches de fille qui se la joue femme (et qui fait comme si elle savait), innocence et naïveté sont toujours là. Gabriel lui ne veut surtout pas s’attacher pour ne pas reproduire le schéma parental, alors il passe de fille en fille, fume autant qu’il peut car ça évite de se souvenir, donc de souffrir. C’est tellement plus facile d’être le bourreau des cœurs, il n’avait juste pas prévu, pas voulu, pas imaginé, succomber. Et puis il y a Serge, un père de famille qui voit sa fille grandir, devenir femme, et ça il ne supporte pas, ça le renvoie à son âge, à sa condition, ça le met minable, alors il cogne. Violence ordinaire qui se devine derrière les fenêtres mais qu’on ne veut surtout pas entendre, savoir…
Cet été-là va changer beaucoup de choses pour eux tous, leur permettre de grandir, prendre conscience, s’émanciper, reproduire des schémas ou justement s’en échapper. Et si les époques changent avec notamment les modes de communication, certaines choses demeurent… entre adolescence, premières fois, apparences et émotions. Chaque génération voudrait s’inventer, s’affranchir de la précédente tout en poursuivant des modèles et une certaine forme de normalité. Les sentiments demeurent, seuls les moyens changent (et les références musicales aussi!!). Un roman dans la prolongement de Tom Sawyer/Huckleberry Finn et qui fait référence au « Normal People » de Sally Rooney.
******
C’est une enquête fort alambiquée à laquelle Malika Ferdjoukh convie ses lecteurs ! Alors qu’un hiver glacial s’abat sur Morgan’s Moor, de violents tourments bouillonnent sous la chape de gel : un drame ancien, une vision funestement prémonitoire, une griffe qui se lève pour frapper…
Quel bonheur de s’immerger dans ce 19ème siècle plus vrai que nature où l’on voyage en diligence et porte le tweed ou la dentelle sous l’oeil d’animaux empaillés ! Cette enquête rend magnifiquement hommage à Conan Doyle, mais aussi à Charles Dickens, Jane Austen et Bram Stoker. On pense aussi évidemment au mystère de la chambre jaune face à ce meurtre commis dans une chambre hermétiquement close.
Évidemment, chacun semble avoir quelque chose à cacher et le duo dépêché par Scotland Yard va avoir fort à faire. Ils seront secondés un peu malgré eux par la fille de l’aubergiste – ouïe fine, langue bien pendue et un aplomb déconcertant – qui se rêve de seconder en Sherlock Holmes.
Les personnages sont hauts en couleur, entre ce détective fan de Dickens, de shortbreads et de whisky gallois qui ne jure que par les siestes (dont il dit qu’elles « déploient le meilleur de ses intuitions »), cet auxiliaire timide mais fougueux, et cette ribambelle de témoins déroutants. Leurs dialogues pleins de verve sont réjouissants (« J’ai longtemps dormi avec un grand frère qui gagnait des tournois de cricket pendant ses crises de somnambulisme. »).
******
Avez-vous lu certains de ces titres ? Lequel a votre préférence ?