Il ne s’agit pas d’une sélection sur le cirque…
Mais d’un roman d’une jeune auteure belge prometteuse, Marie Colot, illustré par Rascal, belge lui aussi. Publié chez Alice jeunesse, dans la collection Deuzio.
Et qui de mieux pour partager cette lecture que ma copinaute Céline, belge elle aussi ?
Une lecture commune donc en tête-à-tête (qui n’est pas une première pour nous deux) sur un roman qui est loin de laisser indifférent : une relation particulière entre une jeune fille et une vieille dame, sur fond de drame familial…
Jugez plutôt…
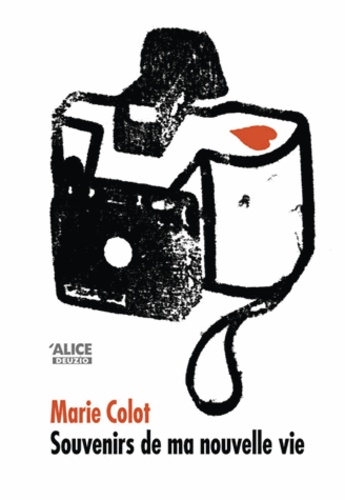
Pépita : Le titre m’a beaucoup intriguée : Souvenirs de ma nouvelle vie. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Et toi ?
Céline : Moi non plus… Surtout que le mot « souvenirs » évoque davantage le passé que l’avenir ! Du coup, ce titre m’a d’emblée intriguée ainsi que l’illustration de Rascal. Quel allait pouvoir être le dénominateur commun entre les deux ? Le résumé de 4e de couverture n’a fait que jeter davantage le trouble… J’étais ferrée. Plus qu’une seule solution : entamer l’histoire…
C’est toi qui la résume ?
Pépita : Exactement comme toi…souvenirs…nouvelle vie…un appareil photo…de quoi ça parle ?
C’est l’histoire d’une jeune fille de presque 12 ans, Charlie, dont l’ambiguïté du prénom la gêne beaucoup même si elle en joue. Elle vient de vivre le « pire des pires jours de sa vie » et ce déménagement en est la conséquence, ainsi que des parents hyper-étouffants et hyper-protecteurs. Pour tuer l’ennui, Charlie décide de faire connaissance avec ses voisins d’immeuble. Munie de son Polaroïd, elle leur demande l’autorisation de prendre une photo de la vue de chaque étage. En même temps, elle « vole » ou « emprunte » un objet de chaque personne sur son passage. Elle va essuyer des refus mais aussi faire des rencontres surprenantes, notamment cette vieille femme excentrique du troisième, Mme Olga. Va se tisser entre elles un lien curieux, fragile mais fort. Quelque chose à ajouter Céline ?
Céline : Non, cela me semble parfait… Juste préciser que Charlie a une façon bien à elle d’appréhender le monde qui l’entoure, ce qui en fait un personnage terriblement attachant qui nous accroche le cœur dès les premiers mots. Je pense que le succès de ce titre est en partie lié à sa personnalité hors du commun et à son idée géniale de voyager sans quitter son immeuble ! Son « Carnet d’exploration des étages », on aurait bien envie de l’adopter, nous aussi, et de l’adapter à notre sauce…
Pépita : Je l’ai trouvée aussi épatante cette Charlie ! Une sacrée personnalité, des ressources qu’elle puise en elle, une volonté de faire les choses qu’elle a décidé envers et contre tout, une exigence dans ses relations aux autres, un regard très lucide sur le monde des adultes, une façon de gérer le drame familial traversé et dont elle souffre aussi énormément, mais elle a décidé d’en faire une force. Sans le savoir, elle se guérit toute seule, sinon elle sent bien qu’elle pourrait s’écrouler elle aussi et sombrer. Un vrai tourbillon qui emporte dans son sillage les adultes, Mme Olga et aussi ses propres parents.
D’ailleurs, comment tu les as perçu les parents de Charlie ?
Céline : Comme des parents, foudroyés par un drame – ou plutôt des drames ! Le père tente tant bien que mal de maintenir l’église au milieu du village, mais ce n’est pas simple. La famille doit faire le deuil de tant de choses… Tous leurs repères sont bouleversés, toutes leurs façons de faire balayées. Ils ne sont plus les parents qu’ils étaient. Et qui sommes-nous pour leur jeter la première pierre car, le pire des pires jours de leur vie, personne ne voudrait le vivre ! Comme tu le dis, grâce à sa personnalité et à ses rencontres, Charlie se guérit mais, dans son sillage, elle guérit aussi son entourage. As-tu le même ressenti ?
Pépita : Oui, par rapport à ses parents, c’est terrible. Ils essaient de se maintenir la tête hors de l’eau. Le papa m’a beaucoup touchée dans sa façon de vouloir garder le cap malgré tout. Il n’a pas rompu le dialogue avec Charlie. Pour la maman, c’est très différent. Cependant, j’ai trouvé que Charlie a bien du mal à trouver sa place dans tout ça et que ses parents ne lui tendent guère de perche. Ils sont trop ensevelis par leur chagrin et comme tu dis, on ne peut pas leur en vouloir. Charlie secoue tout ce petit monde, elle refuse de se laisser submerger, elle fait un très beau chemin de résilience et réussit à redonner le sourire et l’envie de vivre à ses parents, surtout à sa maman. C’est un aspect du roman absolument lumineux.
Et Mme Olga, cette fameuse Madame Olga, comment tu l’as perçue ? Intrigante, non ? J’ai encore même du mal à comprendre leur attirance réciproque…
Céline : Oui, tu as raison pour la mère. Mais, en même temps, elle est doublement victime, et dans son cœur et dans sa chair ! Pour Olga et Charlie, je pense qu’elles ont toutes les deux les mêmes fêlures. Toutes les deux vivent des événements qui brisent le cours de leur vie, un accident pour l’une, la maladie pour l’autre. Les relations familiales ne sont en outre pas simples, ni pour l’une ni pour l’autre. Elles sont toutes les deux sur le fil… Pour ne pas sombrer, elles recourent à leur imaginaire : l’exploration des étages pour l’une, la vie par procuration pour l’autre… Elles partagent aussi cette même soif de vivre, ce même regard curieux sur ce qui les entoure. Bref, malgré leurs différences (la première étant la différence d’âge), je pense que chacune se retrouve dans l’autre et y puise la force d’aller de l’avant. Et toi, qu’est-ce qui t’intrigue tant chez cette madame Olga ?
Pépita : Ce personnage m’a mise mal à l’aise. Elle trompe Charlie et j’ai trouvé cet aspect difficile. Charlie donne plus d’elle que Mme Olga ne le fera jamais. Je l’ai « excusée » à un moment donné en me disant qu’avec l’âge, elle devenait gâteuse. Mais non. Elle se cache derrière son affabulation. Et elle la sert à Charlie qui, elle, a été loyale avec elle. Quand elle s’en aperçoit, elle le vit comme une trahison d’ailleurs. Mais une trahison qui va prendre le chemin du pardon. Dans ce roman, ce sont les adultes qui apprennent des enfants et non l’inverse.
Céline : Pour te répondre, j’ai relu la fin… Et non, je ne partage pas ton avis. Le personnage d’Olga m’a fait penser à ma grand-mère qui travestit de plus en plus la réalité. Même si Charlie est trop jeune pour mettre des mots sur ce qui arrive à son amie, elle finit par le comprendre. Le lecteur aussi, grâce au carnet d’Olga et à la petite carte qui se trouve à la fin. Une autre habitante de l’immeuble lui explique « le truc du funambule » : « Il existe un fil invisible sur lequel chacun marche. Il arrive que certains basculent. Et tombent. On ne sait où. Parce qu’il n’y a ni trou ni vide. » Olga est tombée ! Charlie le sent, ce qui explique son projet final et la chute de l’histoire…
Pépita : La résilience, c’est aussi le thème de ce roman que l’auteure a choisi d’aborder par cette métaphore de l’appareil photo de Charlie. Ce parti pris est accentué par les illustrations de Rascal : des sortes de tampons-images en noir. Tu l’as ressenti aussi comme cela ?
Céline : Oui et cet appareil a une fonction différente pour l’une et pour l’autre. Pour Charlie, il lui permet de s’évader de la cage dorée que ses parents dressent, bien malgré eux, autour d’elle et, pour Olga, c’est l’inverse il me semble : ses photos la raccrochent à une certaine réalité qu’elle fuit inexorablement. Les illustrations en noir et blanc renforcent cette idée de négatif et de positif, cette idée aussi de funambule qui, à tout moment peut basculer d’un côté ou de l’autre… De par leur duo improbable, elles arrivent à trouver un équilibre et à se sauver l’une l’autre.
Pépita : Tout à fait d’accord avec toi pour la fonction révélatrice à l’endroit à l’envers de l’appareil photo. Pour Olga, je vais donc relire la fin alors…Manifestement, je suis passée à côté de quelqu’un…
***
Dans ses romans, Marie Colot a l’art de rendre vivants ses personnages, à tel point qu’ils nous paraissent de chair et de sang ! Il suffit de parcourir notre discussion pour s’en convaincre. J’espère que celle-ci donnera envie à d’autres lecteurs de découvrir cette jeune auteure de talent. Merci Pépita pour ce moment de partage. J’ai envie d’emprunter ta citation fétiche pour conclure :
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. »
Julien Green
Ce fut doublement le cas avec ce titre !
* Nos billets :
– Souvenirs de ma nouvelle vie sur Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait LIVREsse et sur Méli-Mélo de livres
– En toutes lettres, le premier roman de Marie Colot
* Le site de Marie Colot
Son dernier roman paru en avril dernier :
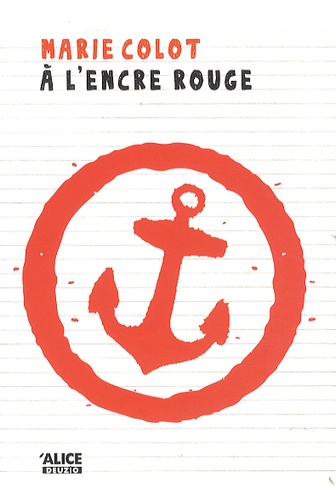 A l’origine de ce roman singulier, une aventure d’écriture collective de sept mois avec dix-huit classes d’enfants de dix à douze ans…
A l’origine de ce roman singulier, une aventure d’écriture collective de sept mois avec dix-huit classes d’enfants de dix à douze ans…










