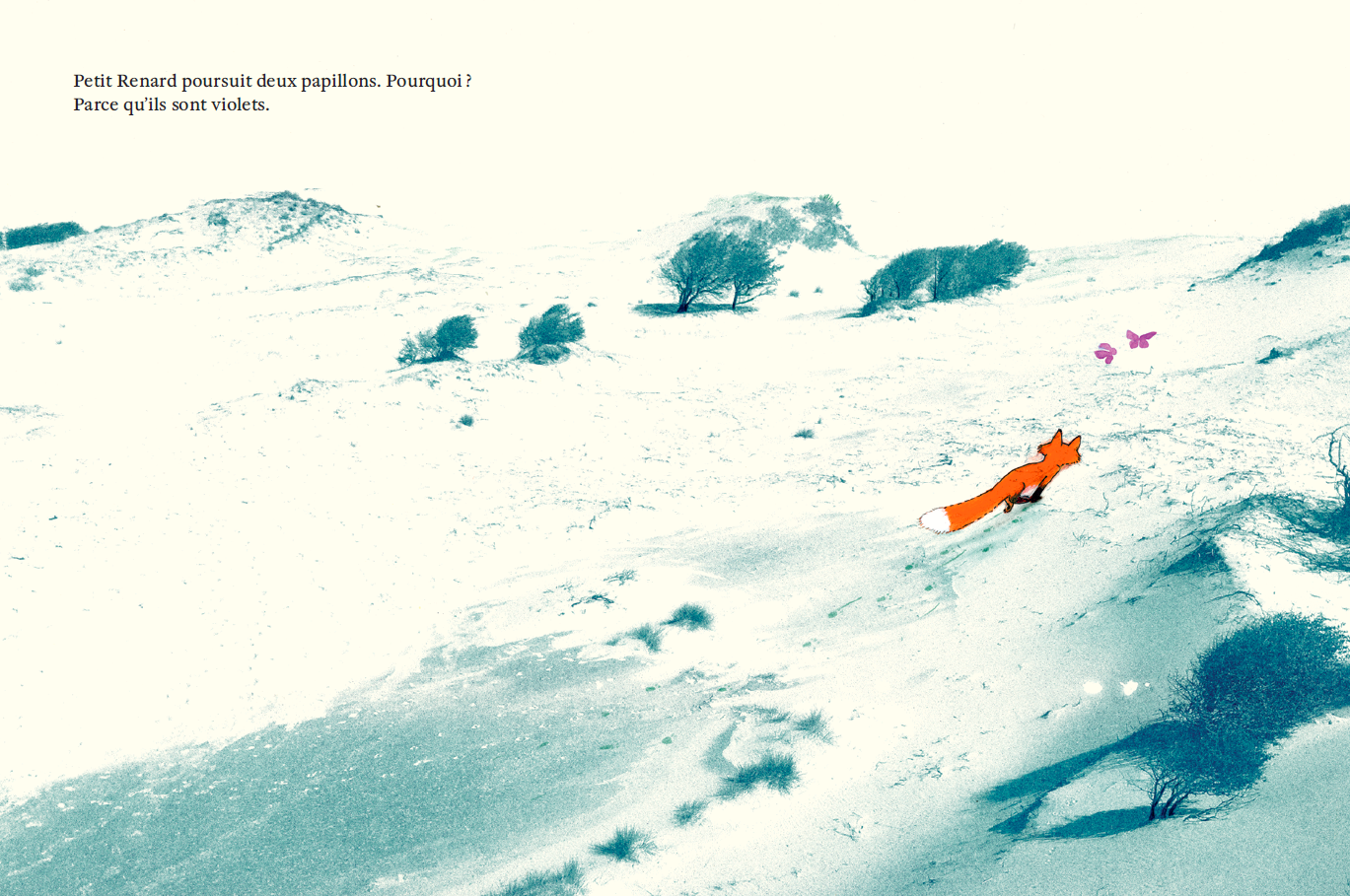« Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. » Voilà comment le dernier roman de Marie Pavlenko est présenté sur le site de son éditeur, Flammarion jeunesse. Comme À l’ombre du grand arbre, nous aimons beaucoup l’univers de cette auteure, nous nous sommes donné rendez-vous autour de cette lecture qui nous a tour à tour questionnées, déroutées, enchantées. D’abord, il y a eu #Céline, Pépita et Colette. Puis une invitée surprise, sur laquelle vous en saurez plus très bientôt, nous a rejointes. Une lecture à quatre voix pour un roman qui résonnera longtemps encore en nous.
Colette.- Et le désert disparaîtra : quel titre énigmatique, au futur intriguant ! Vous souvenez-vous de ce que vous avez imaginé en le découvrant ?
Pépita.- Très énigmatique en effet avec ce futur employé. J’ai pensé à des oasis, à une prophétie aussi. Et quand même, pas de couverture pelliculée mais une couverture douce au toucher, à caresser.
Claudia.- La promesse d’une aventure originale sur l’existence d’un monde mystérieux, mais à la fois oppressant.
#Céline.- Je suis partie sur un a priori négatif avec ce roman. Je n’attendais pas Marie Pavlenko sur un tel sujet. Pourquoi ? Sans doute à cause des deux derniers romans plus réalistes que j’avais lus d’elle et que j’avais vraiment adorés (Je suis ton soleil dont nous avions fait une lecture commune ici même et Un si petit oiseau chez Casterman qui fait partie de la sélection de notre Prix 2020 dans la catégorie « Belles branches »). Mais la couverture et le titre justement m’ont donné envie de m’y plonger. Sans même ouvrir le livre, on a déjà l’impression d’être dans le désert… A posteriori, je le trouve vraiment magnifique, comme le roman.
Pépita.- Et puis ai-je envie d’ajouter, ce titre fait très conte : « et le »….on s’attend à un aboutissement. Comme un coup de baguette magique aussi. Alors forcément on ouvre et on lit pour en savoir plus car il sait nous accrocher ce titre !
Colette – Dès que je lis le mot « désert » c’est l’univers de Jean-Marie Gustave Le Clézio qui surgit dans ma tête, souvenirs précieux et poétiques de mes lectures d’adolescente ! Tout un peuple de nomades envahissent alors mon esprit, un peuple assez semblable à celui que nous découvrons dès les premières pages du roman de Marie Pavlenko. D’ailleurs comment présenteriez-vous la tribu de Samaa, notre jeune héroïne ?
Claudia.- Les femmes ne s’occupent que des tâches domestiques. Les hommes ont un rôle bien plus important au sein de la tribu, ce sont eux, qui rapportent de quoi subvenir. Ce sont des guerriers. Même s’il y a de la bienveillance de la part des hommes envers les femmes, la marge de manœuvre est limitée pour elles. C’est très paradoxal car nous sommes dans un monde futur (une dystopie) et à la fois, les pratiques sont archaïques. C’est assez troublant.
Pépita.- Une tribu qui a su s’adapter au désert qui a tout envahi du fait de la folie démesurée des hommes et une tribu très hiérarchisée et sexiste ! Mon Dieu si c’est ça le monde qui nous attend ! Quelle régression ! Quelle absence de nature ! Quelle rudesse ! Mais en même temps, on sent aussi une sorte de bienveillance et comme une petite graine prête à éclore…
#Céline.- Je vous rejoins sur l’organisation de la vie de cette tribu. Un peu l’impression de revenir à la Préhistoire… Des conditions de vie aussi difficiles amèneraient-elles nécessairement à un tel retour en arrière? Je ne l’espère pas.
Colette – Tu parles de préhistoire #Céline, pour décrire les traditions du peuple de Samaa. Mais en fait à quelle époque semble appartenir ce récit ? Une époque troublante, non ? Comment l’avez-vous imaginée ?
#Céline.- Comme à chaque fois que je commence un roman, j’aime me situer dans l’espace et dans le temps. Ici, finalement, c’est assez compliqué. Mais cela ne m’a pas gênée car cela donne au récit un côté universel intéressant. Néanmoins, même si la mentalité de la tribu m’a fait penser à la préhistoire, je me suis plus vite située dans une époque future, pas forcément si lointaine. Finalement, une fois dans l’histoire, ces questions passent au second plan. L’avez-vous ressenti ainsi ?
Pépita.- Je me suis à peine posé la question de l’époque et je n’ai même pas pensé à la Préhistoire. Plutôt un monde futur pas du tout enviable (mais avec ce qu’il se passe en ce moment, on se dit que…) et curieusement, comme toi #Céline, ça ne m’a pas gênée. Je me suis de suite accrochée aux personnages et aux enjeux de l’histoire. Et aussi à cette quête de ressources assez énigmatique au début. Ce roman pose les choses par petites touches, et ensuite l’histoire prend son ampleur comme la ramure d’un arbre qui explose au printemps. Par contre, le fait que l’autrice ait changé les mots pour les désigner, je n’ai pas trouvé ça utile, pas vous ?
#Céline.- Inutile? Peut-être pas essentiel mais cela fait réfléchir tout de même. La tribu a tout oublié du monde d’avant jusqu’aux mots eux-mêmes, jusqu’à l’orthographe des mots liés à la nature… J’ai trouvé que cela donnait une idée de la situation et de l’état d’esprit de la tribu, aveuglée par l’urgence de survivre, obligée aussi sans doute d’oublier… Et que parvenir à retrouver les mots, cela permettrait aussi de reprendre conscience, de se souvenir de l’importance de préserver les arbres et la nature.
Pépita.- Oui effectivement, je ne l’avais pas vu comme ça ! Merci de ton éclairage ! Il n’empêche : ça m’a perturbée dans la fluidité de ma lecture mais sans doute est-ce le but en effet !
Colette.- Sur l’utilisation d’un langage altéré, je suis complètement d’accord avec #Céline, il me semble que dans toute dystopie la modification du langage est un signe important de la modification du rapport au réel, au vivant, à la connaissance et à la liberté. Cela m’a rappelé – dans une moindre mesure – la novlangue inventée par George Orwell dans 1984. Même si parfois il m’a semblé que l’auteure n’allait pas jusqu’au bout de ce parti pris, j’ai trouvé intéressant de parvenir à reconnaître certains mots -je n’y suis pas toujours arrivée au début- comme si à travers ce langage transparaissait malgré tout des vestiges du passé, que seul le lecteur pouvait comprendre parce que ces mots là étaient ancrés dans son présent. Pour moi c’était un peu comme une manière très poétique de nous alerter sur la disparition de cette nature dont nous dépendons tant. Une disparition pas si lointaine que ça…
Colette.- Cette mise en avant de la place du langage dans Et le désert disparaîtra, me fait penser à la place d’un personnage énigmatique, anonyme, sorte de gardienne de ce langage dont nous parlons : l’Ancienne. Comment avez-vous imaginé ce personnage ? Et votre perception a-t-elle changé au fil du roman ? En feriez-vous un personnage clé de l’histoire ?
#Céline.- Elle m’a tout de suite intriguée. Et surtout, ce qui m’a posé question, c’est le fait qu’on s’occupe d’elle tout en ne l’écoutant pas. Un respect pour les anciens, mais pas pour leur mémoire… Très paradoxal. Au fil du récit effectivement, on voit bien que les paroles de l’Ancienne reviennent très régulièrement en tête de Samaa. Et les petites graines semées dans l’esprit de la jeune fille au départ se mettent à éclore au fur et à mesure. L’Ancienne est effectivement pour moi un personnage clé, un guide, un repère. Elle joue son rôle alors même qu’elle reste assise dans sa tente. Et même si Samaa ne le comprend pas tout de suite !
Pépita.- L’Ancienne est la MÉMOIRE, le lien entre le monde d’avant et celui de maintenant mais aussi une prophétesse car elle fait comprendre à Samaa qu’elle réussira là où elle-même a échoué. On a le sentiment qu’elle reste en vie uniquement pour ce message-là. Il se dégage de cette personne une énergie et un respect qui peuvent tout à fait épouvanter pour qui n’a pas les clés. Oui, elle est un personnage clé, mais quel sort peu enviable pour cette vieille femme (pas très éloigné en fait de la manière dont la société actuelle considère la vieillesse d’ailleurs…), beaucoup de métaphores dans ce roman en ce qui la concerne.
Colette.- Dans cette tribu si particulière, il y a notre jeune héroïne, Samaa. Que diriez-vous d’elle ?
Claudia.- C’est une combattante. Elle est intelligente et vive. Elle s’indigne, elle s’insurge, elle s’interroge sur la manière dont la tribu fonctionne. Elle est à contre-courant des autres filles. On sent chez elle, un grand potentiel dans la suite de l’aventure. Elle est très attachante.
#Céline.- Samaa est un personnage assez étonnant. Déterminée, on le sent d’emblée, elle a un rêve a priori inaccessible qui l’incite à repousser les limites : devenir chasseuse, même si cela est réservé aux hommes. Cela m’a plu chez elle. En revanche, je l’ai aussi trouvée dure notamment avec l’Ancienne et ses théories. Influencée par la façon de penser de sa tribu, cette fermeté s’explique aussi par le drame qu’elle a vécu et par des années de survie dans un monde hostile.
Pépita.- Samaa, d’emblée, on perçoit qu’elle veut bouger les lignes. Elle est très observatrice et rebelle. Au début du roman, elle semble être comme les autres enfants de la tribu mais très vite, on se rend compte qu’elle va avoir un destin particulier. Sa vie n’est pas facile mais elle en tire toujours du positif.
Colette.- Une rebelle ? Une rebelle par rapport à la place imposée aux filles et aux femmes dans sa tribu ? Qu’en pensez-vous de cette place ?
Claudia.- Il y a un souffle féministe dans le personnage de Samaa, ce qui apporte beaucoup d’intérêt à l’histoire. Ce n’est pas que sur le thème de la fin du monde, de la survie de l’espèce animale ou végétale ou encore sur l’écologie mais c’est aussi sur les droits des femmes.
Pépita.- Une place certes utile au fonctionnement de la tribu, mais pas par rapport à ses envies d’émancipation, d’autant que son propre père l’a plus ou moins encouragée dans cette voie. Samaa, elle a des fourmis dans les jambes, elle veut comprendre. Elle exécute les tâches dévolues aux filles par obéissance et dans son fort intérieur, elle souhaite autre chose sans trop bien se le formuler au départ.
Colette.- Un père qui lui a donné une éducation différente non pas parce qu’il était précurseur d’une éducation non sexiste, mais parce qu’il n’a pas eu de fils. Malgré tout, la relation entre Samaa et son père a quelque chose de particulier, d’unique. Qu’en pensez vous ?
#Céline.- On sent effectivement qu’un lien très fort unissait Samaa à son père, qui, comme le sont certains papas, lui laissait plus de libertés (trop?) qu’il aurait dû. Par faiblesse? Par amour? Par une envie de la protéger, de la rendre heureuse dans ce monde si ingrat ? Un peu tout cela mélangé je pense et parce qu’il pressentait aussi peut-être le tempérament combatif et la force de caractère de sa fille. On sent en tout cas que ce rapport n’était pas toujours vu d’un très bon œil par les autres membres de la tribu.
Colette.- Comme on l’a déjà évoqué, le rêve de notre jeune héroïne est de devenir « chasseuse » – même si ce mot n’existe pas au féminin dans sa tribu – est- ce que vous pourriez expliquer ce que cela signifie ? Comment avez-compris les enjeux de cette fonction essentielle à la vie de la tribu ?
Pépita.- Chasseuse : dans la tribu c’est une fonction d’hommes. Il s’agit de partir toujours plus loin et d’affronter mille dangers (trous de sable, bêtes féroces, autres tribus chasseuses elles aussi et en concurrence). Il faut trouver les arbres de plus en plus rares (du fait de l’hostilité de l’environnement mais surtout de l’avidité des hommes) pour récupérer le bois, le vendre à la ville pour pouvoir s’acheter de quoi survivre. Pour moi, il remplace symboliquement l’argent. On en veut toujours plus. On étend ses frontières pour aller le chercher plus loin. Et ce commerce représente la société de consommation. Au féminin et rapporté à Samaa, il prend un autre sens : plus symbolique. Samaa pressent qu’il y a autre chose. Elle a une vision plus large de son environnement. Ses sens sont à l’affût, elle absorbe tout, réfléchit et agit. Elle fait preuve de sensibilité. Alors que les hommes chassent uniquement dans un même but, comme des brutes épaisses et viriles. Ils en font un peu trop sur leur rôle, je trouve.
Colette. – Pour rebondir sur ce que tu dis Pépita, personnellement j’ai du mal à me faire une idée de ce que sont les hommes de la tribu de Samaa car il n’y a pas vraiment d’autres personnages que Samaa qui soient explorés. Il y a ce jeune homme de la tribu dont parle souvent Samaa, Kalo, mais au final, son portrait reste très superficiel. On y reviendra, mais cette absence de diversité des voix des personnages est un des aspects du roman qui m’a déçue – par rapport à mes attentes vis-à-vis de cette auteure dont j’ai adoré les autres romans sans bémol.
Pépita.- Tu as raison de le souligner mais en même temps une grande partie du roman est focalisée sur l’aventure et la découverte de Samaa. Donc cela occulte le reste.
#Céline.- Concernant les personnages, j’en ajouterais un, pas humain mais important : l’arbre auprès duquel Samaa survit. Pour moi, il occupe une place essentielle dans ce roman et à son contact, l’héroïne apprend et grandit. Enfin, c’est comme ça que je l’ai ressenti.
Claudia.- Les hommes sont en second plan même si ce sont eux qui font vivre la tribu. On peut penser que les hommes ont le pouvoir mais pas du tout… Ce qui explique peut-être que nous n’avons pas beaucoup d’éléments sur eux. La véritable force de la tribu semble être les femmes. Notamment, Samaa mais aussi la vieille femme qui transmet la mémoire et le savoir des ancêtres. Et celle qui sauvera le monde est une jeune fille. Je pense même que les personnages ne sont pas les composants les plus importants dans ce conte… Mais peut-être sont-ce les trésors enfouis sous le sable qui ont la vedette ? Les arbres, la végétation, l’eau, les petites bêtes, ce sont eux qui vont pouvoir sauver et changer le monde. C’est peut être la raison des longueurs pour donner toute l’importance de ces découvertes. Pour ne pas oublier que les éléments indispensables à la vie (l’eau, le sol, l’air, la lumière, la température) sont précieux et que sans eux, les Hommes ne sont rien ?! Un texte philosophique destiné aux jeunes lecteurs, non ?
Colette.- La focalisation intensive sur le personnage de Samaa donne un rythme très particulier à ce roman. Le rythme du récit m’a longtemps semblé s’étirer dans des longueurs incroyables, le fait que le texte ne soit pas chapitré a beaucoup joué sur cette impression de longueur, de lenteur. Mais en fait ce rythme là au final n’est-il pas un personnage à part entière du roman ?
Pépita.- Non, ce rythme de récit ne m’a pas perturbée, je pense que l’autrice a très vite pris le cap de la découverte de Samaa. Elles sont approfondies ces pages sur ces découvertes au fond de son trou comme un ré-apprentissage émouvant pour nous qui lisons ces lignes. Du coup, comme je disais plus haut, cela pour moi a occulté le reste. Je me suis focalisée là-dessus avec délice et appréhension mêlés.
#Céline.-Pour ma part, le rythme, sans chapitre, dans un souffle, m’a portée de bout en bout. J’ai trouvé que c’était très agréable. C’est assez rare cette façon de procéder. Et néanmoins, il y a quand même quelques pauses, qui permettent de reprendre notre souffle, à certains moments importants. Le rythme avec cette narration continue, c’est pour moi un point fort de ce livre !
Colette.-Revenons-donc à la dimension philosophique : je dirai en effet comme Claudia que l’on peut comparer ce roman à un conte philosophique, un conte philosophique sur le pouvoir des histoires. Samaa va changer radicalement le point de vue de son peuple sur les arbres grâce au récit de son expérience. Qu’en pensez-vous ? Cela me fait penser au texte de Nancy Huston sur ce qu’elle nomme « l’espèce fabulatrice ». Cette espèce, c’est nous, l’espèce humaine qui ne s’est construite en tant que société que depuis qu’elle sait raconter des histoires, ces histoires qui font que nous accordons de l’importance, de la valeur à ce qui n’en a pas intrinsèquement (par exemple : l’argent, simple bout de papier ou de métal). Ou inversement ce sont ces mêmes histoires qui peuvent nous ramener à l’essentiel, comme ici. Est-ce à cette portée là que vous pensiez ? A quoi vous a fait réfléchir ce livre ?
Claudia.-Je pense que la portée d’un texte comme celui-ci, est de nous ramener à l’essentiel. C’est une réflexion sur le monde mais aussi une manière de sensibiliser les plus jeunes. L’histoire vécue par Samaa me fait penser à un « livre sacré » que les futures générations pourraient lire et sur lequel elle s’appuierait pour comprendre les conséquences de la destruction de la nature et de l’environnement.
Pépita.-J’ai beaucoup aimé l’idée de commencer ce roman avec le LIVRE et de le terminer avec. Avec des rappels de sa présence par moments entre Samaa et son père. Au début très énigmatique, il prend tout son sens à la fin. Une belle mise en abyme car n’étions-nous pas dans la même situation nous lecteurs en ouvrant ce roman et en le terminant ? ll y a aussi dans cette histoire une dimension sur la transmission très forte, et le livre et son histoire en font partie comme effectivement quelque chose de l’ordre du sacré.
#Céline.- Je rejoins Pépita et Claudia sur la notion de transmission et de sensibilisation. Ici, ce texte nous renvoie à des problématiques actuelles, à notre manque de discernement dans les choix que l’on fait aujourd’hui sans tirer leçon des erreurs du passé. Ce roman nous invite à réfléchir sur nos actes, les conséquences pour demain. Il a une sorte de portée universelle transposable à bien des domaines et des sujets
Colette.-Chères Arbronautes, avez-vous des choses à rajouter ? Sur la personnification de la végétation ? Des petites bêtes ? Sur l’auteure ?
Pépita.-Ce que j’ai particulièrement aimé, c’est quand Samaa découvre la beauté et l’ingéniosité de la nature. C’est très beau et cela nous oblige nous aussi à regarder la nature avec plus d’attention. Y compris la plus petite des araignées ! Et combien j’ai suffoqué d’indignation quand sa tribu, qui la retrouve, détruit tout sans daigner l’écouter une seule seconde ! J’ai eu peur pour elle, j’ai été heureuse qu’on la retrouve mais le répit n’est que de courte durée. Cependant, la lecture du LIVRE à la fin donne une note d’espoir : tout ceci n’était pas vain. C’est vraiment un très beau livre.
Claudia.-Lorsque Samaa découvre et regarde minutieusement les petites bêtes, les pousses de l’arbre, l’eau qui coule… C’est pour moi, la représentation de l’innocence, de l’authenticité, de la beauté du monde à l’état pur.
#Céline.-Je dirais juste que quoi qu’elle écrive, Marie Pavlenko sait me toucher et bien souvent me faire pleurer… Honnêtement, ici aussi, elle a réussi à me faire verser quelques larmes…
Colette.-C’est un texte très particulier finalement, entre philosophie et poésie, à la croisée des chemins, comme nous le sommes peut-être aujourd’hui, à l’heure où le rapport entre l’humain et la nature (qui ne devraient pourtant pas être opposés) est tragiquement problématique. À l’heure où il nous faudrait collectivement changer radicalement de mode de vie. Guidé.e.s par la jeunesse qui ne cesse de nous montrer la voix, tous les vendredis, en faisant la grève pour le climat…
*****
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’avis de Pépita au cœur de son Méli-mélo de livres, celui de Céline sur HashtagCéline et celui de notre invitée parmi Les Lectures de Claudia.
*****
Et si vous aviez manqué notre sélection autour des problématiques écologiques ou que vous souhaitez poursuivre la transmission de ce questionnement aux jeunes lectrices et jeunes lecteurs autour de vous, n’hésitez pas à faire un tour par là : Et si on leur parlait écologie :