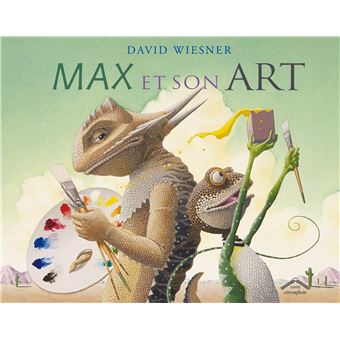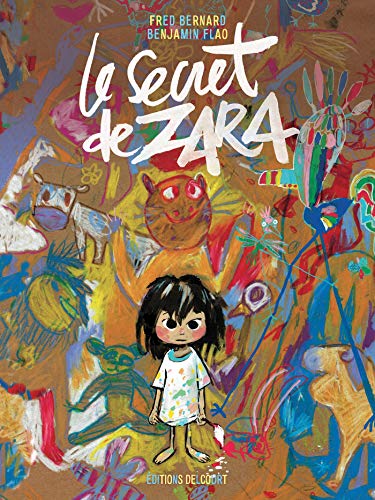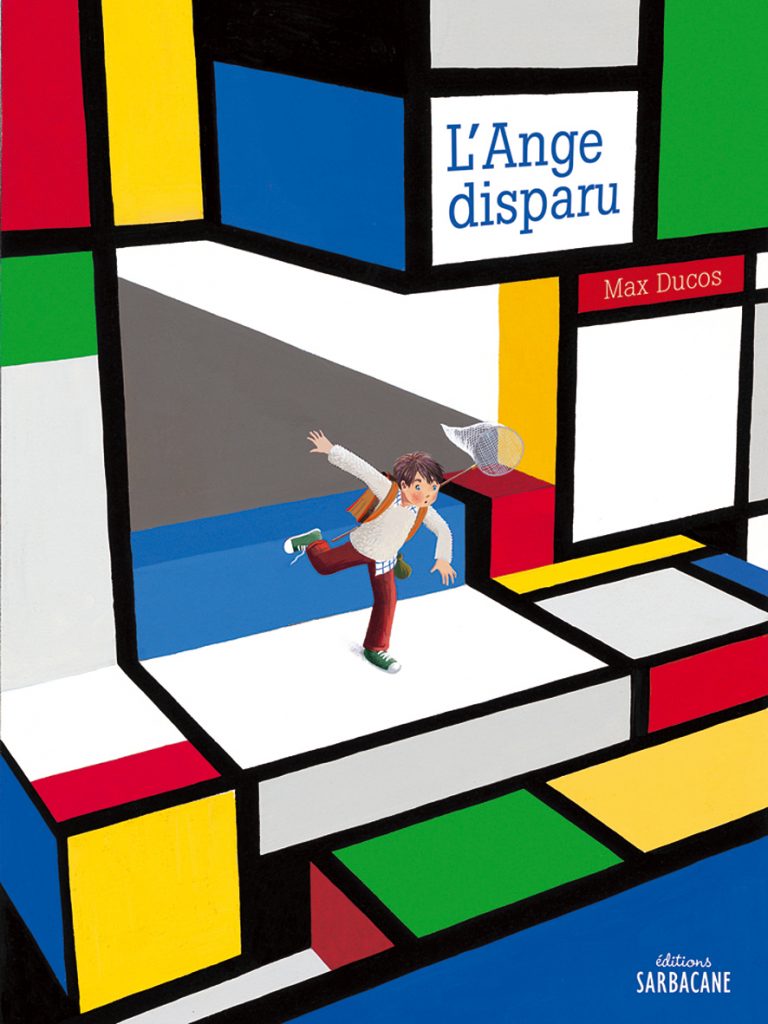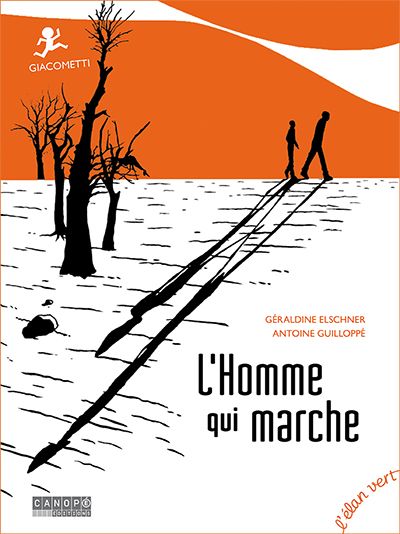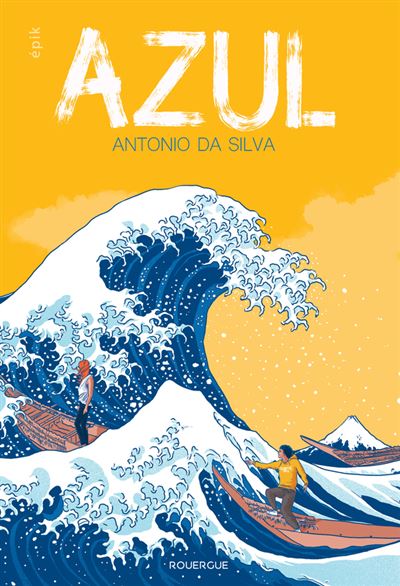Je préfère vous prévenir : cette lecture commune sera un peu particulière.
Pour deux raisons.
Tout d’abord parce que c’est une lecture commune d’un livre qui n’est pas explicitement destiné à la jeunesse mais publié en littérature générale. Mais ce roman a été un tel coup de cœur, que deux d’entre nous ont voulu échanger à son sujet et quoi de mieux que s’asseoir à l’ombre de notre grand arbre pour en discuter.
Et puis c’est surtout une lecture commune particulière parce que c’est la dernière que Pépita aura faite pour Le Grand Arbre. En effet en mai dernier, elle a décidé de quitter l’aventure collective après neuf ans de débats, de sélections thématiques, d’entretiens, de lectures communes, de swaps, de bookcamps… Au fil de ses milliers de messages sur le forum, Pépita a nourri nos échanges de sa vision généreuse de la littérature jeunesse, faisant découvrir à toute une génération de blogueuses les trésors de l’édition jeune public.
Pépita, si tu passes par là, pour ta présence lumineuse qui a irradié des racines au faîte de notre grand arbre, nous te remercions.
******
Colette. – Quand tu as découvert ce titre Les enfants sont rois, qu’est-ce que ces mots ont convoqué en toi ? Personnellement j’ai directement pensé à cette critique qu’on a souvent faite à la pédo-psychiatre Françoise Dolto qui mettait l’enfant à l’honneur dans sa pratique, transformant selon ses détracteurs, les enfants en tyrans de leurs propres parents.
Pépita.- En fait, je me jette toujours sur les romans de Delphine de Vigan sans trop regarder de quoi ça parle ! Je l’ai pris comme un respect à avoir envers eux. Et en lisant, je te rejoins. Malheureusement, j’ai un peu deviné assez rapidement ce que cela voulait dire au fur et à mesure de cette histoire. Mais ce fut très intéressant de voir comment l’autrice en a entremêlé les fils.
Colette. – Justement avant de revenir à cette intrigue où « les enfants sont rois », est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu te jettes sur les livres de Delphine de Vigan ? Je suis comme toi et je ne réfléchis pas trop avant d’acheter un roman de cette auteure. Cette fois d’ailleurs, je ne savais absolument rien du livre avant de l’acheter, une amie en a parlé en coup de vent dans un échange de SMS et hop le lendemain je l’avais sur ma table de chevet !
Pépita.- Difficile de répondre ! Je la lis depuis longtemps et je n’ai jamais été déçue. Elle a une façon d’aborder ses sujets que je trouve profonde sans juger, et surtout ses personnages sont remarquables d’exactitude, elle parle des femmes, et si bien ! Une écriture à la fois précise et simple et une construction toujours efficace. Ses romans sont sujets à discussion, au sens où ils éveillent en nous des questionnements. Elle a l’art de mettre le doigt là où ça nous titille sans vraiment se l’avouer ou se le formuler clairement
Colette. – Je savais que c’était une question difficile car moi même je ne saurais quoi répondre tellement c’est un tout, une œuvre de Delphine de Vigan. Comme tu l’as dit, c’est à la fois une structure narrative ingénieuse, des personnages féminins intenses, et des tabous, ses propres tabous, à faire exploser tout en subtilité. Bon en fait, j’avoue j’ai vécu de vraies expériences psychologiques intenses avec des livres de cette femme que ce soit avec Rien ne s’oppose à la nuit ou encore Les Loyautés. Ces livres-là ont laissé de satanées traces en moi… Du coup, sans doute que je cours après la promesse de nouvelles expériences marquantes en me plongeant dans ses livres dès qu’ils sortent. C’est un peu comme si elle m’était familière. Pas une amie. Pas une sœur. Une présence à qui j’aime croire que je ressemble. Revenons à Les enfants sont rois. A quels enfants ce titre réfère-t-il ?
Pépita.- Ce titre réfère d’abord aux deux enfants de l’histoire mais il s’adresse aussi et surtout à TOUS les enfants dont les adultes manipulent le droit à l’image.
Colette. – Peux-tu nous en dire un peu plus sur Sammy et Kimmy, les enfants de l’histoire ? Sont-ils vraiment les héros de cette histoire ?
Pépita.- Sammy et Kimmy, un garçon et une fille qui depuis leur plus jeune âge sont sur les réseaux sociaux : chaque moment de leur vie est filmé, partagé. Leur mère en a fait son business. Elle-même a participé à un épisode de télé-réalité, oh ! si peu : une recherche de reconnaissance énorme pour elle puisque ce fut un fiasco, qu’elle a transposé de façon obsessionnelle dans sa vie adulte. Sa famille – son mari la suit aussi – ne vit que pour cette chaîne, en concurrence avec d’autres. Voilà pour le cadre ! Ta question Colette laisse sous-entendre que tu penses que les deux enfants ne sont pas les héros de l’histoire. Moi je pense que oui. Est-ce la mère ? Sans doute aussi. Mais je préfère me mettre du côté de la souffrance de ces enfants. On pourrait penser aussi que les gagnants – et non les héros – de cette histoire sont les réseaux sociaux. De ce point de vue là, oui, ils le sont. Une autre héroïne, et pas des moindres, c’est la policière chargée de l’enquête. Elle, c’est une héroïne invisible du quotidien.
Colette. – Et c’est mon personnage préféré, Clara. Parce qu’elle est toute petite, peut-être. Kimmy dira d’elle, devenue adulte : « Elle s’est souvent demandé pourquoi elle se souvenait de cette femme, alors que sa mémoire a effacé les autres visages […] En la découvrant ce matin, si petite et en même temps si magnétique, elle a songé que c’était peut-être parce qu’elle avait la taille d’un enfant. » – tu comprendras sans doute pourquoi ça me parle.
Si je t’ai posé la question du statut des personnages et plus particulièrement du statut des héros romanesques, c’est parce que pendant toute la première partie du roman, finalement Kimmy et Sammy, les enfants qui donnent pourtant le titre du roman, sont complètement objectivés. On ne connaît ni leurs pensées ni leurs sentiments. Ils sont sans cesse sous l’œil de la caméra de leur mère et de milliers de spectateurs et de spectatrices mais que sait-on d’eux vraiment ? Ils sont parfois décrits physiquement mais c’est tout. Il faudra attendre qu’un certain nombre d’années soient passées pour qu’enfin la romancière fasse entendre leur voix. Et je trouve ce choix narratif tellement riche de sens. Sans jamais donner de leçon moralisatrice sur ce que Mélanie a fait subir à ses enfants, Delphine de Vigan nous fait vivre à travers ses choix d’écriture la dépossession, l’asservissement, la perte d’identité de ses personnages. Et si la véritable héroïne de cette histoire, c’était Elise Favart, celle grâce à qui la voix des enfants va paradoxalement pouvoir se faire entendre ? Celle grâce à qui on va pouvoir basculer du présent vers l’avenir ?
Pépita.- C’est curieux parce que tu vois, je les voyais ces enfants, je les ressentais, surtout dans la première partie, je les ai imaginés. Beaucoup moins dans la deuxième partie dans laquelle je les ai trouvés moins vivants en quelque sorte, comme éteints. C’est certain qu’Elise a joué un rôle primordial mais elle n’est pas si valorisée que cela dans le roman. Je la vois plus comme un déclic. Elle fait le passage entre les deux parties
Colette. – En lisant ta réponse, je me disais justement que l’autrice ne semble pas valoriser un personnage plus que l’autre si ? Quel a été ton préféré, si tu en as eu un ? Et pourquoi celui-là ?
Pépita.– Tu as raison de le souligner : l’autrice a vraiment adopté un ton neutre, presque « froid »: tout est dit sur un ton égal, comme pour atteindre une certaine normalité alors qu’en fait, toute cette histoire est tout sauf normal. J’ai un petit faible pour la policière, c’est certain. Tout est droit chez elle, une abnégation sans failles. La mère m’a à la fois agacée au plus haut point mais en même temps je ne pouvais m’empêcher d’avoir une forme de compassion pour elle. Comment ne pas se rendre compte qu’on rend ses enfants malheureux ? Comment ne pas se rendre compte de cette spirale infernale ? ça frise le voyeurisme non ? Tu l’as ressenti comment toi cet aspect du roman ? Toutes ces mises en scène factices jusqu’à l’écœurement….
Colette. – En fait, ce que j’ai trouvé très fort c’est d’avoir introduit le récit à l’époque où la téléréalité a commencé en France, comme pour « justifier » ce que vont être les choix de vie de Mélanie. Ce moment là, je m’en rappelle comme si c’était hier. J’étais une jeune adulte et avec ma sœur, encore adolescente, on regardait régulièrement Loft story. Et je me souviens très bien de ce sentiment totalement paradoxal qui m’envahissait alors : le sentiment de faire quelque chose de mal – comme un.e enfant qui fait une bêtise – et en même temps l’envie irrépressible de voir jusqu’où ça pouvait aller, ces relations forcées. Il y avait quelque chose de fascinant, qui tenait sûrement de l’aspect expérimental du projet : des humains dans une sorte de laboratoire, à la vue de toutes et de tous. Mais le XXIe siècle est allé encore plus loin que ces émissions de télé-réalité, le XXIe siècle a réussi à produire des personnages capables de vouloir mettre en scène eux-mêmes leur propre vie, avec leurs propres moyens, grâce à un média bien plus invasif que la télévision : j’ai nommé le dieu de notre époque, Internet. Il n’y a qu’à nous écouter. Tu cherches comment aller d’un point A à un point B ? Demande à Internet ! Tu veux savoir quoi faire pour le dîner ? Demande à Internet ! Un petit résumé du roman à lire en cours de Français ? Demande à Internet ! Tu veux prendre RDV pour te faire vacciner contre le coronavirus ? Demande à Internet ! Aujourd’hui, la Pythie des temps modernes, c’est Internet. D’ailleurs souvent mes élèves me parlent d’Internet comme si c’était quelqu’un, quelqu’un d’omniscient et d’omnipotent. Quelqu’un à qui elles et ils délèguent leur savoir, soit dit en passant. Tout ça pour dire que l’autrice a tellement bien introduit l’histoire de Mélanie que finalement, je n’ai pas été écœurée, ni choquée, ni étonnée. Et c’est peut-être ça le pire avec cette histoire : je ne connaissais pas du tout les chaînes Youtube au cœur de la narration, et bien ça ne m’a pas étonné. Que des gens choisissent d’utiliser leurs enfants comme outil de publicité permanente et bien, oui, c’est vraiment désolant, mais ça ne m’a pas étonné. Par contre comme toi, en tant que parent, je me suis demandée comment on pouvait se détacher à ce point de ses enfants. Au point de ne plus savoir s’ils vont bien. Au point de ne plus même y penser. Mais ce qu’interroge Delphine de Vigan, c’est comment, nous, en tant que société, on peut laisser faire ça au vu et au su de tout le monde. Est-ce que comme moi, tu t’es sentie interrogée, notamment dans ta propre utilisation des réseaux sociaux ?
Pépita. – Je ne me suis pas du tout sentie interrogée dans mon utilisation des RS ! Je n’y mets jamais ma photo ni celle de ma famille par exemple. Mais plutôt comment la société pourrait prendre du recul par rapport à cette utilisation. Quels garde-fous ? Quelles limites ? Quels avertissements ? Quelle formation citoyenne ? C’est surtout ça qu’interroge ce roman.
Colette. – Je me suis sentie interrogée non en tant que productrice de contenus mais comme utilisatrice. Si les gens se sont mis à exposer leur vie, c’est que d’autres gens les regardent faire. Je t’avoue que sur Instagram c’est ce qui me dérange toujours : montrer ce qu’on mange, montrer où on part en vacances, montrer où on vit. Ce n’est pas juste une question de montrer les visages de sa famille, il me semble que ça va plus loin. Pourquoi on fait ça ? Comme Mélanie, je crois qu’on court après les likes.
Mais tu as complètement raison, la question la plus intéressante, c’est celle des garde-fous. Tu sais combien cette question m’intéresse depuis que j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux suite à la mort de Samuel Paty et aux horreurs que mes élèves me racontaient. Le garde-fou le plus évident pour moi, c’est la morale. Mais visiblement la morale n’est pas la même pour tous. Alors il y a la loi. Mais encore faut-il qu’elle soit appliquée… Concernant la structure du roman en deux parties. J’ai trouvé ce choix très surprenant par rapport aux autres romans de Delphine de Vigan. Qu’en as-tu pensé ?
Pépita. – Oui c’est vrai que ses romans sont bien plus linéaires d’habitude. Comme je le disais plus haut, cette césure en deux parties, c’est comme si il y avait deux côtés d’une réalité. La première une réalité virtuelle et la seconde la réalité réelle. La première enjolivée et la deuxième réaliste. C’est l’arrestation de la kidnappeuse qui fait la césure. Ce n’est pas ça qui l’intéresse l’autrice : c’est montrer ce décalage entre ces deux réalités très différentes. Et cela a pour effet d’amplifier davantage les dégâts causés.
Colette. – Et le fait que la deuxième partie nous propulse en 2031, dans le futur, est-ce que cela ne donnerait pas un petit côté science-fiction à ce roman ? Est-ce que tu y as vu un sens particulier au choix de cette date ?
Pépita.- Elle veut simplement montrer ce que sont devenus ses personnages. Je n’y ai pas vu de la science fiction, mais juste la continuité de la vie.
Colette. – Oui, tu as sans doute raison, peut-être que 2031 est une date choisie simplement pour que toute l’histoire « colle » avec la seule date réelle du roman qui est la première de Loft Story en 2001. J’y ai vu aussi une manière de nous interroger sur ce que nous allons faire des 10 années qui nous séparent de cette échéance pour mieux protéger nos jeunes, notamment, sur les réseaux sociaux. Au fait, est-ce que tu es allée voir des vidéos sur Youtube d’enfants influenceurs ? Et si oui, qu’as-tu éprouvée ?
Pépita. – Non je ne suis pas allée voir des vidéos d’enfants influenceurs car déjà les vidéos de youtubeurs, j’ai beaucoup de mal. Il y a un truc dont j’aurais souhaité qu’il soit approfondi : c’est la loi ! J’ai trouvé ça incroyable qu’elle soit autant balayée ou contournée plutôt. S’agissant d’enfants, tout de même ! Faut que je prenne le temps de creuser. Tu as été interpellée aussi j’imagine ?
Colette. – J’ai surtout été dégoûtée d’apprendre que cette loi existe et que simplement – comme tant d’autres censées nous protéger – elle n’est pas appliquée, il n’y a pas assez de professionnels employés pour vérifier qu’elle est respectée. C’est comme pour les contenus irrespectueux sur internet, sur les réseaux notamment, la loi existe mais encore faut-il qu’elle soit faite respecter par des forces de l’ordre dédiées à cette tâche (et je ne sais pas si ça existe).
Colette. – Des deux citations mises en exergue de chaque partie du livre, laquelle préfères-tu ?
« Nous avons eu l’occasion de changer le monde et nous avons préféré le télé-achat. » Stephen King.
ou
» On pressentait que dans le temps d’une vie surgiraient des choses inimaginables auxquelles les gens s’habitueraient comme ils l’avaient fait en si peu de temps pour le portable, l’ordinateur, l’iPod ou le GPS » Annie Ernaux.
Pépita. – Je préfère celle d’Annie Ernaux car elle englobe le sujet plus largement je trouve. Ce roman, ce n’est pas que sur le télé-achat mais sur les RS et ce que nous en faisons.
Colette. – Pour conclure, à qui conseillerais-tu ce roman ? Avec des amies enseignantes, on en a un peu discuté : certaines, très emballées, le proposeraient à des élèves de 3e, d’autres non. L’une d’elles hésitait à le proposer à ses parents qui ne sont pas du tout connectés.
Pépita. – Je le conseillerais à des adultes mais aussi et surtout à des ados ! Je rejoins tes collègues ! Pour ceux qui ne sont pas connectés, ils risquent d’halluciner et de prendre les connectés pour des zombis ! Mais c’est peut-être pour ça qu’ils ne le sont pas justement. Ce roman est d’utilité publique !
******
Et pour continuer de nourrir vos réflexions sur l’utilisation d’internet notamment par nos jeunes, la semaine prochaine, nous vous proposons une sélection thématique sur une pratique émancipatrice du net !
******
Et n’oubliez pas que vous pouvez toujours lire Pépita sur son blog MéLi-MéLo de LIVRES et sur les réseaux sociaux associés pour profiter autrement de son regard amoureux de la littérature jeunesse et continuer de suivre avec elle le précieux précepte de Julien Green :
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. »