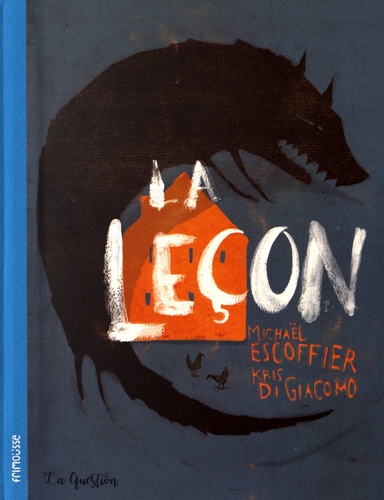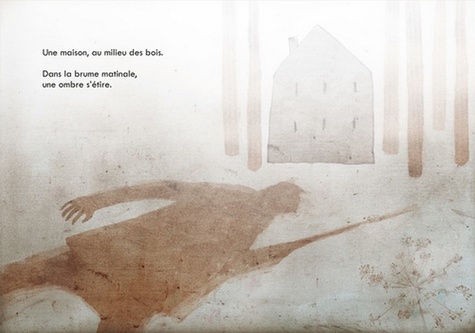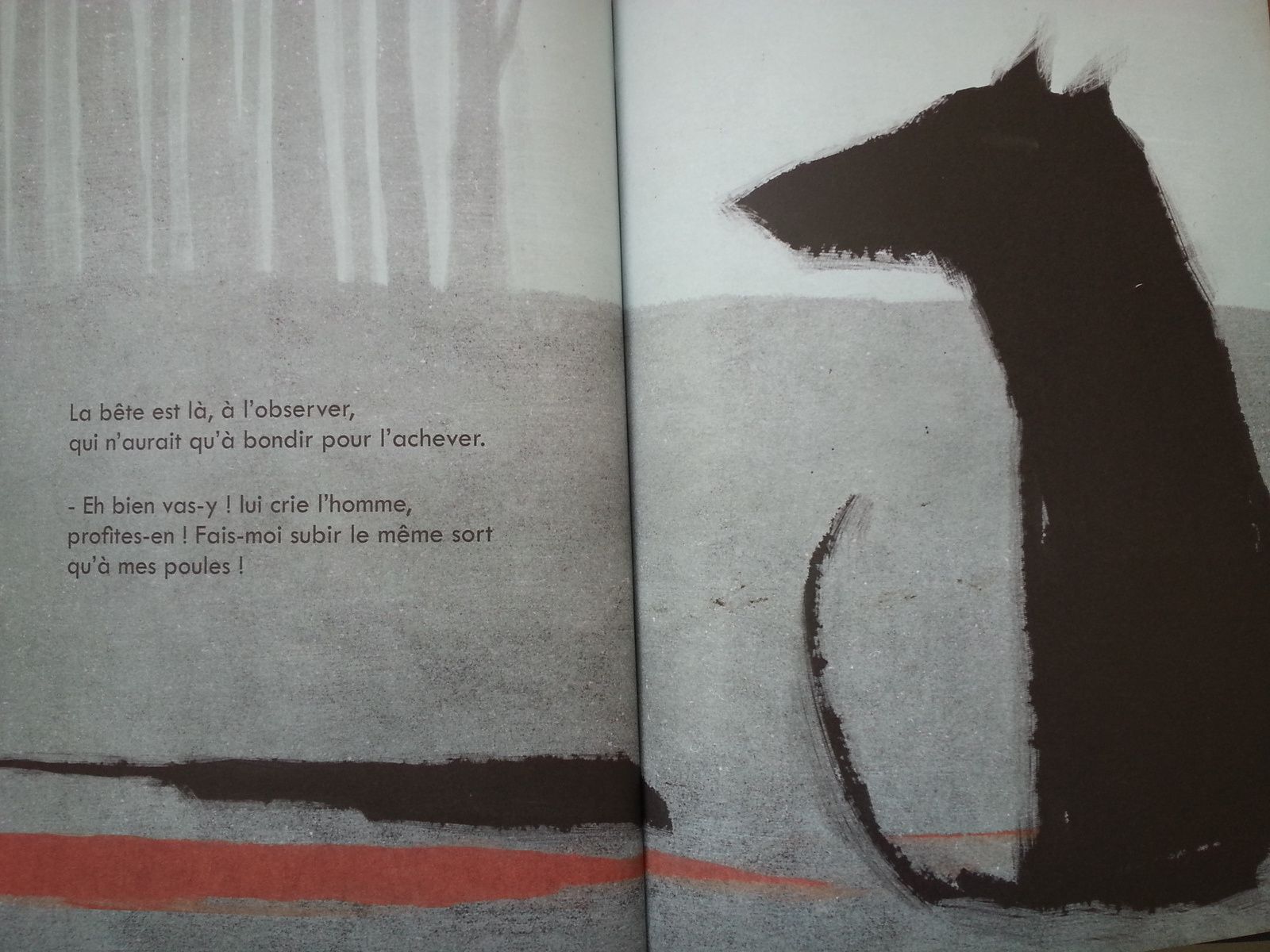Aimé de Claire Clément et Benjamin Strickler, publié aux éditions Talents hauts est un petit roman, de ceux que l’on peut proposer en premières lectures. Un petit roman qui dresse le portrait tendre et très cruel de cette enfance qui raille aussi bien qu’elle joue, qui blesse autant qu’elle caresse.
Un petit roman qui nous a questionnées sur le rôle des prénoms que les parents donnent à leurs enfants, sur leur portée symbolique, sur ce que nous y mettons et sur ce qui nous échappe. D’ailleurs nommer, n’est-ce pas le début d’exister ?
****************************************************************************************************
Colette : En lisant le titre de ce petit roman, qu’est-ce que vous avez imaginé ? A quoi vous a fait pensé ce petit mot tout simple « Aimé » ?
Pépita : Tout de suite à un enfant désiré très fort. Si fort que le prénom qu’il portera toute sa vie en sera la preuve vivante….mais parfois lourd à porter non cette si belle intention ?
Sophie : J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait du prénom de ce petit garçon sur la couverture. On imagine que cela est synonyme de l’importance de sa naissance et de l’amour qui l’entoure. Et en même temps, le nuage noir qui sert de fond au prénom présage qu’il n’est pas si simple à porter.
Colette : Pour la maman du petit héros de ce livre, le prénom de son fils recèle une vraie force symbolique qu’elle lui explicite très clairement : « Aimé, tu es l’enfant de l’amour, du plus grand amour de toute ma vie. ».
Quelle importance a pour vous le prénom que l’on porte ou que l’on donne à ses enfants ? Pensez-vous que cela soit important d’expliquer le choix de son prénom à son enfant et que cela lui donne des clés, une force, une confiance particulière… ?
Sophie : Je ne sais pas si c’est si facile que ça. Bien sûr parfois, le prénom que l’on donne est fort de symbole ce qui peut le rendre lourd à porter. Mais d’autre fois, il s’impose aussi comme une évidence sans que les parents ne comprennent vraiment : une sonorité, une référence plus ou moins précise. Je ne doute pas qu’un prénom puisse influencer celui qui le porte, mais je pense que c’est surtout l’inverse : celui qui le porte va lui donner un sens pour les autres.
Colette : Un prénom lourd à porter en effet dans ce petit roman, non pas parce qu’il est riche d’une précieuse symbolique pour les parents du petit garçons mais parce que les élèves de l’école de notre petit héros s’en moquent ouvertement : «Aimé-mé-mé, si tu crois qu’on va t’aimer. » En parlant de ce roman avec des enseignants notamment, j’ai entendu « encore un livre sur le harcèlement »… est-ce vraiment encore un livre sur le harcèlement à vos yeux ?
Pépita : Je ne parlerais pas de harcèlement non mais de moqueries qui pourraient déboucher sur un harcèlement si rien n’était fait. Heureusement, Aimé s’en sort ! C’est tout de même une lecture qui s’adresse à de jeunes lecteurs et on est chez Talents hauts, un éditeur qui sait aborder des sujets lourds avec tact et intelligence. Je trouve que c’est un raccourci qui démontre la proportion de l’adulte à interpréter.
Et si vous souhaitez lire l’avis complet de mes copinautes :
***************************************************************************
Après cette lecture commune, nous nous sommes offerts une joyeuse digression sur le choix des prénoms de nos enfants, de nos pseudos ou des noms de nos animaux ! Je vous en livre ici quelques bribes :
Nos enfants
Colette : en amoureuse inconditionnelle des mots, j’ai toujours eu une passion pour l’étymologie, alors je voulais des prénoms qui avaient un secret caché dans leur étymologie pour mes garçons, un prénom qui raconte déjà une histoire dans le mystère de ses origines. Il y a tout ce que représente pour nous l’enfant dans le choix de leur prénom : quelque chose de sacré, quelque chose de généreux et quelque chose d’ancestral.
Solectrice : Pour les prénoms de mes filles, comme on aime voyager, on voulait des prénoms internationaux et de deux syllabes (comme leur nom est déjà long). Comme Colette, j’attachais aussi de l’importance à l’étymologie : l’une est liée à la lumière, l’autre à la noblesse.
Pépita : j’aime particulièrement les prénoms « anciens », je les associe souvent à des personnes âgées et cela m’émeut souvent, je ne saurais dire pourquoi. Après dans mon travail, je côtoie tellement de prénoms de culture étrangère, avec leur musique toute différente que ma foi, je prends les prénoms comme ils viennent et que je m’attache surtout à mettre un visage dessus. C’est un minimum je trouve. Et ce n’est pas toujours facile.
Alice : Choisir le prénom de ses enfants … c’est pas toujours évident… parce qu’on est deux… que cela appelle des souvenirs, des images, ….et je trouve que c’est encore plus difficile pour le deuxième que pour l’aîné. Le prénom de notre aînée était acté, alors qu’elle n’était même pas en route ! Pour le petit frère, j’aurais aimé un prénom plus original, moins courant. D’ailleurs avec le temps, je trouve qu’il l’aurait mieux porté, que cela correspondrait plus à sa personnalité ! Mais mon meilleur souvenir dans tout ça, c’est de ne jamais avoir voulu connaître le sexe de mes enfants avant naissance. J’ai adoré ça ! Fille/ garçon, peu importe ! Juste 4 prénoms à choisir au lieu de deux !
Nos animaux
Sophie : Pour les animaux, on puise notre inspirations dans la force des chevaliers du zodiaque. Nos 4 rats : Shaka, Dohko, Milo et Camus. Et les 2 chichis : Shina et Yuna.
Pépita : Alors nos animaux, c’est notre chatte pelote qui a lancé le P : ça fera 10 ans cette année. Et puis on a eu des lapins : blanche-neige, grisette, Indiana , Pan pan (arrivée du P de Pelote) et puis nos poules ! Panache le coq, et deux autres depuis : Portos ( plume blanche dans sa belle queue noire), Pisabeau ( on pensait que c’était une poule couleur isabelle alors on l’a rebaptisé), Prudence, Paula ( référence à l’album) et Plumette (référence à un autre album). Ce sont souvent les enfants qui trouvent et on rigole bien ! On attend toujours un peu pour trouver une caractéristique chez l’animal qui pourrait nous inspirer, du coup on a encore deux poules à baptiser….
Nos pseudos
Pépita : pour Pépita ça m’est venu comme ça par rapport à la chanson « Pépito mi corazon » que j’ai mis au féminin.
Bouma : puisqu’on parle des pseudos : Bouma est tout simplement la contraction de mes deux noms de famille, un surnom donné par mes copains d’IUT et qui est resté.
au final je me rends compte que j’attache beaucoup d’importance à porter le nom de mes deux parents et comme je ne pouvais en transmettre qu’un seul à mes enfants, je n’en ai donné aucun, pas de jaloux !
Colette (qui s’appelle aussi Ada de temps en temps ) : Ada, c’est l’héroïne de la Leçon de piano, premier film d’une absolue poésie découvert à l’adolescence. Même si cette femme étrange et muette ne me ressemble pas du tout, son prénom était pour moi d’une lumineuse étrangeté.
Voilà où nous mène la littérature jeunesse quand elle est délicate, subtile, tendre et VRAIE, elle nous invite aux partages, à l’identification, aux questionnements. A l’échange, terreau si précieux pour que pousse notre grand arbre.